Sabine Blanc - Articles
journaliste web
Journaliste sur les Internets de Lagazette.fr
Passée par Owni.fr et la PQR. Spécialisée sur le numérique, la sécurité et les LEGO ; applications web de datajournalisme et infographies ; editing ; community management.
Despentes, (dé)connectée, forcément (dé)connectée
[Ceci est une analyse à l’emporte-pièce qui n’a d’autre prétention que d’être une analyse à l’emporte-pièce, essentiellement basée sur des impressions de lecture et des pomme F « Internet » dans les e-pub de King Kong Théorie et de la trilogie Vernon Subutex.]
Ce serait un beau sujet de mémoire de littérature moderne : Internet dans l’œuvre de Virginie Despentes, et plus largement, le numérique. Je lis trop peu de livres contemporains pour affirmer que l’écrivaine est l’un·e de ceux·celles qui intègrent le plus ces technologies dans son œuvre. Elle les intègre beaucoup, c’est certain, de façon naturelle, et avec une finesse dans la compréhension des enjeux dont ferait bien de s’inspirer Alain Finkielkraut.
Le temps des études étant largement dépassé pour moi, et à défaut d’une interview dont nous avons longtemps rêvé avec Alexandre Léchenet pour feu Nichons-nous dans l’Internet, voici en vrac quelques notes sur le sujet.
J’ai employé à dessein le terme « écrivaine » et pas « romancière », plus restrictif, écrivaine féministe pour être plus exacte. Internet et son cousin dégénéré le Minitel jouent en effet un rôle clé sur un point controversé de sa pensée féministe : la prostitution comme choix de métier rationnel et respectable, tout autant voire plus que caissière de supermarché ou femme de ménage, broyée par et pour le système capitaliste.
Elle les voit comme un outil d’empowerment féministe, c’est écrit avec la plus grande clarté dans son essai King Kong théorie. Au passage, elle souligne le moteur qu’est le sexe dans le développement des communications électroniques (coucou Xavier Niel et Marc Dorcel) :
« En 1991, l’idée de me prostituer m’est venue par le Minitel. Tous les outils de communication modernes servent d’abord au commerce du sexe. Le Minitel, cet avant-goût du net, a permis à toute une génération de filles de se prostituer occasionnellement dans des conditions assez idéales d’anonymat, de choix du client, de discussions de prix, d’autonomie. Ceux qui cherchaient à payer pour du sexe et celles qui voulaient en vendre pouvaient se contacter facilement, se mettre d’accord sur les modalités. Les hôtels payables par carte bleue achevaient de rendre le deal facile à conclure : les chambres étaient cleans, à prix modérés, et on ne croisait personne à l’entrée. »
La suite renvoie à des débats très actuels sur la régulation des contenus :
« Le premier boulot que j’ai fait sur Minitel, en 89, consistait justement à surveiller un serveur, j’étais payée pour déconnecter tous les intervenants tenant un discours raciste ou antisémite, mais aussi les pédophiles, et enfin les prostituées. On s’assurait que cet outil ne serve pas aux femmes qui voulaient disposer librement de leur corps pour en tirer de l’argent, ni aux hommes qui pouvaient payer et désiraient demander clairement ce qu’ils cherchaient, sans passer par la case baratin pour l’obtenir. Car la prostitution ne doit pas se banaliser, ni s’exercer dans des conditions confortables. »
La trilogie Vernon Subutex aborde tous les enjeux majeurs d’Internet. Il sous-tend la trame de l’œuvre, sert son intrigue, porte son propos politique. S’informer, communiquer, consommer, gagner sa vie, aimer, baiser, stalker, tuer… tout y passe. Logique, pour une œuvre souvent décrite comme une fresque sur notre époque.
Le droit à la connexion
Dès la page 1, la connexion à Internet est placée au rang de bien de base :
« Il n’y a rien manger dans ses placards. Mais il a conservé son abonnement à Internet. Le prélèvement se fait le jour où tombe l’allocation logement. Depuis quelques mois, elle est versée directement au propriétaire, mais c’est quand même passé jusque-là. Pourvu que ça dure. »
La page aurait pu être citée dans les débats sur la loi Lemaire. L’ancienne secrétaire d’Etat au Numérique n’a d’ailleurs pas manqué de pointer :
Lecture du dimanche soir : Vernon Subutex 3 -
Du #Despentes vertigineux
(et internet en filigrane, comme dans 1 et 2) pic.twitter.com/7rtovUEDYC— Axelle Lemaire (@axellelemaire) August 5, 2017
La crise de l’industrie musicale
Le parcours du héros, ancien disquaire qui a dû fermer boutique, est emblématique de la crise de l’industrie du disque issue de l’arrivée d’Internet. C’est résumé de façon sanglante, avec un penchant user-centric :
« Vernon était pourtant bien placé pour saisir l’importance du tsunami Napster, mais jamais il n’avait imaginé que le navire s’enfoncerait d’une seule pièce.
D’aucuns prétendent que c’était karmique, l’industrie avait connu une telle embellie avec l’opération CD - revendre à tous les clients l’ensemble de leur discographie, sur un support qui revenait moins cher à fabriquer et se vendait le double en magasin… sans qu’aucun amateur de musique n’y trouve son compte, on n’avait jamais vu personne se plaindre du format vinyle. La faille, dans cette théorie du karma, c’est que ça se saurait depuis le temps, si se comporter comme un enculé était sanctionné par l’Histoire. »
La Bérézina commerciale en phase finale, c’est sur eBay que Vernon Subutex vend ses derniers vinyles, affiches, tee-shirts…
Un peu plus loin, la démocratisation de la diffusion de la musique en ligne est évoquée, le passage de la rareté à l’abondance :
« Il n’en pouvait plus de toutes ces nouveautés, ça n’arrêtait jamais, pour suivre il eût fallu se mettre sous perfusion sur la Toile et ingérer de nouveaux sons, sans temps de repos. »
Quant à la Hadopi, elle est expédiée en une phrase lapidaire :
« Ils ont reçu un courrier Hadopi prévenant qu’il devait arrêter de télécharger, il l’a foutu à la poubelle, sans un mot. »
La déconnexion
Plus que la connexion, c’est bien la déconnexion le thème central de l’œuvre. Les « convergences » se déroule dans des lieux où la connexion est interdite. Ainsi en a décidé la Hyène, personnage récurrent dans les textes de Despentes.
De son métier, la hyène est pourrisseuse de réputation et en sait long sur la façon dont Internet peut être utilisée à mauvais escient :
« Et la Hyène avait vite capté qu’il y avait de l’argent à se faire, mais que dire du bien ne serait pas le plus lucratif.
« Elle avait racheté un répertoire de fausses identités à un ancien collègue, qui en avait soupé de passer son temps à laisser des commentaires débiles sur des sujets débiles. Elle avait récupéré une cinquantaine de pseudos – pour être crédibles, il faut que les messages soient signés par des internautes inscrits depuis longtemps sur un serveur, et qui ont des Facebook, un compte Twitter. Qui paraissent exister, si on se donne la peine de les chercher sur Google. Pour le reste, c’est une question de ne pas avoir peur de changer d’adresse IP, et réussir à garder le fil de qui dit quoi sur quel ton d’un commentaire à l’autre. […]
Elle pourrit, à la demande, tel artiste, tel projet de loi, tel film ou tel groupe électro. À elle seule, en quatre jours, elle débarque comme une armée. Elle a notoirement épaissi son cahier de fausses identités, et sans se vanter, sa connerie est virale. Elle te pourrit la toile en quarante-huit heures : sur la place de Paris, à sa connaissance, personne n’a son efficacité. Ensuite, ça roule tout seul – les journalistes regardent Twitter et les commentaires, et se sentent obligés de tenir compte des conneries qu’ils y trouvent. »
Pour la Hyène, Internet = danger, alors le meilleur moyen d’avoir la paix, c’est de se couper du réseau :
« Et on ne peut pas dire que la Hyène plaisante avec la clandestinité. Elle a posé un veto strict sur toute tentative de communication par Internet, comme sur l’idée d’ouvrir un blog et d’échanger des messages via les commentaires.
D’après elle, seuls les enfants de chœur, les perdreaux de l’année, les candides et les imbéciles imaginent qu’on peut échanger des messages sans être repérables. Sélim avait imaginé passer par le darknet et s’était fait recevoir « et t’expliqueras comment que t’as Tor sur ton ordinateur, le jour de la perquisition ? Déjà, Linux, ils se disent que tu caches quelque chose… Laisse-la vivre, la petite. Elle est bien. Arrête de t’inquiéter ».
Ça a surpris Vernon que la Hyène décide de vivre avec eux. C’était son idée de se passer de toute connexion Internet, d’interdire téléphone, portable – tout matériel traçable. Personne n’avait réalisé l’importance que ça prendrait. »
Plus loin, Despentes fait dire à un autre personnage, Max :
« Les jeunes, Internet, ils vont être surpris de comment ça va leur claquer à la gueule – ils n’ont toujours pas compris qu’on voit ce que tu fais, il suffit de s’intéresser à ton cas. »
Société de la surveillance, de la suspicion généralisée, anonymat, traces, (impossible) furtivité, autant de thèmes qui font échos aux marottes d’Alain Damasio. Une vision extrêmement pessimiste d’Internet, cloué au pilori à la fin du roman :
« Peu adaptables, techniquement retardés, les Européens étaient dépendants d’Internet – une intelligence globale rudimentaire, qui les connectait. »
Les errances fraternelles de La Horde du Contrevent ne sont pas loin, avec un penchant pour le low tech (aka frugalité technique), assimilée à la possibilité d’une forme de liberté :
« Les adeptes des convergences profitèrent de la confusion consécutive à l’arrêt définitif de l’usage des énergies électriques : accoutumés à vivre dans l’obscurité, à se déplacer pour éviter les hivers rigoureux, à s’orienter aux étoiles et à communiquer de façon rudimentaire, ils étaient avantagés. »
Formes classiques d’écriture
Curieusement, Virginie Despentes ne s’est guère aventurée dans des formes numériques d’écriture. Elle a juste tenu un blog de 2004 à 2005, mis à jour quotidiennement, fermé suite à un piratage. À l’époque, elle est revenue en détail dans une interview sur cette expérience, affirmant notamment :
« Je pense que les futurs auteurs importants viendront du blog, assurément. »
Sans surprise, elle déclarait :
« Mais au web je suis addict depuis que j’ai le haut débit. Et ça va en s’aggravant chaque année. »
Comme toute addiction, elle a une toxicité, que Virginie Despentes semble juger élevée de nos jours.
Forcément, Xavier de la Porte a consacré une chronique sur le sujet.
Les journalistes et le déni de management

Flickr cc by nd sa Dave Shea
Pour certain·e·s journalistes, la formation qu’ont reçue tous les chefs de rubrique de Contexte relève de l’hérésie, voire de l’insulte : le management.
Une hérésie car, dans leur esprit et peut-être dans l’imaginaire du grand public en général, le journalisme n’est pas un métier comme les autres. Il serait plus proche d’une forme d’art, quelque chose qui ne s’apprend pas, un sacerdoce que l’on embrasse parce qu’on a “la vocation”. Et si l’on a “la vocation”, c’est que l’on est soi-même un peu à part, une “forte personnalité” comme on dit, sous-entendu forcément ingérable. Les rédactions ne seraient ainsi pas des entreprises comme les autres, rendant inutile les codes du management.
Ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain
Il suffit pourtant de voir la souffrance des rédactions plongées dans le marasme pour constater qu’en bonne partie, les entreprises de médias sont des entreprises comme les autres. Certes avec leurs spécificités mais pas de là à jeter le bébé avec l’eau du bain. Elles naissent, se développent, ont des hauts, des bas, meurent parfois.La capacité de l’encadrement à mener ses troupes, y compris – surtout – dans les périodes de crise, y est tout aussi importante que dans une boite qui vend des chaussures.
Le management renvoie à la notion de productivité, des considérations bassement mercantiles et vulgaires dans le monde supposé éthéré du journalisme. Le concept passe d’autant plus mal que la crise des médias confronte brutalement cet imaginaire, cette aspiration à se détacher des chiffres, à la réalité des lignes de comptabilité dans ce qu’elles ont de plus désagréable, quand la marge pour les actionnaires est l’unique horizon, en dehors de toute considération éditoriale.
Il y a bien sûr quelque chose de désagréable à s’entendre dire que les mêmes règles peuvent servir dans une boite qui vend des chaussures et une “noble” rédaction.
Il faudrait peut-être parfois faire preuve d’un peu d’humilité et écouter ce que l’on a à tirer du management.
Communiquer, communiquer et encore communiquer
Ecouter, communiquer, justement, voilà une des règles de base du management, cela peut sembler trivial, mais les cordonniers sont parfois les plus mal chaussés et l’information ne circule pas forcément de façon très fluide dans les rédactions. Pris dans le rythme de la publication, on ne prend pas forcément le temps de se poser tranquillement de façon régulière pour laisser la parole à ses collègues sur leur environnement de travail. Ce, alors que certaines rédactions sont frappées de réunionite aiguë, que seule la possession d’un smartphone rend un peu plus supportable.
Autre point clé, (se) fixer des objectifs clairs, avec un échéancier, plutôt que le flou artistique, au prétexte qu’on ne peut pas fixer des objectifs vu la particularité du métier. À ce compte-là, il serait impossible de mesurer les progrès effectués. Pourtant, quel·le jeune journaliste n’a pas constaté que des facettes de son métier qui lui paraissaient difficiles, avec le temps, ont été intégrées : rédiger rapidement un article, étoffer son carnet d’adresse, avoir des infos exclusives, des angles plus affinés, une écriture plus fluide, se taper vingt galettes des rois en janvier...
Bien entendu, cela ne se mesure pas avec la finesse chirurgicale qu’un nombre de paires de chaussures vendues, mais c’est une base d’échange. Ainsi en débarquant à Contexte, fraîche comme un poulpe échoué sur une plage en août après un congé mat’, j’ai été bien contente d’avoir une feuille de route avec des items à cocher grosso modo sur une période donnée, et qui évolue bien sûr avec les mois.
Amour sacré du tableur
De même, l’anticipation est essentielle pour atténuer les inévitables coups de bourre et leurs conséquences : fatigue indue qui retombe sur un.e collègue - ah mince, j’ai déjà organisé mes vacances, tu seras tout seul cette semaine -, trous éditoriaux parce qu’on ne peut pas courir partout, etc. Et là, sauf à avoir une mémoire d’acier, rien ne vaut une bonne tripotée de tableurs partagés.
Bien mener une équipe, c’est aussi, à mon sens, celui-celle qui sait dire “j’ai merdé, je me suis trompé·e” ou tout simplement “je ne sais pas”. C’est désagréable pour un·e “chef·fe”, a fortiori dans un métier où l’on aime, peut-être encore plus que dans d’autres, avoir raison. C’est pourtant essentiel pour rester sur une relation saine et progresser, plutôt que de jouer au·à la cheffaillon·ne buté·e et pseudo-omniscient·e.
A contrario, il ne suffit pas d’être cool : on peut même être fort sympathique et pas foutu·e de gérer une équipe. C’est la cerise sur le gâteau, mais à tout prendre, il vaut mieux un·e bon·ne manager·euse un peu froid·e mais au rendez-vous dans les moments de difficulté qu’un·e chef·fe “pote” qui fera défaut dans la tempête.
Bien entendu, quand je parle “équipe”, il faut y inclure les pigistes à part entière quand ils sont un rouage essentiel du fonctionnement, en évitant une attitude à géométrie variable en fonction des circonstances.
Système de progression mal fichu
Après une petite dizaine d’années dans le métier, force est de constater que les bon.ne.s manager·euse·s se comptent sur les doigts de la main d’un menuisier en fin de carrière.
La faute en revient au système de progression dans les rédactions qui ne diffère guère de celui des autres entreprises : monter dans l’encadrement est la suite logique d’une carrière, pour avoir le titre et le salaire qui va avec. Et tant pis si l’on ne présente pas les qualités requises. On peut pourtant être un excellent reporter et un piètre manager·euse, un·e excellent manager·euse et un·e journaliste honnête. Je ne crois pas trop par contre que l’on puisse être journaliste médiocre et bon manager·euse, une compréhension globale du métier est une condition sine qua non.
Toutes les rédactions devraient donc intégrer dans leur plan de formation continue le management. Si certain·e·s ont d’évidentes qualités pour ce profil, cela ne dispense pas forcément de formation. Et, à défaut de réformer le système de progression dans les rédactions, elle limiterait les dégâts.
Quelques astuces pour utiliser Cartodb
Quand on n’a connu que Google Maps/Fusion, le logiciel de cartographie Cartodb suscite un “wouah” au premier abord : beau, ergonomique, nombreuses possibilités de personnalisation… Après plusieurs mois d’utilisation, le cri de joie a cédé la place, plus d’une fois, à “putain fais chier, c’est quoi encore ce bug”. Cartodb présente en effet des bizarreries, voire des anomalies qui en font un outil plus complexe à utiliser qu’il n’y parait. Leur support est très réactif mais pas toujours très efficace, cf point 4 de cet article. Pour vous éviter de perdre du temps, voici quelques astuces, une liste non exhaustive qui sera enrichie au fil du temps, n’hésitez pas à me partager les vôtres, je les rajouterai, mon mail est dans la colonne de gauche.
1 - Ma première ligne n’est pas prise en en-tête
La logique veut que la première ligne d’un fichier soit automatiquement considérée comme l’en-tête ou du moins, comme sur Datawrapper, qu’on vous demande de confirmer que c’est bien le cas. Sur Cartodb, il arrive que cette première ligne soit considérée comme une ligne “normale” et que l’en-tête soit généré automatiquement (field_1, field_2, etc) :
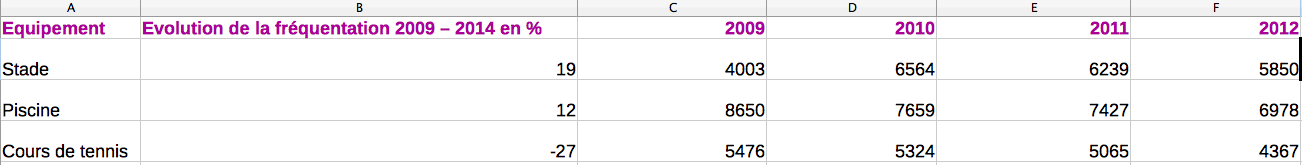
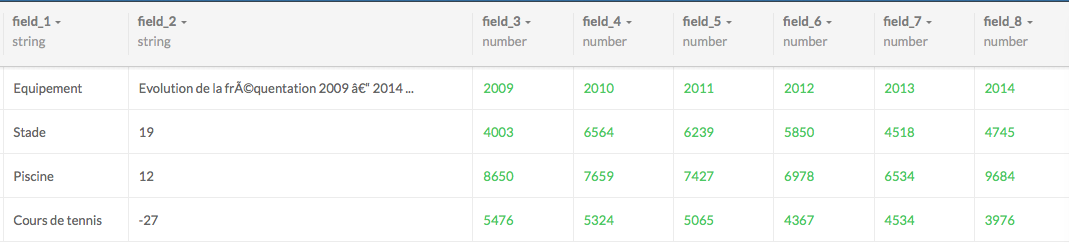
L’explication : Cartodb n’aime pas que des en-têtes soit composées uniquement de chiffres, typiquement une série d’années. Il faut donc y mettre d’autres caractères :
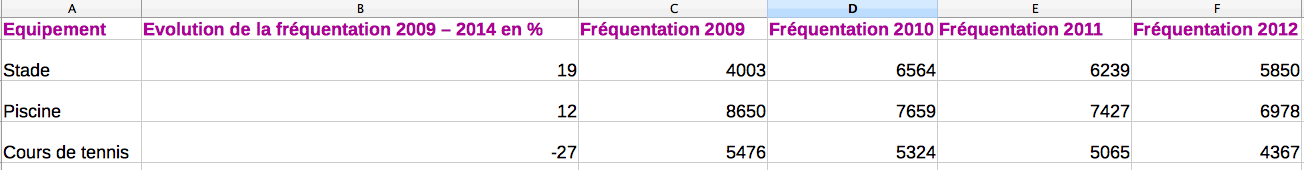
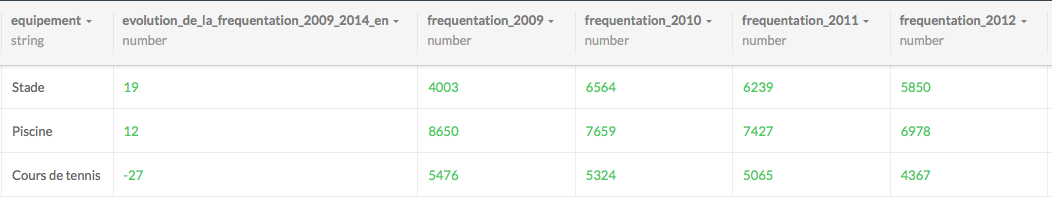
2 - Le contenu d’une colonne laisse apparaître le html
Il arrive que, pour des questions de mise en forme, il soit nécessaire d’éditer en html les cellules d’une colonne :
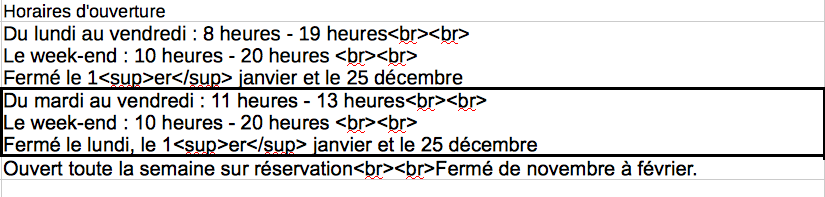
Le fichier chargé, vous vérifiez que le html est bien pris en compte, jusqu’ici tout va bien :
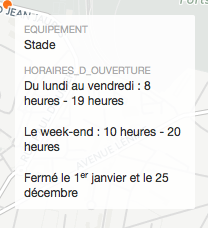
Et puis vous commencez à éditer les infowindows en hml et là, paf, le texte des infobulles apparaît en html :
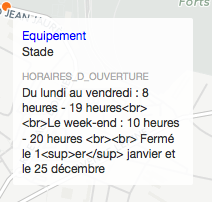
Pour éviter cela, il faut mettre le nom de la colonne en hml entre triple accolades et non entre double accolades, comme c’est le cas par défaut. Cela n’a strictement rien d’intuitif, et si le support de Cartodb ne l’avait pas indiqué à une collègue, on tournerait toujours en rond.
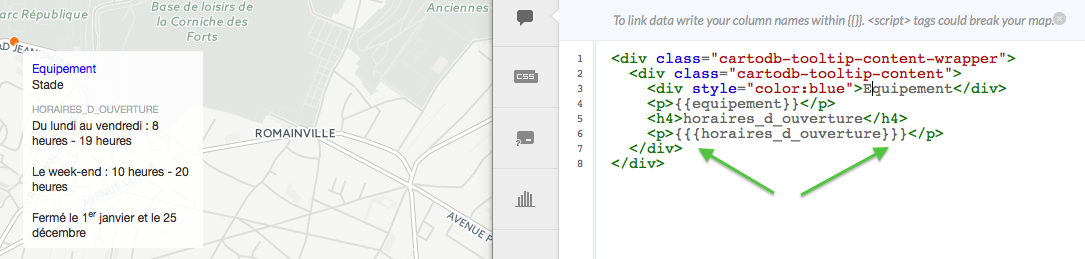
Et si jamais vous avez oublié ce tip, pas de panique, cliquez sur la petite icône “Toggle fields and titles”, puis sur “Proceed”, l’editing en html que vous avez fait dans les infowindows revient à zéro, les bulles n’apparaissent plus en html, vous pouvez alors rajouter les triple accolades et éditer derrière sans rien casser.
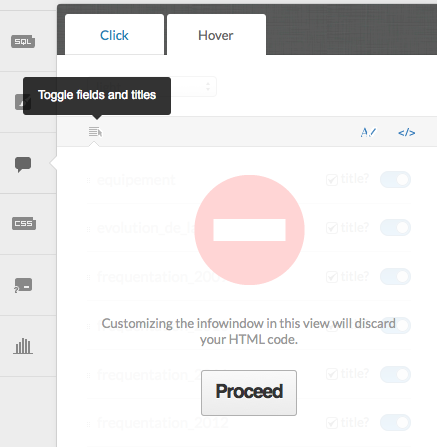
3 - Pourquoi toutes mes colonnes sont éclatées en une myriade de sous-colonnes ?
Vous avez chargé un fichier en apparence clean, que ce soit en vue tableur :
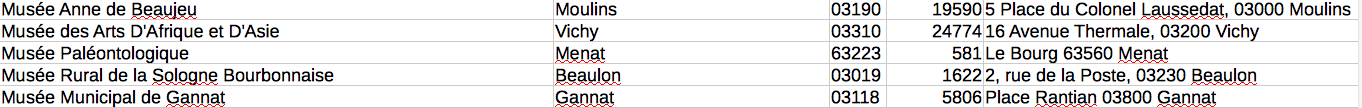
Ou ouvert dans un éditeur de texte type Sublime text, fort utile pour voir les petites crasses qui peuvent faire bugguer un upload : en effet, le texte est entre guillemet, ce qui le préserve, en théorie, de faire péter le fichier :
![]()
mais une fois chargé cela donne ceci :
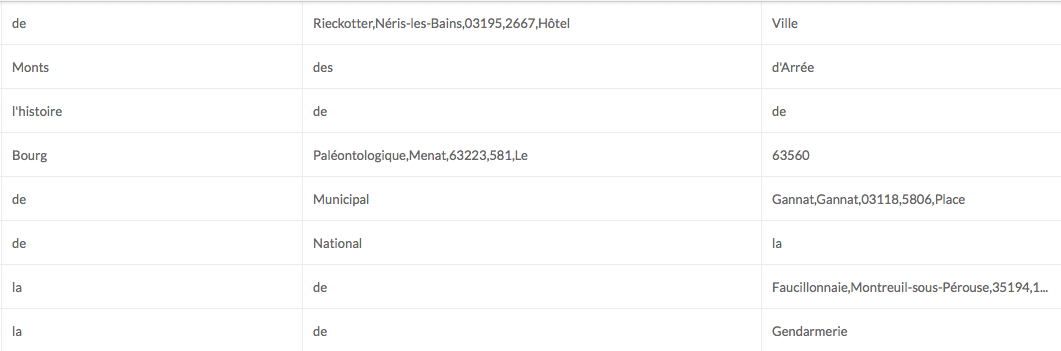
La raison est simple : Cartobd présente une forte intolérance aux sauts de ligne et tabulations, même intégrés dans une chaîne de caractères entre guillemets. Il faut donc les supprimer pour que tout revienne à la normale. J’ai eu cette mauvaise expérience en reconstituant des adresses en concaténant plusieurs colonnes d’un fichier Excel administratif, en clair qui se soucie peu de ces bizarreries de formatage.
4 - KML, ce souvent douloureux problème
Le format KML est familier en cartographie, utilisé entre autres par Google. Cartodb gère hélas très mal ce format.
Si vous êtes chanceux, vous pourrez transformer votre colonne contenant les KML en géoréférence en appliquant cette requête SQL :
UPDATE nom_de_mon_fichier SET the_geom = st_setsrid(ST_GeomFromKML(nom_de_ma colonne_contenant_le_kml),4326)
Je dis chanceux car cela plante souvent. Contacté sur le cas des KML du Grand Paris, Cartodb m’avait répondu que cela était dû à un fichier défectueux qui faisait bugguer l’upload. Le fichier avait pourtant été testé avec succès, comme je leur ai expliqué.
Faute de mieux, j’ai donc créé une table vide et copié-collé une à une les lignes du csv contenant le KML et effectué la requête ci-dessus. Cela passe avec un fichier de 12 lignes, cela vire vite au cauchemar pour des fichiers plus conséquents.
Si quelqu’un a trouvé mieux, je suis preneuse !
J. G. Ballard, poète technicien vs poète luddiste inspiré par la muse
Une ode à la poésie comme acte de création irréductible de l’Homme : Numéro 5, les étoiles, une des nombreuses nouvelles de J. G. Ballard écrite en 1961 [1], est une charge contre la poésie générée par ordinateur. J’avais découvert, grâce à une émission de feue Place de la toile, que les machines étaient capables de produire de la poésie avec l’apparence de compositions nées du « génie humain », au point de tromper des lecteurs.trices sur leur origine algorithmique. Ce qui n’avait pas manqué de me plonger dans des abîmes de questions métaphysique puisque la poésie, selon une tradition qui remonte à l’Antiquité, est une émanation de l’âme échappant à toute réduction mécaniciste.
Dès la fin des années 50
Je ne sais pas si Ballard s’est intéressé de près au sujet dès cette époque, lui inspirant cette nouvelle parabolique, mais il est certain que sa réflexion est très avant-gardiste : d’après cette petite synthèse, la poésie générée par ordinateur remonterait à la fin des années 50 :
« Quand les ordinateurs ont-ils commencé à assembler des mots ? Jusqu’en 1950, les ordinateurs ne sont guère que des « calculateurs ». Ils savent seulement calculer sur des nombres et ils ne connaissent que les chiffres. Dès 1951, toutefois, l’Univac I, le premier ordinateur de gestion, pouvait lire l’anglais en lettres majuscules mais ce n’est pas avant 1965 que les codes EBCDIC et ASCII permirent de maîtriser les textes écrits en une typographie riche. C’est pourtant en Allemagne, à l’école polytechnique de Stuttgart, dès 1959, qu’un ingénieur, Théo Lutz, qui travaillait avec Max Bense, aurait réussi à programmer les premiers vers composés par une machine en allemand. »
J. G. Ballard adopte un point de vue résolument conservateur, réac’ diraient certains, puisqu’il dénie à la poésie générée par ordinateur le statut de vraie poésie, dans un récit aux allures d’arroseur arrosé (spoiler par la suite).
Paul Ransom est le rédacteur en chef d’une revue de poésie générée par « verséthiseur » (VST), Wave IX, à une époque où plus aucun humain ne crée de poésie sans cette assistance. Il habite un petit village, Vermilion Sands, squatté par des ateliers « occupés par des peintres et des poètes – en majorité abstraits et non productifs ».
Sa train-train est troublé par l’arrivée Aurora Day, une mystérieuse nouvelle habitante, avec Cadillac et chauffeur : elle persiste à composer elle-même ses poèmes et à les envoyer jusqu’aux oreilles de Paul Ransom qui les juge épouvantables. Pour lui, la poésie est une affaire terre-à-terre, comme une autre :
(Aurora) « Alors, parlez-moi de votre travail. Vous êtes bien placé pour savoir pourquoi les choses vont si mal dans la poésie moderne. Comment se fait-il que tout cela soit aussi médiocre ? »
Je haussai les épaules. « Je crois que c’est avant tout une affaire d’inspiration. J’en ai écrit pas mal moi-même, voici des années, mais ce bel élan a cessé dès que j’ai pu me payer un VST. Dans le passé, un poète devait faire le sacrifice de lui-même afin de maîtriser son mode d’expression. À présent que la maîtrise technique est devenue une simple question de bouton à pousser, de nombres de pieds, de rimes et d’assonances à sélectionner sur un cadran, il n’est plus nécessaire ni de se sacrifier ne de s’inventer un idéal qui rende ce sacrifice utile... »
Bref, au Diable les états d’âme et la muse inspirant le poète.
Aurora Day bombarde le rédacteur en chef de ses créations afin qu’il la publie. En vain : il les trouve vraiment trop atroces. Atroces car imprévisibles, alors que la poésie est, par excellence depuis le XIXe siècle, la création autorisée à s’échapper des conventions :
« Les jours qui suivirent, je fus la cible d’un bombardement incessant de poèmes, plus obscurs et déconcertants que jamais. »
« Quand allez-vous enfin retrouver la raison et redevenir poètes ? »
Un peu magicienne, la poétesse pirate le prochain numéro de la revue pour y glisser ses créations. Elle obtient ainsi de Paul Ransom la direction de la politique éditoriale. Placer ses créations n’est pas une fin en soi, non, son vrai but, elle l’explique à sa victime dans une pirouette en forme de paradoxe, du moins pour son interlocuteur :
« Croyez-vous qu’un seul numéro suffira ? » dis-je. Je me demandais vraiment ce qu’elle pourrait bien en faire.
Elle leva vers moi des yeux nonchalants et se mit à tracer des dessins à la surface de l’eau d’un doigt laqué de vert.
« Cela ne dépend que de vous et de vos amis. Quand allez-vous enfin retrouver la raison et redevenir poètes ? »
Dialogue de sourds entre deux visions incompatibles :
« Vous devriez venir rencontrer les membres de notre petite communauté, suggérai-je.
Je le ferai, dit-elle. J’espère pouvoir les aider. Ils ont tous tant de choses à apprendre. »
Ce qui me fit sourire. « Je crains que vous ne trouviez bien peu d’adeptes. La plupart d’entre eux se considèrent eux-mêmes comme des virtuoses. Pour eux, la quête du sonnet parfait s’est terminée voilà des années. Leur ordinateur ne produit rien d’autre.
Ce ne sont pas des poètes, mais de simples mécaniciens, railla-t-elle. Regardez leurs prétendus recueils de vers. Trois poèmes pour 60 pages de mode d’emploi. Rien que des volts et des ampères. Et quand je dis qu’ils ont tout à apprendre, je parle de ce qui touche leur propre cœur, pas de la technique ; je parle de l’âme de la musique, et non de son aspect formel. »
Elle fit une pause et s’étira, déroulant son corps superbe comme un python. Elle se pencha en avant et se mit à parler sérieusement. « Si la poésie est morte aujourd’hui, ce n’est pas la faute des machines, mais des poètes eux-mêmes qui ne cherchent plus leur inspiration authentique.
C’est-à-dire ?
Aurora hocha tristement la tête. « Vous vous prétendez poète et vous l’ignorez ? »

Flickr CC by Steve Jurvetson
La poétesse fait un détour par le mythe de Mélandre et Corydon pour tenter de lui faire comprendre ce qu’est la poésie authentique. Muse de la poésie, Mélandre avait privé de leur inspiration les poètes courtois pour les punir de s’être « mis à considérer leur art comme un fait acquis, oubliant la source même d’où il jaillissait. » Et de réclamer que l’un deux se sacrifie pour rompre le sort. Seul Corydon, amoureux de la muse, accepta et se suicida.
La portée parabolique du récit devient alors transparente.
La muse rebelle sabote, du moins on soupçonne fortement qu’elle en est à l’origine, tous les VST, et sabote ainsi le contenu du prochain numéro de Wave IX : Paul Ransom n’a d’autre solution que de mettre de la poésie conçue de façon traditionnelle. Il finit par dégoter un appareil qui a survécu, chez Tristram, un de ses amis, qui s’attelle à sa tâche. Avec la promesse qu’Aurora Day ne saura rien de leur origine computationnelle. Elle mord à l’hameçon, se réjouissent Paul et Tristam.
Mais Tristam meurt en essayant de défendre Aurora d’une attaque... de raies. Puis elle disparaît, à bord de sa Cadillac.
Détruire les machines
Retournement de situation : Tristam est bien vivant et avoue à Paul qu’il a lui-même composé les poèmes :
Parfaitement, très cher. Chacun d’eux est une gemme greffée d’âme !
Affolé, le rédacteur en chef se demande comment il va pouvoir finir de remplir sa revue, soit 23 pages. Soit exactement le nombre de poètes habitant à Vermilion Sands, qui retrouvent en une nuit l’inspiration. Contagieux… :
« Ils avaient tous ce soir-là ressenti mystérieusement l’urgent besoin de créer quelque chose d’original et s’étaient mis aussitôt à rédiger, au pied levé, une ou deux strophes à la mémoire d’Aurora Day.
Perdu dans mes réflexions, je reposai le téléphone après le dernier appel et me levai. Il était une heure moins le quart et j’aurais dû être mort de fatigue, mais je me sentais au contraire l’esprit vif et alerte, traversée de mille et une idées. Une phrase se formait toute seule dans ma tête et je saisis en hâte mon carnet pour la noter. Le temps sembla s’abolir. Cinq minutes ne s’étaient pas écoulées depuis que j’avais composé ma première œuvre poétique depuis plus de dix ans. »
Dans un geste de poète luddiste, Paul Ransom détruit son bon de commande de trois VST.
Voyage à Capitalismopolis avec J. G. Ballard
Entre 2008 et 2010, la maison d’édition Tristam a eu l’excellente idée de traduire et publier l’intégralité des nouvelles du génial écrivain britannique J. G. Ballard (Tome 1, tome 2 et tome 3). Deux m’ont particulièrement marquée car Ballard évoque, avec une fascination ambiguë, ce qui forme la quintessence du capitalisme ultra-libéral issue de la révolution industrielle, selon lui : contrôle du temps, publicité, automobile, délinquance... Son ambiguïté est aussi, à certains égards, la nôtre, en cette période où la “transition énergétique” est devenue le dernier motto loué à droite comme à gauche mais sans que l’on en tire vraiment les conséquences.
“Notre maison brûle et nous regardons ailleurs”, avait déclamé Jacques Chirac dans un discours resté célèbre. Ballard semble plutôt dire : “Notre maison brûle et nous regardons danser ce feu, incapable de détourner le regard devant sa beauté maladive.”
Les deux nouvelles, Chronopolis et L’ultime cité, écrites à 16 ans d’intervalle, 1960 et 1976, se répondent en miroir. Le titre, déjà, qui place la ville au centre du récit, une ville mythologique.
Dans leur structure narrative, ces récits offrent de fortes similitudes. Dans les deux cas, l’action se situe dans un futur d’anticipation, où l’humanité a fait sa révolution. Le héros va transgresser les interdits imposés par les nouvelles organisations pour, dans un élan d’hybris, remettre en marche ce vieux monde périmé. Ils éprouvent tous les deux une fascination pour le type de vie produit par ces sociétés, grâce à leurs fondements aux valeurs viciées.
Cachez cette montre que je ne saurais voir
Chronopolis prend pour point de départ une ville où la mesure du temps est devenue interdite : détenir une montre est un crime et la “police du temps” veille au grain.
D’abord intrigué par l’interdit, Conrad, le jeune héros, se prend vite de passion pour la mesure du temps. Le tabou le fascine autant qu’il lui semble incompréhensible. Les explications d’un de ses professeurs, Stacey, le laisse dubitatif :
Il est contraire à la loi d’avoir une arme à feu parce qu’on pourrait tuer quelqu’un. Mais comment faire du mal à quelqu’un avec une horloge ?
N’est-ce pas évident ? On peut le chronométrer, savoir exactement combien de temps il met à faire quelque chose…
Et alors ?
Ensuite, on peut le forcer à aller plus vite.
Comme Chaplin dans Les Temps modernes, Ballard élabore une fiction métaphorique sur un phénomène analysé entre autres par l’historien anglais Edward P. Thompson : le passage du "temps-horloge" au " temps-nature " de la révolution industrielle.
Conrad parvient à se fabriquer sa propre montre, que Stacey repère. Il lui propose de faire un retour dans le temps, dans une zone de la ville abandonnée peuplé de cadavres d’horloges : Chronopolis. Pressé de questions par Conrad, Stacey lui explique comment marchait ce monde d’avant : réglé selon l’horloge centrale, les journées s’écoulaient programmées minute par minute selon la qualité sociale des personnes.
Loin d’être révulsé, Conrad ne comprend pas comment les citoyens ont pu y mettre fin par leur révolte. La nouvelle emprunte un procédé cher au conte philosophique, en l’inversant : la posture du Candide étranger, utilisé par exemple dans Les lettres persanes pour dénoncer les abus du régime monarchique français. Sauf que là, le Conrad-Candide admire cette dictature du temps et les explications de son professeur le laisse de marbre :
“Les gens qui vivaient ici devaient des géants. Ce qui est vraiment remarquable, c’est que tout a l’air d’avoir été abandonné hier. Pourquoi n’y revenons-nous pas ?
“Et bien, à part le fait que nous ne sommes plus assez nombreux aujourd’hui, même si nous l’étions, nous ne pourrions pas contrôler cette ville. À son apogée, c’était un organisme social incroyablement complexe. Il est difficile d’imaginer les problèmes de communication en se contentant de regarder des façades vides. La tragédie de cette ville, c’est qu’il semblait n’y avoir qu’une façon de les résoudre.
On les a résolus ?
Oh, oui, certainement. Mais en ne tenant pas compte du facteur humain dans l’équation. Réfléchis aux problèmes qui se posaient. Transporter quinze millions d’employés de bureau vers le centre et retour chaque jour, acheminer un flot ininterrompu de voitures, de bus, de trains, d’hélicoptères, installer des vidéophones dans tous les services, sur presque chaque bureau, munir chaque appartement de la télévision, de la radio, de l’électricité, de l’eau, nourrir et divertir ce nombre fabileux de gens, préserver leur bien-être et leur sécurité avec des services, auxiliaires, police, pompiers, hôpitaux… tout cela tournait autour d’un seul facteur.”
Stacey montra le poing à la grande tour de l’horloge.
“Le temps ! Ce n’est pas qu’en synchronisant chaque activité, chaque pas en avant ou en arrière, chaque repas, arrêt de bus et appel téléphonique que l’organisme pouvait se maintenir.”
Il détaille ensuite le système de programmation mis en place pour réguler cette bureaucratie du temps kafkaïenne. Une forme de smart city big brother big ben, où il est interdit d’utiliser le robinet ou les transports hors des plages définies.
Échos de fab lab
L’ultime cité décrit une société post-épuisement des ressources fossiles : les humains se sont réorganisés en villages autonomes où la technique est au service de mère Nature (et pas l’inverse) :
“Une fois épuisée les réserves mondiales de combustibles fossiles, une fois vidées les dernières mines de charbon, une fois les derniers pétroliers rentrés au port, les centrales électriques et les réseaux ferroviaires, les chaines de montage et les aciéries avaient fermé pour la dernière fois et l’ère post-technologique avait commencé.”
“Ces groupes de colons - médecins, chimistes, agronomes, ingénieurs -, réduits en nombre mais déterminés, étaient partis s’installer dans les zones rurales reculées, décidés à créer la première société agraire scientifiquement évoluée. En une génération, ils avaient réussi, comme d’innombrables communautés du même type établies autour des grandes cités, à construire leur paradis pastoral, mariage forcé d’Arcadie et d’une technologie perfectionnée.”
Point de commerce mais du néo-artisanat boosté à la technologie, qui anticipe furieusement le mouvement de la fabrication personnelle numérique -DIY, fab lab, makerspace, etc- et son corollaire, la décroissance :
À Garden city, les magasins étaient rares : tout ce dont on pouvait avoir besoin […] était commandé directement à l’artisan qui le dessinait et le fabriquait selon les exigences précises du client. À Garden City, tout était si bien fabriqué qu’il durait éternellement.
Mais une ville fonctionnant sous l’ancien modèle demeure, à portée de coucou, vers laquelle Halloway, le héros, est irrésistiblement attiré. Il faut dire qu’il trouve ses concitoyens un tantinet… ennuyeux :
Avait-il vraiment passé toute sa vie avec ces gens tranquilles, civilisés et anémiques ?
Un mépris que partage aussi Conrad :
Sans elle (un clepsydre), il se sentait aller à la dérive, naufragé dans les limbes gris inutiles d’événements atemporels. Son père commença à lui sembler oisif et stupide, à toujours rester sans rien faire et sans la moindre idée de ce qui allait se passer.

Flickr CC by nc nd #tom #malavoda]
Les deux personnages entreprennent de réallumer ces vestiges du passé, aidés par des acolytes à moitié fous. Conrad en remettant en marche les horloges, Halloway les bars, les magasins, la publicité, les voitures, la délinquance… :
“Une force de police importante était, au même titre que la pollution et un taux élevé de criminalité, une caractéristique essentielle de la vie urbaine.”
Pour connaître l’épilogue, une solution : acheter les ouvrages, cela fait un très beau cadeau de Noël !
[Data] Les facettes de la professionnalisation de la location de voitures entre particuliers
Après avoir scanné le profil des locataires d’Airbnb dans quelques grandes villes touristiques, je me suis penchée sur Drivy, le service de locations de voitures entre particuliers. La même question a guidé ce petit travail : reste-t-on dans l’économie du partage -des restes ironisent certains- ?
J’ai récupéré avec Outwit un peu plus de 1000 données à Paris, Drivy limitant l’affichage à 51 pages, à raison de 20 véhicules présentés par page. L’analyse des id des propriétaires montrent qu’une grande majorité ne loue qu’une auto, seuls 10% en proposent plus de deux :
Un bref examen des multipropriétaires montre bien les différentes facettes de la professionnalisation de la location d’auto entre particuliers. Le plus gros propriétaire est Drivy lui-même qui loue 38 véhicules, de la citadine au van, à Dausmenil. Taux de réponse de 94%, note de satisfaction de 4,75/5, une belle vitrine pour la start-up, et qui la place dans une confrontation directe avec les loueurs classiques.
Service de carsitters
On trouve aussi dans les gros propriétaires un représentant de ces nouveaux intermédiaires issus de ces plateformes : Carlili, “un service de carsitters : nous faisons de la conciergerie de véhicules de particuliers sur nos parkings pour pouvoir les louer sur Drivy.” Cette start-up témoigne de la façon dont l’économie du beurre dans les épinards s’éloigne parfois de l’amateurisme mais aussi reproduit des modèles déjà existants : il est déjà possible de faire gérer la location de son appartement par des agences, par exemple.
Carlili gère deux profils, un ici, un là, pour 68 véhicules en tout. Son créneau, les beaux jours, quand les voitures dorment dans les garages mais que de nombreuses personnes sont en quête d’un véhicule pour leurs vacances, un mariage, etc. Drivy et Carlili ont signé fin juin un partenariat.
Loin derrière, on trouve Philippe V., qui ne se présente pas mais loue 10 véhicules et plus de 550 locations au total, du côté de la gare de Lyon. Il est sur la plate-forme depuis 2012. Philippe Vlahakis de son nom complet, il est aussi un peu présent sur eloue.com et AutoVoisin, deux plateformes moins connues. Il n’a pas répondu à mon mail pour avoir plus de renseignements sur son activité, et je ne l’ai pas retrouvé sur Societe.com et consort.
En tous les cas, il est très apprécié pour ses prestations dignes… d’un professionnel :
“Philippe est très professionnel et disponible”
“un serieux contractuel digne d’un professionnel.”
“Très professionnel.”
“Propriétaire très attentif et très professionnel.”
La quête fut plus simple avec André C. et ses 6 véhicules, qui a accumulé 520 locations depuis 2011. Rien ne le signale comme un professionnel mais il suffit de lire les commentaires pour trouver son patronyme et découvrir que c’est un professionnel, actif depuis 2002.
Dans un autre style, Mehdi et ses 5 véhicules en profite pour essayer d’accroître son carnet de client dans son autre activité : “On fait aussi tout travaux de plomberie, parquet et peinture.... “, indique-t-il dans sa bio.
Investir dans un second véhicule ?
Le gros des multipropriétaires possèdent 2 ou 3 véhicules. Comparé aux multipropriétaires de logements, les problématiques sont différentes. Louer plus d’un bien à Paris nécessite un très gros capital de départ, ou une vieille tante qui vous a laissé un héritage généreux. Mais une fois qu’il est à vous, ma foi, il est là et ne bouge pas.
Il peut être malin d’acheter une citadine à 2000 euros en plus de son auto personnelle car on peut vite retomber sur ses pattes : à titre d’exemple, nous avons "gagné" plus de 750 euros en 2,5 mois de location cet été, sachant que nos prix sont en-dessous de la moyenne pour notre gamme de voiture. Mais nous avons la chance de ne pas avoir de problème pour la garer, habitant à Romainville, avec une place réservée devant la maison. Par contre, cela peut constituer un vrai problème à Paris lors des périodes de moindre demande si l’on n’a pas un coûteux box : perte de rentabilté en tickets de parking et de temps à chercher un emplacement au retour.
Vous avez aimé cet article ? Vous aimerez peut-être aussi celui-ci sur Airbnb dans les villes touristiques.
Les associations parisiennes en données
La Ville de Paris a mis en ligne un fichier csv des associations parisiennes, tout propre à part un problème d’encodage qui n’empêche pas de l’exploiter.
Pourquoi est-il si joli ? Tout simplement parce qu’il est utilisé pour proposer un service, un annuaire des associations qui nécessite d’avoir une base de données bien structurée.
Le fichier est gros, près de 70000 lignes, mais la lecture de sa présentation explique cette taille :
« Les mêmes lignes semblent parfois se répéter plusieurs fois mais cette répétition est justifiée par une information potentiellement différente dans chaque ligne. Par exemple si l’association déclare dédier son activité au public des jeunes et au public des adultes, elle sera répétée deux fois, une fois par public. Idem pour son champs d’activité, son secteur d’activité, son secteur géographique. »
Comme chaque association est reliée à un identifiant unique, il est donc déjà possible de calculer le nombre d’associations répertoriées : 2782. On pourrait croire du coup à une erreur mais, effectivement, par le jeu des combinaisons possibles, une seule association peut générer plusieurs dizaines de lignes en fait.
Rentrons maintenant dans le détail de leurs actions.

1907 Girls Basketball Team - Flickr CC by nc nd Batavia public library
De la détente avant toute chose
Quel est le secteur d’activité de nos associations ? Pour faire ce calcul, je me suis basée sur la colonne « libellé du secteur d’activité », plus riche que la colonne « libellé du domaine d’activité », 22 contre 6. Cette dernière est utilisée par l’annuaire des associations.
On voit très nettement se détacher des thématiques liées, cela n’a rien de péjoratif, à la détente : culture et arts, sport et loisirs. Celles en lien avec un engagement un peu moins léger, sont nettement derrière : social, précarité et exclusion, humanitaire, etc. Toutefois, cette première analyse doit être approfondie par le nombre de membres impliquées dans chaque association.
Notons que le petit dernier, les transports, relève paradoxalement d’un sujet important dans une grosse ville comme Paris.
Si l’on se base sur la première catégorie listée, le sport l’emporte haut la main :
Et c’est aussi flagrant en passant dans Wordle le nom des associations, en enlevant les termes non discriminants comme association, club, etc.

L’on n’observe pas de différence flagrante d’un arrondissement à l’autre, les thèmes dominants sont toujours les mêmes. Il faudrait plonger dans le détail des activités des associations pour percevoir une différence éventuelle. Cliquez sur chaque bulle pour avoir le détail de chaque catégorie.

Flickr CC by nc nd The Happy Rower
De l’arrondissement à la planète
Il est aussi intéressant de voir où l’activité associative est la plus importante.
On peut en avoir un premier aperçu en regardant le chiffre brut du nombre d’asso. Il est déjà notable que différentes couches géographiques, du plus local, l’arrondissement, au plus global, l’international, se superposent. Un quart est au national et à l’international, un fait, j’imagine, dû au statut de capitale de Paris, avec le poids de l’héritage jacobin.
Si l’on se concentre sur l’échelon de l’arrondissement, il existe deux possibilités : observer le chiffre brut des associations et, plus intéressant, rapporter le nombre d’associations à la population de chaque arrondissement. Avec un biais : les associations rattachées à l’ensemble de Paris, l’Île-de-France et l’international ne sont pas rattachées à un arrondissement, même si le siège social y est, alors qu’elles témoignent aussi de sa vitalité.
Du coup, ce ne sont pas les mêmes “champions” qui se détachent (sélectionner dans le cartouche "visible layer" la grille de lecture) :
Les publics en difficultés minoritaires
Les publics cibles recoupent les catégories des associations : les publics en difficultés sont minoritaires. Les catégories peu discriminantes - tous, adultes, jeunes - sont en tête :
De nouveau, on note une homogénéité d’un arrondissement à l’autre. J’ai fait le test sur les trois premières cibles en tête, le verdict est le même. Du coup, je suis restée sur l’affichage selon la première cible, le détail est dans les infos-bulles :
En revanche, lorsque l’on entre dans le détail des catégories par cibles, on note des nuances plus sensibles. Mais aussi des constats curieux : ainsi les associations pour les publics en difficulté ne se rangent que très peu dans la catégorie "humanitaire", "précarité et exclusion", "défense des droits et des intérêts", etc, dont on pourrait penser qu’elles ont un lien plus fort que pour les autres publics.
Si cet article vous a intéressé, vous aimerez peut-être celui sur l’analyse du fichier des associations reconnues d’utilité publique.
Les outils utilisés pour ce travail sont gratuits et accessibles : LibreOffice, Cartodb, Infogr.am et un peu de Ruby par pur pédantisme.
La SNCF ou la monomodalité en marche
Sur l’intermodalité, la SNCF navigue toujours dans des eaux médiévales, avec cette couche d’absurdité si agaçante. Ce samedi, j’ai voulu me rendre en TGV à Vendôme en embarquant mon vélo. En arrivant à la gare Montparnasse, patatras, la rame destinée aux vélos à été supprimée et le responsable du train, pour des raisons de sécurité, refuse les vélos. De toute façon, j’avais déjà tout faux : pour mettre son vélo dans un TGV, il faut réserver et payer un supplément de 10 euros, deux contraintes qui n’existent pas sur le TER. Je m’étais naïvement fiée au petit logo « vélo » sur la réservation. Trop simple. Bien sûr, cela suppose d’avoir dégoté un des TGV, minoritaires, qui prend les vélos.
Le manager du train suggère de laisser l’engin à la gare. Euh, non, désolé, je ne laisse pas un vélo à 1000 euros 36 heures à Montparnasse. A moins d’avoir des cages sécurisées mais ce n’est prévu que dans le prochain plan vélo parisien.
Deux Néerlandais sont dans le même cas que nous, mais avec des réservations. Ils hallucinent évidemment sur la situation. Le changement des billets est un grand moment : l’employée appelle un premier supérieur qui en appelle un second. Il faudra bien 20 minutes pour dépatouiller les deux cas.

L’argument de la sécurité est étonnant : une valise de 20 kg, des skis, un chevalet ne sont pas considérés comme de potentiels projectiles dangereux, un vélo oui. A 300 km/heure en cas de choc, la différence est subtile. Il est d’autant plus étonnant que les Néerlandais seront autorisés à prendre leur vélo dans un TGV dépourvu d’emplacements dédiés, par la magie d’un manager compréhensif. L’astuce consiste en fait à fourguer le vélo dans une housse qui le transforme en bagage banal.
L’anecdote nuit aussi à l’image du vélotourisme en France, qui se développe ces dernières années. Le couple est venu pour faire un bout de la Loire à vélo, un vrai succès. Départements et régions cyclables (DRC) s’en agace d’ailleurs :
Il y a un bât qui blesse avec la SNCF, c’est le transport des vélos à bord des trains. Elle dit que ce n’est pas rentable car cela se fait au détriment des places assises. Nous, nous pensons qu’il y a plusieurs sortes de cyclistes. Le cycliste utilitaire, qui sera d’accord pour aller en vélo à la gare, le laisser, prendre le train et éventuellement un deuxième vélo à l’arrivée, ou un pliant. Le cycliste de loisir pourrait tout à fait remplir les rames hors heures de pointe, quand cela ne gêne personne, avec son vélo. Et le cyclotouriste, qui est parfois un touriste de luxe, avec son vélo à 3 000 euros, n’a aucune envie d’en louer un car il veut son matériel.
On a finalement atterri dans un TER qui reste plus accueillant et souple que les TGV sur le sujet, même si ce n’est pas la panacée, 2 heures de trajet au lieu de 40 minutes. Parfait pour écrire un billet de blog. Quant au retour le dimanche, ce sera finalement le lundi, car tous les TGV acceptant les vélos sont blindés. La SNCF n’allait tout de même pas adapter l’offre à la période de vacances.

A lire sur La Gazette des communes :
« La véloroute, ça rapporte ! »
Politiques cyclables : 10 pratiques inspirantes…ou pas
Sur Le Monde : Un plan pour faire de Paris la « capitale du vélo »
Nous sommes (plus ou moins) Charlie aujourd’hui. Qu’est le pays-de-Voltaire © demain ?
Comme des dizaines de milliers d’hommes et de femmes, je suis allée à République ce mercredi parce que j’étais incapable de faire autrement. Déjà, au bout d’une heure là-bas, quelque chose clochait. Les ballons de lumière s’élevant dans le ciel ne me donnait ni envie de pleurer, ni de faire le grand soir. Touchée, oui bien sur, mais déjà blasée. Gênée un peu aussi parce que je n’ai jamais lu Charlie Hebdo et que certaines de leurs caricatures sur l’Islam m’avaient choquée par leur méchanceté gratuite aux relents racistes, comme la blague d’un vieil oncle bourré en fin de repas.
Au bout de deux heures je suis repartie, après avoir papoté plaisamment une demi-heure avec une ancienne camarade de promo en me disant : “bon ok, et maintenant, on fait quoi ?”
Ce fameux pays qui n’existe pas
Maintenant, je pleure, le lendemain, devant la timeline Twitter qui n’est qu’un flot de message de fraternité, venu du monde entier. Enfin surtout du monde occidental. Pendant ce temps-là, comme hier, comme avant-hier, des massacres aussi lourds que la tuerie de Charlie sont perpétrés dans d’autres pays. Leur tort, outre la loi du mort-kilomètre et surtout de ne pas avoir eu lieu au pays-de-Voltaire ©, vous savez ce fameux pays qui n’existe pas. Oui, c’est vrai, ils tuent là-bas, mais ces pays n’ont pas une longue tradition de valeurs humanistes dont ils auraient ensuite inondé les péquenots sous-développés.
Et si je pleure aussi, c’est pour bien d’autres raisons. Constater qu’il faille qu’on nous mette les doigts dans la prise pour se réveiller. Alors qu’autour de nous, déjà, chaque jour, nous avons des milliers de raisons de pleurer : les prisons taudis criminogènes - “Au total, il a passé une grande partie de sa vie en prison”, constatait une personne qui avait croisé Amedy Coulibaly -, les quelque 600000 vieux qui “vivent” avec 650 euros, “l’accueil” des migrants, si l’on puit employer ces termes, etc. Et je pense à cette chanson de Brigitte Fontaine, Comme à la radio. J’ai mis du temps à comprendre qu’elle parlait de notre indifférence, enfin je crois.
Comme à la radio
Ça ne dérangera pas
Ça n’empêchera pas de jouer aux cartes
Ça n’empêchera pas de dormir sur l’autoroute
Ça n’empêchera pas de parler d’argent
(...)
Et il y a des incendies qui s’allument dans certains endroits parce qu’il fait trop froid
Traducteur, traduisez
Mais n’ayez pas peur
On sait ce que c’est que la radio
Il ne peut rien s’y passer
Rien ne peut avoir d’importance
Ce n’est rien
Ce n’était rien
Tout cela, je le savais, et ma réponse était une abstention politique, en 12 ans de droit de vote, j’ai peut-être glissé une douzaine de bulletins, dont la moitié dans mon village quand ma mère se présentait. Et c’est pour ça que je pleure aussi, de mon abstentionnisme profondément politique, comme, je pense, celui de centaines de milliers de Français-e-s, auquel je ne me vois pas mettre fin. Mais qu’ai-je fait pour changer cela ? Pas grand chose, et avec l’amer sentiment de servir de patch. Les lois ne sont pas faites par les citoyens.
Nous sommes allés sur les mêmes bancs républicains
Je pleure parce que la suite des événements me conforte dans mon envie de rester chez moi ce dimanche. Rachida Dati explique que le parcours des terroristes présumés ne l’intéresse pas. Elle a tort, c’est une des rares questions de fond qui vaille, a fortiori quand on est un-e professionnel-e de la politique, et encore plus une ancienne ministre de la Justice. Je pleure en lisant ces si instructifs parcours, nous avions le même âge, nous aurions pu jouer ensemble dans la cours de récréation de l’école-de-Jules-Ferry ©, une matrice à inégalités. Il est facile et confortable de se proclamer de Charlie. Bien moins des terroristes, qui pourtant, sont aussi allés sur les mêmes bancs républicains. Et je pense à la chanson de Jacques Brel, à ces paroles qui me semblent toujours mystérieuses dans leur paradoxe mais qui me touchent profondément dans ces moments-là où l’humanité semble folle :
Et tous ces hommes qui sont nos frères
Tellement qu’on n’est plus étonnés
Que par amour ils nous lacèrent
Et aussi à cette autre chanson de Brel, Le bon Dieu. Nous ne sommes pas beaucoup mieux, il faut croire.
Mais tu n’es pas le Bon Dieu
Toi, tu es beaucoup mieux
Tu es un homme
Tu es un homme
Tu es un homme
L’école-de-Jules-Ferry © m’a appris une chose : dans la tragédie, les hommes impuissants sont manipulés comme des jouets par des dieux, c’est la "fatalité", il n’y a rien à faire. Là il y aura un jour un procès où on se penchera sur le parcours des accusés pour comprendre comment des hommes qui ont été des enfants ont fini par tuer d’autres hommes au nom d’Allah. Et c’est sans doute plus désespérant que la tragédie de décortiquer les failles de notre société et les issues de secours. Ah non en fait il n’y aura pas de procès.
D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?
Désespérante aussi, écœurante, la récupération politique , alors même que les terroristes couraient encore, que les familles des victimes pleurent encore leurs morts.
Plutôt que de s’écharper sur la présence ou non du FN, la classe politique ferait mieux de faire son examen de conscience sur sa responsabilité dans l’état actuel de déréliction du pays-de-Voltaire ©. On entend déjà dire qu’il y aura un-avant-et-un-après-7-janvier, comme si ce n’était pas un processus continu entamé depuis, depuis quand ? Depuis que les Trente Glorieuses sont devenues Trente piteuses, révélant le profond manque de projet politique, au sens premier du terme ? Depuis que la colonisation ? Les désastreuses opérations militaires menées par les pays occidentaux en Irak, au Pakistan, au Yemen ?
Je ne sais pas. Et je pense à la peinture de Gauguin, D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Et aussi au livre de Marwan Mohammed, remarquable thèse sur La formation des bandes qui se conclue sur l’aporie du modèle de société actuel : consommer, consommer, au nom de l’impératif du point de croissance.

Dimanche, on va donc défiler contre “la barbarie”. J’aime beaucoup cette idée que les extrémistes sont des êtres qui suivent les schèmes de raison du vivre-ensemble © qui vont se dire en voyant les slogans que ah, oui, tiens, en fait, c’est mal de tirer sur des gens.
Pompiers pyromanes
Je n’ai pas envie de défiler aux côtés d’une classe politique qui jouent les pompiers pyromanes, pas envie de défiler aux côtés d’un Premier ministre espagnol qui bafoue les libertés fondamentales, d’un ministre de l’Économie français qui propose comme modèle aux jeunes d’être milliardaire, etc.
Dimanche, et dans les mois qui viennent, nous avons besoin de réfléchir ensemble à la cité où nous voulons vivre. Vite, des ateliers participatifs (troll).
J’ai aussi retrouvé une joie infinie cette semaine, en discutant avec Nicole. En arrivant à notre rendez-vous, elle me lance à propos de la tuerie : “vous avez vu ces jeunes ? Le problème c’est l’école.” Nicole doit frôler les 80 ans mais a une vivacité et un enthousiasme d’adolescente. Ancienne orthophoniste, elle souhaite mettre des fab labs dans les écoles “pour que les jeunes aient des projets”. Elle a déjà une intense activité associative tournée vers les jeunes.
J’ai aussi pensé à la chanson de Barbara, Le soleil noir. La chanteuse y raconte comment elle s’est réveillée en tant qu’Homme, suite au décès du fils d’un de ses amis. Le dernier vers est une longue déploration qui se prolonge, insupportable, comme le chœur des pleureuses dans la tragédie grecques (la vraie) :
Et c’est le désespoir...
Cela pourrait être parfaitement déprimant, c’est en fait très réénergisant si l’on sait qu’elle a ensuite eu une vie de combats, dans l’ombre, jusqu’à la fin, dont certaines chansons témoignaient : Sid’amour à mort, Les enfants de novembre, suite à la mort de Malek Oussekine :
Comme le vent mouvant,
Venus
Du Nord au Sud,
Comme le vent mouvant,
Venus
De l’Est en Ouest,
Franchissant les torrents,
Les coteaux,
Les rivières,
Franchissant les espaces
D’ombre et de lumière,
Comme des milliers d’oiseaux
Qui feraient transhumance,
Comme des milliers d’oiseaux
Sur un ciel d’Espérance,
Regarde-les venir,
Les enfants de lumière.
Les voilà qui avancent
En dansant leur colère.
Ils sont venus pour Un,
Tombé sous la violence.
Ils sont venus vous dire
D’aimer nos différences.
Beaux,
Unicolores,
Multicolores,
Ils sont venus nous dire
De taire nos violences.
Son dernier album contient une chanson intitulé Le jour se lève encore, chantée d’une voix joyeusement brisée. Elle est morte un an après.
—
Quelques lectures :
"Je ne suis pas Charlie. Et croyez-moi, je suis aussi triste que vous."
Charlie Hebdo pas raciste ? Si vous le dites… par Olivier Cyran
if Place de la Toile = delete
Les Internets = triste
end
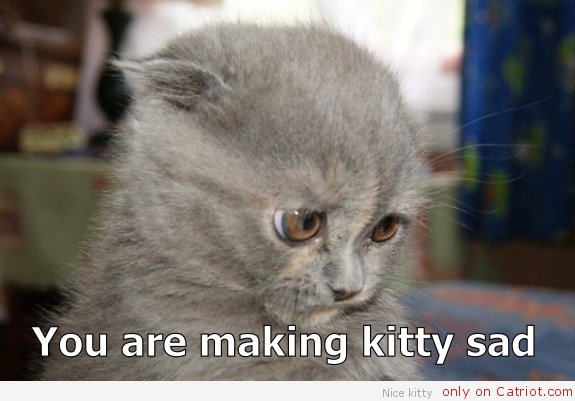
La dernière fois qu’une émision de radio m’a autant ouvert les écoutilles, c’était C’est Lenoir, j’avais 15 ans dans un bled de province, j’en ai 32 à Paris, c’est dire si Place de la Toile va me manquer.
Xavier de la Porte et Thibault Henneton ont cette double culture rare des humanités classiques et numériques, nécessaire pour mettre du recul sur un sujet encore trop souvent relégué dans les rubriques “Economie” ou “Technologie”, et ils savaient inviter des gens avec ce profil. Pour reprendre le titre d’une des émissions, “le numérique, c’est politique”, profondément, au sens noble du terme. Place de la Toile, semaine après semaine, en égrenait les facettes, et me laissait toujours plus perplexe devant le manque de vision politique justement du personnel politique et leur méconnaissance des enjeux. A contrario, pdlt m’a aidée à esquisser ma politique du numérique.
Plusieurs années après, il y a encore des émissions dont je me souviens, leur réflexion m’avait sortie d’une demi-torpeur dans un train ou un canapé un dimanche après-midi. Les voici, malheureusement toutes les archives ne sont pas disponibles, mais sans doutes les Internets répareront cela.
Écrire avec la machine, un entretien avec Jean-Pierre Balpe, écrivain et chercheur qui travaille sur les relations entre littérature et informatique. Si la machine est capable de générer de la poésie, cet art divin, que reste-t-il à l’homme ? Ce sujet m’a laissé en plein désarroi métaphysique devant ma planche à repasser.
L’être et l’écran, entretien avec Stéphane Vial, docteur en philosophie et maître de conférences en design à l’Université de Nîmes. De Proust à Facebook, comment le numérique change la perception. Si on m’avait expliqué la phénoménologie ainsi, je me serais moins enquiquinée en cours de philo l’année du bac.
Des Cisterciens à Google : le regard d’un médiéviste sur le numérique, entretien avec Patrick Boucheron, historien médiéviste. Parce qu’il est primordial de réfléchir l’impact du numérique, et de la technique en général, en le replaçant dans une perspective historique lointaine, pour dessiner les variants et invariants, et nuancer le rebattu “c’était mieux avant Internet, nos jeunes étaient moins bêtes, n’avaient pas une attention de poisson rouge", etc.
A ce sujet, on pourra parfois se consoler de la perte de Place de la toile en écoutant Concordance des temps de Jean-Noël Jeanneney, qui jette régulièrement ce regard historique, bienveillant et approfondi sur le numérique, cf ça ou ceci.
Les trois écritures : langue, nombre, code, entretien avec Clarisse Herrenschmidt, anthropologue, philologue, linguiste et historienne de la littérature. Alors que l’enseignement du code à l’école refait surface en force, poussé par un lobbying du secteur informatique, que certains parlent du langage informatique comme du nouveau latin, il n’est pas inutile de réécouter cette émission.
Au passage, je ne pense pas que ni Clarisse Herrenschmidt, ni Xavier de la Porte, ni Thibault Henneton sachent coder. Pour autant, ils comprennent infiniment mieux les enjeux politiques du numériques que n’importe quel-le ingénieur-e bossant dans une SSII sans âme, ne serait-ce que parce qu’ils se posent la question. Des cours d’éthique du numérique ne feraient pas de mal.
La vie écrite des ados, entretien avec Elisabeth Schneider, enseignante et docteure en géographie et sciences de l’information et de la communication. Quand on cherche un discours un peu subtil sur le rapport des jeunes au numérique, on se tourne souvent vers danah boyd, qui est devenue la tarte à la bonne crème sur le sujet. Elisabeth Schneider est tout aussi délicate dans ses analyses. Et elle n’est pas financée par Microsoft (point troll).
Eh, Place de la toile, le numérique, c’est politique, entretien avec des membres de la rédaction d’EcoRev. Tout est dit. Grâce à cette émission, j’ai découvert André Gorz, un des premiers à faire le lien entre écologie politique et numérique, plus exactement logiciel libre, biens communs, ateliers coopératifs ou communaux, aka fab labs, bien avant que les ministres ne se penchent dessus, et dans les dernières années de sa longue vie, si je pouvais vieillir aussi bien... Bref de quoi continuer de passer des heures en ligne sans mauvaise conscience, vs Jacques Ellul.
L’émission que j’aurais voulu entendre
Place de la Toile soignait sa bande-son mais n’a consacré que très peu d’émissions à la musique. J’aurais adoré en écouter une qui m’explique pourquoi Kraftwerk reste autant d’actualité, 40 ans après : comment ont-ils su rassembler dans une poignée de morceaux ce qui fait l’essence de notre société numérisée ?
Interpol and Deutsche Bank,
FBI and Scotland Yard,
CIA and KGB,
control the data memory !
Computer Welt, 1981.
Préambule à un hackaton autour des données de l’Intérieur
Samedi dernier, la seconde édition français de l’Open Data Day était organisée dans plusieurs villes de France à l’initiative du chapitre local de l’OKFN.
On ne va pas se voiler la face, il y avait une poignée de personnes réunies à Paris, enfin à Montreuil, dont deux journalistes, moi compris. Plusieurs hypothèses :
![]() Les journalistes français se fichent de l’open data et des possibilités qu’il offre d’enrichir leur traitement de l’information et de trouver des informations tout court, voire ne savent pas ce que c’est.
Les journalistes français se fichent de l’open data et des possibilités qu’il offre d’enrichir leur traitement de l’information et de trouver des informations tout court, voire ne savent pas ce que c’est.
![]() C’est les vacances d’hiver, les journalistes français sont au ski.
C’est les vacances d’hiver, les journalistes français sont au ski.
![]() La communication était lacunaire.
La communication était lacunaire.
![]() Il y avait du rugby/les JO/la saison 2 de House of cards à mater.
Il y avait du rugby/les JO/la saison 2 de House of cards à mater.
J’avais prévu de bosser sur les données de l’Intérieur en prévision d’un vrai hackaton entre les deux élections du printemps. Malgré la maigreur des effectifs, la petite équipe constituée a pu avancer.
L’objectif était double :
1/ Cartographier et qualifier les 266 jeux de données actuels : lesquels sont en ligne, utilisés, propres (et vice versa), quel service les produit, car l’administration ne sait parfois pas elle-même où sont les données, a fortiori dans un organisme vaste et complexe comme l’Intérieur, etc.
Cette première partie a été en bonne partie effectuée grâce au travail de Timothée Carry, développeur, merci encore <3. Il a réalisé un script à partir de l’API de CKAN, l’outil utilisé par data.gouv.fr, aidé par Emmanuel Raviart, d’Etalab.
Concernant la qualité des fichiers, ce travail doit être fait à la main, il a été fait très partiellement, sur environ 70 jeux. L’origine des données, et donc le service à solliciter selon le domaine précis de travail – l’Intérieur est une grande maison –, se trouve parfois dans le fichier, le descriptif ou les tags, assez rares.
L’immigration, les élections, la sécurité routière, les services incendie sont les principaux thèmes qui ressortent. Iil serait intéressant de se rapprocher des organes qui produisent les données : SSM Immigration, Intégration, qui fait les stats pour l’Intérieur, l’Observatoire interministériel de la sécurité routière..., qui ont déjà alimenté data.gouv et doivent donc déjà être sensibilisés.
Vous trouverez le résultat ici
Une grande majorité des fichiers sont du .xls et aucune réutilisation c’est indiquée. L’échantillon qui a été scanné de près montre qu’il y a souvent du travail de nettoyage à effectuer derrière, plus ou moins rébarbatif.

J’en ai profité pour demander à Emmanuel Raviart comment marchait l’outil qui permet de noter la qualité des fichiers.
En gros, c’est un module dans C-KAN qui génère une page web mise à jour en permanence, dès qu’un fichier est modifié, des bots y sont abonnés, qui testent plusieurs items : url, fichier joint, tags, etc.
Son point fort, « il existe, la note motive les producteurs », mais il reste encore à améliorer. Quant à l’abondance de .xls, pas très open data, Emmanuel préfère que les fichiers soient publiés tels quels, dans le format de travail de l’administration, car la conversion entraine des pertes de qualité, il fait confiance à la communauté pour repasser derrière.
Ce qui n’est pas faux, le « quick and dirty » a des avantages : quand un fichier est motivant, il se trouve effectivement des volontaires pour travailler dessus, sur les polices municipales par exemple, plusieurs nettoyages dans les jours qui ont suivi, ou dans un autre registre la réserve parlementaire. Mais c’est prendre le risque que certains fichiers potentiellement riches d’informations restent aux oubliettes. L’enjeu selon Emmanuel est que l’État se mette aux logiciels libres et aux formats ouverts, pas faux non plus. On pourrait aussi embaucher en parallèle un peu plus de monde dans les administrations pour mettre d’équerre les fichiers.
2/ Faire une liste de courses
Vu le manque de temps et en l’absence de profils « éditoriaux » (journos, chercheurs, etc.), point mort de ce côté.
Il faudra donc prévoir une seconde session de ce type pour bien préparer le hackaton et maximiser les chances de produire des objets intéressants susceptibles d’embarquer plus de monde dans l’open data et le datajournalisme.
Photo Flickr CC by nc sa @Doug88888 iMémisée.
The LEGO movie : dystopie sécuritaire et utopie DIY
Évidemment, je suis allée voir The LEGO movie, dont l’histoire recoupe mes deux thématiques de prédilection, le DIY, logique, et la sécurité, c’est plus inattendu.
Le personnage principal, Emmet, vit dans une dystopie sécuritaire qui rappelle Fahrenheit 451 : les citoyens vivent dans une illusion de bonheur, gavés de télévision (« I’m on TV, so you can trust me »), aliénés consentis exécutant sans réfléchir leur boulot, sous l’oeil de caméras qui veillent à leur sécurité. Attentifs ensemble !, pour reprendre le slogan de la RATP et le titre du très documenté livre de Jérôme Thorel. « Everything is awesome », reprennent-ils en chœur avant d’aller regarder Where is my pants, un show débile.


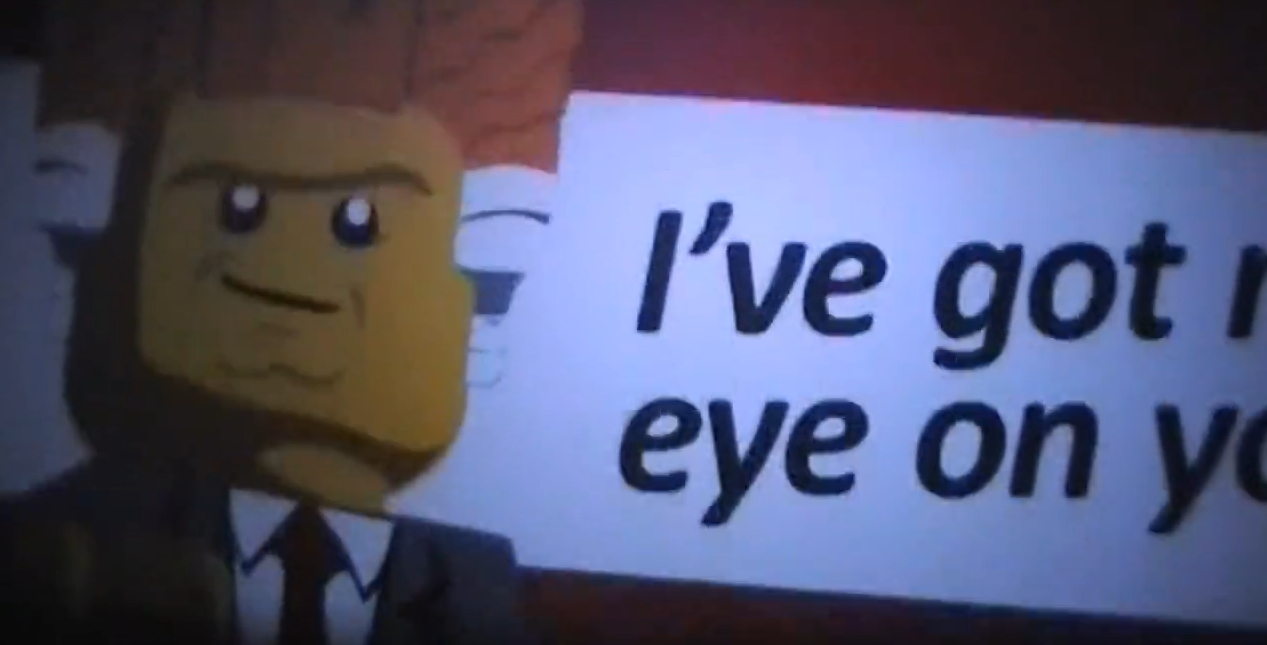
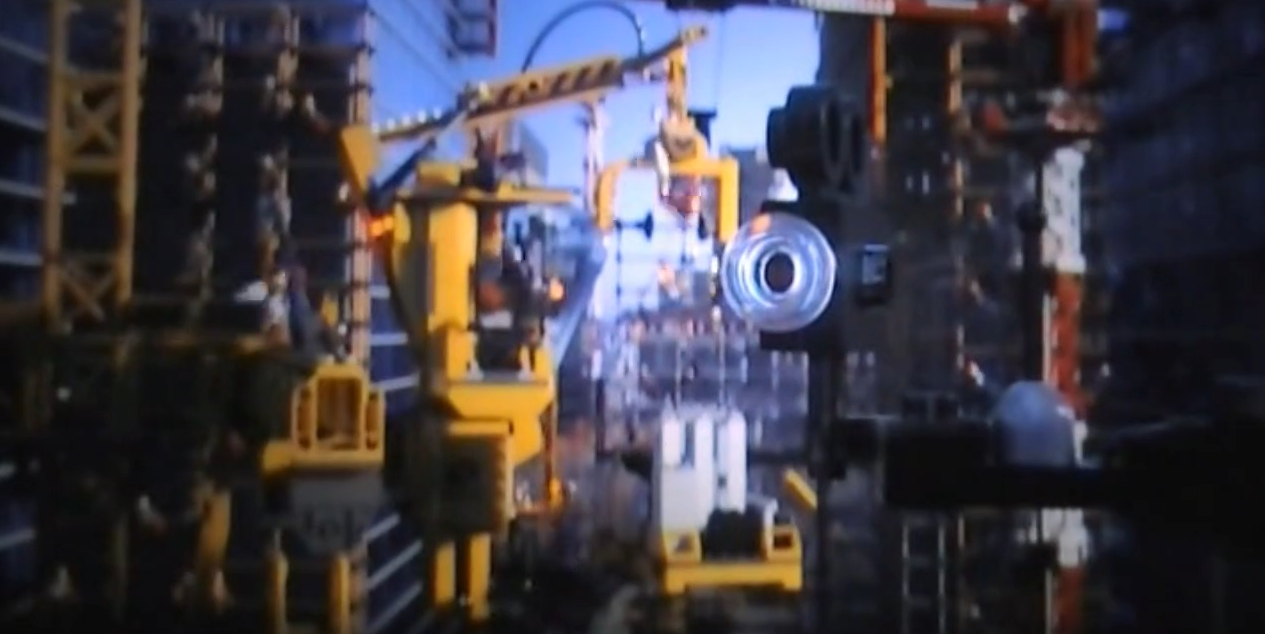
Le vilain du film est un homme d’affaires mégalo qui règne sur un empire industriel, dont une des branches vend de la vidéosurveillance. Les policiers, détournés de leur devoir - servir le bien public -, sont les auxiliaires de son grand projet : maintenir un monde ordonné, où chaque univers LEGO est cloisonné. Les pirates avec les pirates, le Far-Ouest avec le Far-Ouest, etc. Tout l’arsenal sécuritaire de type panopticon est déployé, hélico, traçage GPS, écrans de contrôle, etc.


À la chasse aux gentils LEGO.
Le flic véreux en chef a juste un petit problème : il y a encore en lui un fond de bon policier qui, lorsqu’il ressurgit, a tous les symptômes du policier de proximité/bobby selon la culture de référence :
« Emmet : Look, um... I watch a lot of cop shows on TV... Isn’t there supposed to also be a— ..Isn’t there supposed to be a good cop !?
Bad Cop : Oh yes. But we’re not done yet. [switches head]
Good Cop : Hi, buddy ! I’m your friendly neighbourhood police officer ! Would you like a glass of water ?
Emmet : Yeah, actually that sounds—
Bad Cop : Too bad !! »


Tout le film se fait le chantre de la créativité chère au monde du DIY, je ne vous spoile pas la fin. Les LEGO sont livrés avec un mode d’emploi qui est fait pour être détourné, les boîtes mélangées, en laissant libre court à sa créativité. N’importe qui a un potentiel créatif, tel est non seulement le leitmotiv mais aussi le moteur du scénario. « Les instructions », comme dit Elmet, sont valorisées à un seul moment, quand il s’agit de se mettre en mode collaboratif pour mieux accomplir une œuvre qui dépasse l’individu, comme une mise en abyme du film. Un discours aussi sympathique que compatible avec les affaires de la marque danoise.
Les associations reconnues d’utilité publique au tamis de l’analyse de données
Entre le fromage et la bûche, on s’est fait un petit hackaton de couple de nerds (rien de sexuel) avec Julien Kirch sur un fichier de data.gouv, qui vient de faire peau neuve et donne enfin envie de fourrer son nez dedans. J’ai pris un fichier pas très sexy d’apparence, pour voir ce qu’il était possible d’en tirer, celui des associations reconnues d’utilité publique (ARUP). Il s’agit des données de septembre, et non la dernière MAJ qui vient tout juste d’être publiée, ça ne change pas grand chose. Je pensais pouvoir me débrouiller toute seule, en fait il a fallu appeler mon dév’ à la rescousse.
Réservée aux associations loi 1901, la reconnaissance d’utilité publique obéit à un certain nombre de critères dégagés « par la pratique administrative » : « un but d’intérêt général », « une influence et un rayonnement suffisant », « un nombre minimum d’adhérents », « la tenue d’une comptabilité », « une solidité financière tangible », « des statuts de l’association qui apportent des garanties », « une période probatoire de fonctionnement d’au moins 3 ans ». Elles bénéficient en retour de la possibilité de recevoir des donations et des legs, en plus des dons manuels et d’une crédibilité certaine conférée par ce label. Le fichier sur data.gouv en recense près de 2000
Géolocalisation
Première possibilité d’exploitation, géolocaliser les ARUP. Cela peut donner des idées à des personnes qui ont envie de soutenir une association locale. Problème : le fichier est cracra, l’adresse se vautre sur cinq colonnes, le nom de l’association sur deux, cap’ et bas de casse mélangées.
Un petit script plus tard (et des biscuits de Noël lorrains pour récompenser la bête de code), c’est exploitable, il ne reste plus qu’à se crever les yeux quelques heures pour remettre (à peu près) d’aplomb les majuscules car tout le texte a été passé en bas de casse pour simplifier. Ce n’était peut-être pas le choix optimale mais c’est fait, et ça donne l’occasion de nettoyer au passage une poignée de doublons. Le texte indiquant l’objet de l’association est aussi sale, apparemment il s’agit de celui communiqué par les associations, sans corrections, je l’ai laissé tel quel quasiment, trop long à mettre en bon français. La colonne date de reconnaissance d’ARUP était aussi présentée de façon hétéroclite, seules les années ont donc été conservées pour des questions pratiques.
Cette présentation est une invitation à explorer les objets des ARUP, et à s’interroger sur la relativité de la notion d’utilité publique et son évolution diachronique. Le fichier ne précise malheureusement pas si les associations sont toujours en activité, on trouve de temps à autre des indications imprécises du type « AG va se réunir le 22/01/1999 en vue de se prononcer pour la dissolution » ou encore « Etude, recherche et conservation des documents, monuments et objets d’art historiques du Forez. Le maintien de la RUP pourrait être conditionné à une plus grande transparence comptable », sans que l’on sache la suite donnée.
Prises à la volée, quelques exemples d’ARUP qui peuvent étonner :
![]() L’association de propagande pour le vin, RUP 1930, ne semble plus exister. En 1964, elle publiait encore « des placards publicitaires recommandant de boire du vin aux repas : « Adolescents, adultes, vieillards : de 0,7 5 à 2 litres par jour suivant votre activité et le travail que vous fournissez. » [source]
L’association de propagande pour le vin, RUP 1930, ne semble plus exister. En 1964, elle publiait encore « des placards publicitaires recommandant de boire du vin aux repas : « Adolescents, adultes, vieillards : de 0,7 5 à 2 litres par jour suivant votre activité et le travail que vous fournissez. » [source]![]() Alliance nationale population et avenir, RUP 1913, dont l’objet est d’« attirer l’attention de tous sur le danger que la dépopulation fait courir à la nation française et provoquer l’adoption des mesures propres à accroître la natalité. » Cette très droitière association existe toujours.
Alliance nationale population et avenir, RUP 1913, dont l’objet est d’« attirer l’attention de tous sur le danger que la dépopulation fait courir à la nation française et provoquer l’adoption des mesures propres à accroître la natalité. » Cette très droitière association existe toujours. ![]() la maison d’accueil et de retraite du canton de Précy-sous-Thil, pour mémoire les ARUP doivent en théorie avoir « une influence et un rayonnement suffisant et dépassant, en tout état de cause, le cadre local ».
la maison d’accueil et de retraite du canton de Précy-sous-Thil, pour mémoire les ARUP doivent en théorie avoir « une influence et un rayonnement suffisant et dépassant, en tout état de cause, le cadre local ». ![]() Le Yacht club de France, qui a plein de rois et reines en membres d’honneur.
Le Yacht club de France, qui a plein de rois et reines en membres d’honneur. ![]() Association la renaissance française culture solidarité francophonie, objet « Resserrer les liens entre l’Alsace la Lorraine et la patrie retrouvée regrouper les bonnes volontés en vue de travailler à la grandeur de la France. ». Elle existe toujours, mais ses objectifs actuels ont évolué depuis que la patrie a été définitivement retrouvée.
Association la renaissance française culture solidarité francophonie, objet « Resserrer les liens entre l’Alsace la Lorraine et la patrie retrouvée regrouper les bonnes volontés en vue de travailler à la grandeur de la France. ». Elle existe toujours, mais ses objectifs actuels ont évolué depuis que la patrie a été définitivement retrouvée. ![]() une tripotée d’association d’anciens élèves.
une tripotée d’association d’anciens élèves.
Quelles catégories ?
Deuxième idée, dans quelle catégorie sont classées ces ARUP et certaines sont-elles plus prégnantes selon l’époque ? Problème : les catégories ont l’air avoir évolué, il en existe onze actuellement (« philanthropique, social, sanitaire, éducatif, scientifique, culturel ou doivent concerner la qualité de la vie, l’environnement, la défense des sites et des monuments, la solidarité internationale ») mais le fichier en indique une trentaine dont certaines se recoupent.
Un second script plus tard, cela donne ceci (scroller) :
Et cela, les catégories mineures (moins de 15 occurrences) ont été retirées pour une lecture plus aisée :
On voit une forte augmentation du nombre d’ARUP après la Première Guerre mondiale dans le domaine de l’éducation/formation et de la santé. Pour la première catégorie, il s’agit pour beaucoup d’associations d’anciens élèves, pourquoi, mystère et bulles de gomme. Concernant la seconde, on trouve pas mal d’associations luttant contre les maladies respiratoires et en particulier la tuberculose, une plaie de l’époque à laquelle les pouvoirs publics s’étaient attaqués. Elle fait d’ailleurs de nouveau surface, crise oblige. Des préoccupations hygiénistes plus générales, teintées parfois de morale, sont également présentes.
Les années 70 sont celles de la montée en puissance de l’attention portée aux animaux, avec le déploiement d’antennes locales de la SPA, et à l’environnement.
Et pour anecdote, la première ARUP remonte à 1690, l’Académie de Villefranche-en-Beaujolais, une donnée qui parait bizarre, je ne pensais pas que la RUP était si ancienne et mes recherches ont été infructueuses pour éclaircir ce point.
Wordle
Enfin, on peut dégrossir les buts poursuivis par ces ARUP dans le temps grâce à des Wordle. Il a été fait à la truelle, cela mériterait un travail de regroupement des termes, etc, je délègue ça à un gentil thésard :)
1820-1840

À l’époque, agriculture, sciences et arts sont dans un même package. Est-ce la traduction de l’idéal de l’honnête homme, là encore il faudrait se tourner vers un historien pour en savoir plus.
Société d’émulation agriculture, sciences et arts de Bourg/« S’occuper des sciences, lettres et arts et particulièrement d’agriculture. »
La même dans un autre coin : Société nationale d’agriculture, sciences et arts/ « Associer tous les propriétaires ruraux, fermiers ou industriels domiciliés ou ayant leurs propriétés dans l’arrondissement de Douai. »
1910-1930

Au menu, de l’aide pour les enfants et les malades, hygiène et morale allant parfois de pairs :
Œuvre des pauvres malades secourus à domicile/« Secourir et soigner chez eux les malades indigents et leur porter assistance physique et morale. »
Le secours de l’enfance/« Conserver au pays, des enfants nombreux, sains et vigoureux ; seconder matériellement et moralement l’effort du service municipal des infirmières - Visiteuses de l’Enfance. »
Idem version anciens élèves :
Association des anciens élèves de l’école alsacienne/« Etablir un centre commun de relations amicales entre ses membres, venir en aide aux anciens élèves ayant besoin d’assistance, faire œuvre de bienfaisance envers des enfants pauvres méritants. »
1960-1970

Donc nos animaux :
Société protectrice des animaux de Bordeaux et du Sud-Ouest/« Défendre les animaux maltraités, recueillir les animaux errants et leur procurer nourriture et gîte, soigner les animaux trouvés blessés et malades sur la voie publique, leur trouver un nouveau maître, propager dans le public la bonté envers les animaux. »
Œuvre d’assistance aux bêtes d’abattoirs (OABA)/« Assister, défendre et protéger par tous les moyens appropriés que permet la loi les animaux destinés à la boucherie ou à la charcuterie à l’équarrissage ainsi que les bêtes de basse cour et par extension tous les animaux. »
2000 - 2013
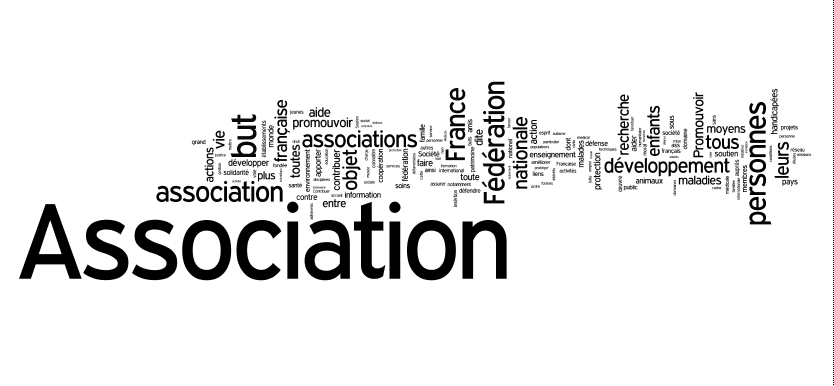
Sur les tags fédération et enfants, un sujet de préoccupation constant :
« Fédération nationale enfants et santé/La fédération a pour objet de fournir aux associations affiliées coordination, appui et force dans les actions décidées par son conseil d’administration et son assemblée générale conformément aux présents statuts. »
Fédération et développement, ce dernier terme témoignant de l’intérêt pour le malheur hors de nos frontières (cf aide au développement, pays en développement, etc, un vocabulaire récent). Au début du siècle, il est à entendre uniquement au sens de « faire progresser » (par exemple : « Développement de l’instruction professionnelle, protection des apprentis et des enfants. »)
« Association planète urgence/Participer à des actions de solidarité internationale et de protection de l’environnement permettant l’implication de la société civile dans les efforts de la solidarité et du développement international. »
Vidéosurveillance : les bons conseils d’Alain Bauer sont tombés dans l’oreille d’un sourd
Ce jeudi, Arrêt sur images a consacré son débat à la vidéosurveillance, j’y suis intervenue en compagnie d’Alain Bauer, Dominique Legrand, président de l’association nationale de la vidéprotectionde (AN2V), un lobby de la vidéosurveillance, et de mon ancien confrère d’Owni Jean-Marc Manach. Un échange fort instructif puisqu’il a permis d’apprendre qu’Alain Bauer, présenté comme le M. Sécurité de Nicolas Sarkozy,, président de la commission nationale de la vidéosurveillance de 2007 à 2011, une période où les caméras de voie publique étaient grassement subventionnées, n’a rien pu faire contre ce déploiement qu’il juge lui-même déplorable :
Alain Bauer : « Je suis d’accord pour dire que les caméras sont mal placées, que les analogiques ne servaient à rien et que la quasi-totalité du parc, jusqu’au plan vidéo de Paris, la seule exception connue jusqu’à présent, a été installée dans les conditions les plus ahurissantes qui soient.
Peut-être serait-il mieux dépensé si on installait les caméras intelligemment et en fonction d’une cartographie qui tient à peu près la route. […]
Le problème, c’est qu’aujourhui aucune étude n’est scientifiquement fiable, pas plus celle de l’IGA, une commande politique visant à justifier tout et d’ailleurs le changement de ministre amène l’IGA à dire aux gens l’inverse de ce qu’elle disait à l’époque. »
Daniel Schneidermann : « À une époque à laquelle vous aviez l’oreille de Nicolas Sarkozy et des ministres de l’Intérieur successifs… »
Alain Bauer : « Oui et j’ai moi-même dit que le rapport de l’IGA était à mettre à la poubelle, moi je souhaitais un rapport qui soit fait par Tanguy Le Goff et Eric Heilmann (cataloguées comme “opposants” ndlsb), qui a été commandé par la commission nationale de la vidéosurveillance, un budget a été voté, mais l’appel d’offre n’a jamais abouti pour des raisons que je ne connais pas moi-même. […]
Levallois, on a installé des caméras, on s’est demandé après à quoi ça pouvait servir, c’est le contre-exemple absolu de gaspillage parfait et ça a été la référence historique. »
Daniel Schneidermann : « Vous avez dit tout ça au ministre de l’Intérieur ? »
Alain Bauer : C’est pour ça qu’il l’a fait (le plan vidéo de Paris), le préfet de police de Paris, Michel Gaudin, qui était avant le directeur général de la police nationale, il a tiré les conclusions des plans précédents qui étaient des plans quantitatifs, il fallait mettre des caméras pour mettre des caméras, selon la méthode Levallois. La RATP, avec Alain Caire (ancien directeur de la sécurité, ndlsb), a eu la même pratique. »
Les opposants aux caméras fustigent son côté « Big Brother », il me semble qu’au contraire, le problème c’est que ce n’est pas Big Brother, sinon leur utilité ne serait pas en débat et on pourrait parler de vidéoprotection sans tomber dans la novlangue. En revanche, la vision des caméras du futur évoquée par Dominique Legrand a de quoi faire frissonner :
« La grande idée serait que la caméra indexe ce qu’elle voit, ça va poser des problèmes potentiels, je dis bien potentiels, d’aspects liberticides. La caméra code ce qu’elle voit, elle code une personne de forte corpulence, de grande taille, gros, un Noir, un Blanc, à lunettes. On l’a bien vu avec l’affaire de Berck et du tireur de Libération, ces personnes étaient des citoyens tout à fait « normaux » une heure avant, il est impossible de les encrypter dans les caméras au préalable. »
On imagine mal le Conseil constitutionnel valider un tel système, de même qu’il a censuré le fichier des « honnêtes gens ».
Alain Bauer a aussi martelé que l’emploi du terme « vidéoprotection » ou « vidéosurveillance » n’avait rien à faire avec le fait qu’on était pour ou contre cet outil, mais que c’était une distinction, inscrite dans la loi, entre système dans l’espace public et dans la sphère privée. Pourtant, sur le site même de l’Intérieur, on trouve les deux termes :
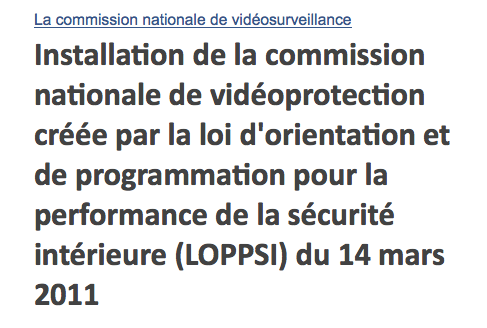
Bon le meilleur, c’était à la fin, la discussion est partie en vrille, avec la mise en accusation de Facebook, ce qui est, me semble-t-il, un autre débat que le sujet de fond autour des caméras, la prévention de la délinquance et les politiques sécuritaires, cf cet article de Manhack. Le propos, jusqu’à présent précis, se fait flou comme une discussion entre le fromage et la buche à Noël :
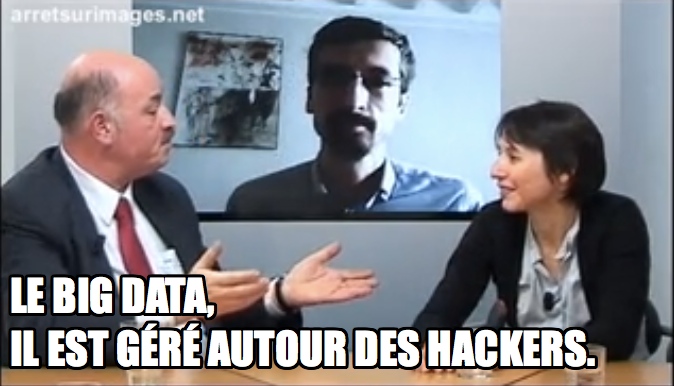
Soit deux mots à la mode dans une phrase qui ne veut rien dire, bref, je grimace en protestant, ce qui a énervé Alain Bauer, il a estimé que je lui parlais mal et me qualifie de « journaliste militante », procédé classique pour disqualifier un contradicteur. J’ai surtout creusé un peu plus que lui le sujet des hackers, mais c’est un détail.
Un « flic de supermarché » héros d’un téléfilm sur la surveillance
La semaine dernière, France 2 a diffusé Surveillance, un téléfilm qui traitait de mes marottes journalistiques, vidéosurveillance et sécurité privée (merci au blog 83-629 de l’avoir signalé). Adapté d’un roman de Régis Serange, Flic de supermarché, cette fiction renvoie à une actualité bien réelle, pour peu qu’on supporte le jeu médiocre des acteurs, des invraisemblances de scénario XXL et une réalisation plate.
Déjà, Pierre, le héros, est au départ un simple vigile, « un flic de supermarché » comme lui jette à la figure son supérieur après qu’il a outrepassé ce que son statut l’autorise. Si vous connaissez d’autres œuvres dont le personnage principal exerce ce boulot ingrat, je suis preneuse de références. C’est un prolo de la surveillance, comme il en existe des dizaines de milliers en France, exerçant dans une zone commerciale sinistre (voir Le grand soir à ce sujet, sur un registre plus LOL, avec déjà les images de caméras de vidéosurveillance intégrées dans la réalisation). Il fait ce boulot non par choix mais pour pouvoir enfin avoir son appartement et récupérer la garde de son fils : « et ça te plait comme boulot ? », lui demande Léa, la jolie caissière. « C’est du boulot », répond-il.
Pierre est un de ces agents de sécurité privée (ASP) dont l’Etat a besoin pour répondre aux besoins sociétaux de sécurité, conviés à participer à la « co-production de sécurité » depuis la LOPS de 1995, mais qui restent invisibles. Vous dites souvent bonjour aux ASP de votre supermarché ? D’ici quelques années, leur nombre dépassera pourtant celui des policiers et gendarmes. Ils étaient quelques milliers au début des années 80, ils sont aujourd’hui environ 160 000 contre 240 000 policiers et gendarmes.

Pierre, le héros, au début de la fiction, fait le sale boulot : il amène dans le bureau du directeur de la sécurité (François Berléand, en roue libre dans le rôle du salaud, as usual) un couple qui a vole. « Objectif 0 démarque ! », Pierre se prend au jeu.

Mais il reste un subalterne comme un autre, un petit surveillant lui-même surveillé par les caméras qui quadrillent le supermarché où il bosse. « Oh tu te crois sur l’île de la tentation », s’entend-il dire à l’oreillette alors que son regard s’attarde sur Léa.

Même quand il fait son boulot, il est sous l’oeil des caméras. Bon, il outrepasse déjà un peu-beaucoup ses prérogatives : un ASP n’a pas le droit de prendre en poursuite et de plaquer au sol comme il le fait des voleurs présumés.

Promu à « l’aquarium », le centre de supervision, Pierre est initié au visionnage par le chef de la sécurité en trois minutes. Cette scène semble anodine, elle renvoie pourtant à un problème souligné par le chercheur Tanguy Le Goff, entre autres : le manque de formation des opérateurs de vidéosurveillance et le regard discriminant qu’ils portent. « Tiens suis-moi le blackos, lui lance son chef, après l’avoir fait zoomé sur une fille. Tu te rendras vite compte que les mecs qui volent n’ont pas la gueule de l’emploi tu as les retraités bien habillés, les mères de famille, les mômes, les riches les pauvres, tout le monde vole. »

Son chef lui montre alors son aquarium privé, qui filme même les endroits où les caméras ne sont pas déclarées. Il découvre ainsi que ses ébats dans la réserve ont été filmés. Toilette, vestiaire, rien ne lui échappe. « C’est légal ? », demande naïvement Pierre. « Lé-quoi ? » ironise son chef. Voilà qui rappelle une décision récente de la Cnil, qui a mis en demeure le Leclerc de Bourg-en-Bresse pour « surveillance excessive » : « 240 caméras dont 180 sont destinées à la surveillance du centre commercial. Les 60 autres sont installées aux caisses de l’hypermarché et filment les caddies et les articles scannés.
La Présidente de la CNIL a jugé que ce dispositif était disproportionné au regard des principes Informatique et Libertés du fait de son ampleur et dans la mesure où il filme les accès aux toilettes, aux vestiaires, au cabinet médical et aux salles de pause des salariés. Il permet également de placer des salariés sous surveillance permanente alors qu’ils se situent à leur poste de travail. Elle a également constaté que contrairement à ce qui avait été indiqué à la CNIL, ce dispositif était utilisé pour contrôler les horaires des salariés puisque certaines séquences vidéo extraites du dispositif concernent des salariés au moment de leurs pointages. »
Flatté des responsabilités qu’on lui passe, Pierre accepte de fliquer un délégué syndical, qui finit par se suicider. Photos, caméras, micro, tout y passe, même l’ordi, comme ce salarié n’a pas eu la chance d’assister à un café vie privée. Un épisode qui rappelle l’affaire d’espionnage-harcèlement par Ikea. Un syndicaliste CGT avait été particulièrement ciblé.

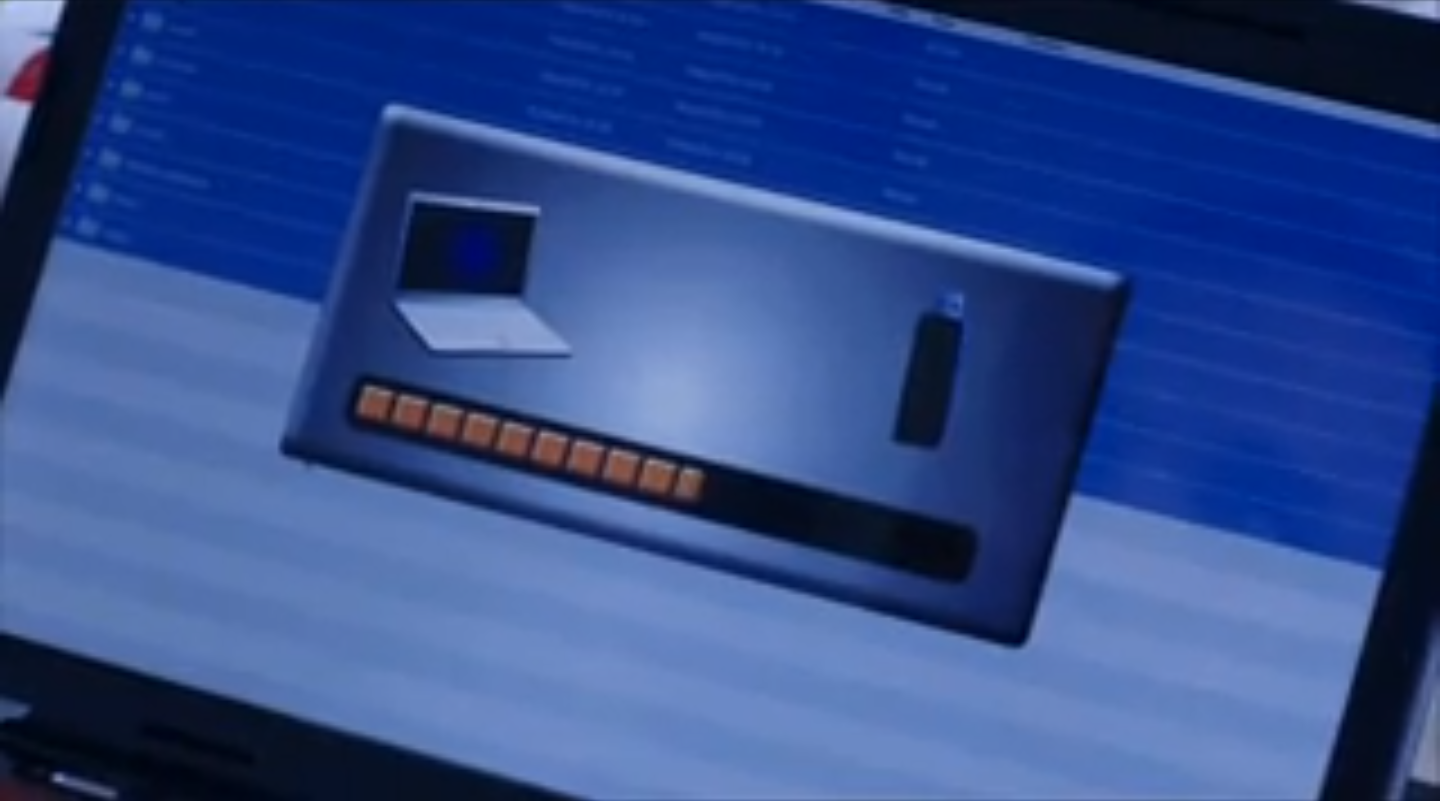

A la fin, la morale est sauve, le petit fliqueur fliqué flique les fliqueurs en chef et démonte leur trafic.

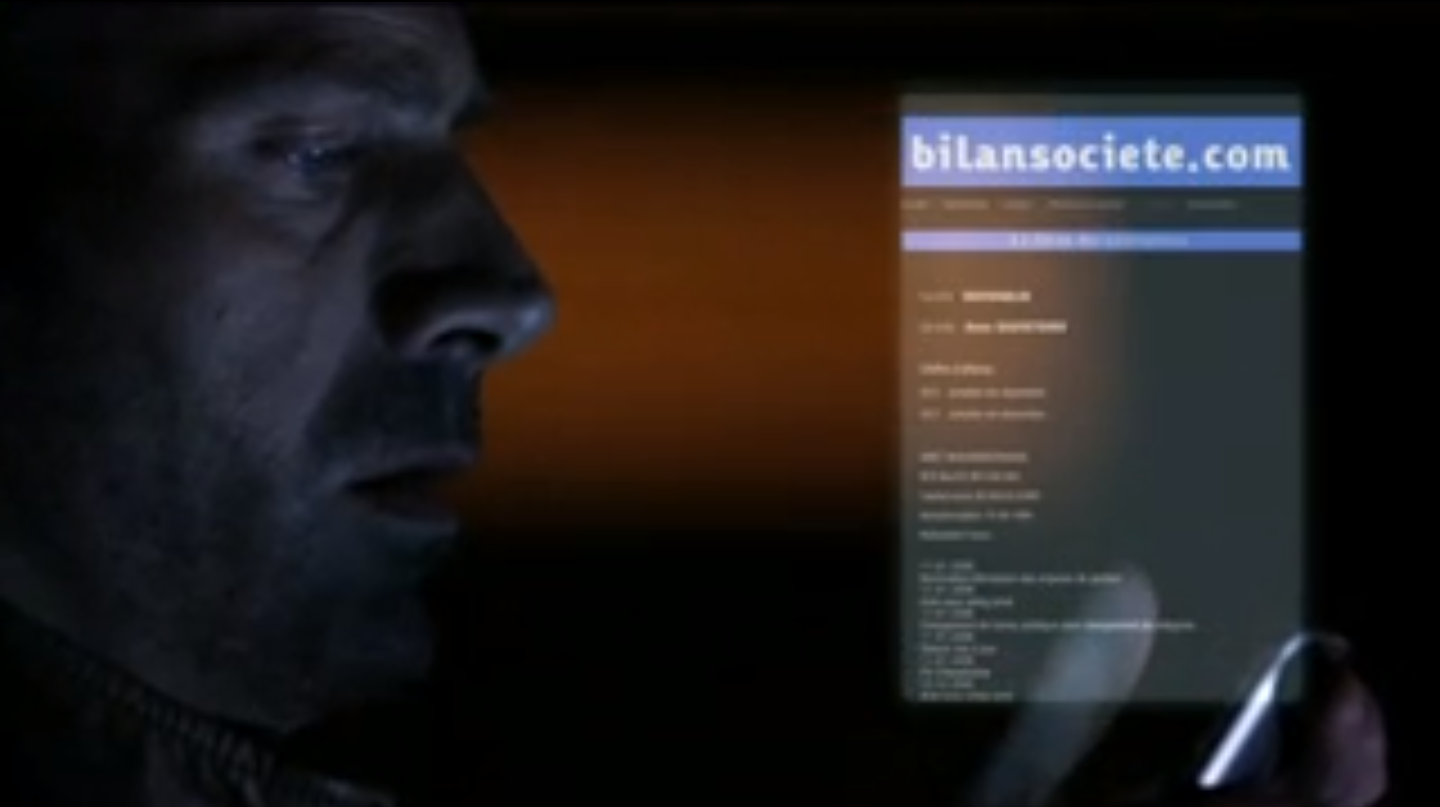
Maker Faire Rome : formater la révolution
La semaine dernière, Rome accueillait la première Maker Faire d’envergure européenne, l’occasion de voir enfin à quoi ressemblent in situ ces énormes foires aux bidouilleurs nées aux États-Unis. L’ensemble m’a laissé l’impression d’une de ces foire-expo sans âme : grande, truffée de monde, si bien qu’on crawlait pour avancer, une machine à cash bien rodée à 6 euros le sandwich riquiqui + demi de bière. Maker Faire est une licence qui se monnaye et qui requiert de respecter des guidelines longs comme un jour sans chocolat. On est loin d’un joyeux bordel organisé.
Un des participants regrettait qu’il ait dû réaliser à l’arrache une vidéo présentant son projet et un site pour avoir le droit de postuler. Les heureux élus makers payent leur voyage et leurs frais sur place. Tant pis pour les inventeurs/bricoleurs sans le sou et pas très versé dans la communication. Ceci dit, vu le nombre de projets commerciaux présentés, c’était somme toute donnant-donnant. Je suis même tombée sur un courtier en brevets qui s’étalait sur trois stands. Maker Faire ratisse large, trop, parce que sa bannière de rassemblement l’est : maker.

Tu la sens ma révolution ? Roland DG Corporation avait un énorme stand pour montrer ses machines-outils.
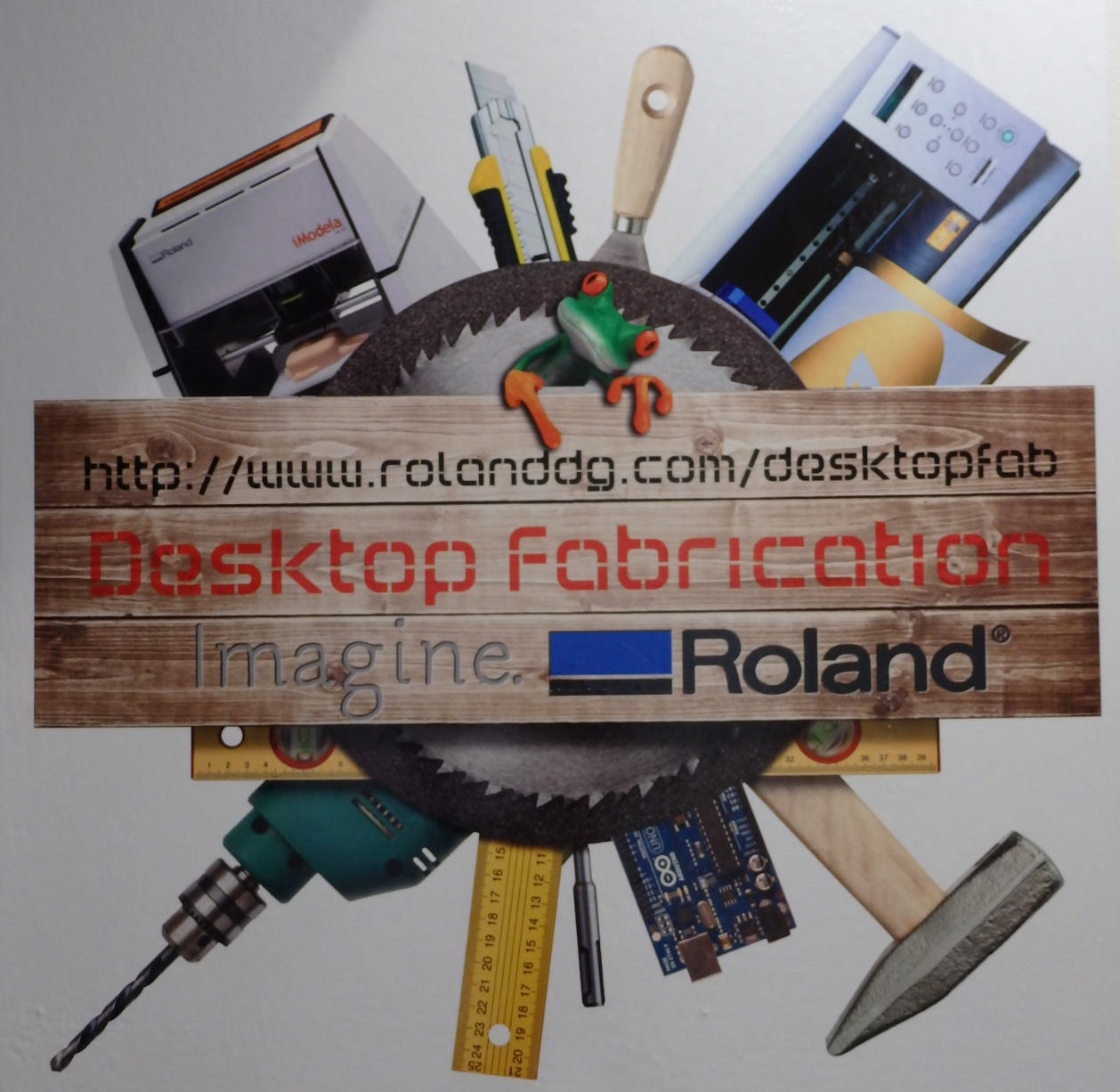
Le business était un des grands sujets de conversation, la chambre de commerce était même partenaire, rêvant de redorer son économie grâce à des myriades de start-ups créatives honorant la patrie de Léonard de Vinci et d’Olivetti, des Arduino en pagaille.
Une demi journée était même consacrée au business des makers, baptisée TechGarage, avec ce sempiternel mythe du gus dans un garage qui devient un entrepreneur à succès.
Tout ce discours passerait bien mieux si Maker Faire n’avait justement la prétention de « refaire le monde » (sic). Mais le concours opposant dix start-up en mode Star Academy avec vote du public et insupportable musique de show américain, 4 minutes top chrono de Power Point mal foutu présenté par des jeunes gens propres sur eux en jean-basket-chemise donnait l’impression opposée : les recettes sont vieilles, les aspirations rances.
Si le mot open source revient souvent dans les bouches, peu de projets commerciaux font ce choix. Et certains, comme MakerBot ou UltiMaker surfent dessus sans respecter la règle du jeu. Dommage d’avoir oublié que les gus dans les garages des années 70, ceux qui créèrent les PC, partageaient leurs connaissances. Mais est-ce possible de quitter le garage pour changer le monde et devenir très riche en restant un gus, that is the question.
Entre deux slots de Power Point, Meet Quin, le CEO de Qtechknow, une boutique en ligne d’électronique, est venu parler de sa réussite. Son ambition ? Rester CEO et avoir son staff. Il va d’événement en événement pour « se faire des relations d’affaires » (entre autres, hein, il aime vraiment l’électronique). Petite précision : Meet Quin a 12 ans (ci-dessous).

La grande annonce de l’événement a été le partenariat entre Intel, nouveau grand ami des makers, et Arduino, accueillie parait-il par un silence glacial. Ceci dit, la communauté de MakerBot avait aussi rué dans les brancards en apprenant que l’entreprise fermait en partie son produit. Cela n’a pas empêché la firme de se faire racheter 400 millions de dollars par Stratasys, un des poids lourds de l’impression 3D pour professionnels.
Le côté gadget de certains projets, aussi sophistiqués soient-ils, m’a également laissée perplexe. D’un côté, cela illustre de nouveau le hiatus entre l’ambition et la réalité des pratiques. Utiliser toutes ces neurones pour faire des objets sans réelle utilité, quel gâchis en ces temps de crise ! D’un autre côté, faut-il laisser tomber le simple plaisir de la créativité comme fin en soi, la performance technique, voire technico-artistique ? Il ne faut pas oublier que les hackers du MIT qui révolutionnèrent l’informatique n’aimaient rien tant que le hack pour la beauté du hack. Émerveiller des gamins, c’est déjà beaucoup.

Un homme-robot lors du spectacle donné le vendredi.
L’impression 3D, la reine
Les imprimantes 3D étaient surreprésentées et il fallait bien cela pour répondre à la curiosité d’un public qui, souvent, en voyait pour la première fois une en vrai, tripotant, admiratif, les petits objets de plastique disposés sur les tables.
Fatiguée de lutter pour avancer, abrutie par le bruit, j’ai finalement passée une bonne partie du dimanche au stand d’Emmanuel Gilloz, le créateur de l’imprimante open source pliable RepRap. Une expérience très intéressante. Les questions du public se résumaient à :
![]() « Combien ça coûte ? » « six cents euros, seicenta euros, six hundreds euros, not dollars. »
« Combien ça coûte ? » « six cents euros, seicenta euros, six hundreds euros, not dollars. »![]() « Où puis-je en acheter une ? » Les cartes de visite sont parties comme des petits pains.
« Où puis-je en acheter une ? » Les cartes de visite sont parties comme des petits pains.
Mais très rarement : « à quoi ça sert ? ». Les gamins étaient comme fous, la lueur dans les yeux de certains parents n’avaient rien à envier à celles des mômes. « E bello ! »
Tout cela m’a fait penser à une conférence de Ted Nelson, un des pères de l’hypertexte, prononcée lors de la première Computer Faire (foire aux ordinateurs) en 1977. Intitulée « Ces deux inoubliables prochaines années », elle anticipe déjà la récupération de l’idéal hacker qui a donné naissance au PC, pour développer une industrie classique :
« Pour le moment cependant, les petits ordinateurs fonctionnent d’une manière assez magique. Ils provoqueront des changements dans la société aussi radicaux que ceux provoqués par le téléphone ou l’automobile. Les petits ordinateurs sont là, vous pouvez les acheter avec votre carte de crédit et parmi les accessoires disponibles vous trouverez les disques de stockage, des écrans graphiques, des jeux interactifs, des tortues programmables qui dessinent sur du papier de boucherie et Dieu sait quoi d’autre encore. Tous les ingrédients pour créer de l’engouement sont ici réunis. Les ordinateurs sont en passe de devenir cultes et le marché des consommateurs sera bientôt mature. Engouement ! Culte ! Marché ! Tout le monde va se précipiter. La machine américaine de fabrication de publicités va s’emballer. La société américaine va sortir de sa bulle. Et les deux prochaines années vont être inoubliables. »
Make participe de ce discours incantatoire selon lequel l’imprimante 3D est la prochaine révolution, prête à débarquer dans nos foyers. J’aime bien le discours d’Emmanuel, qui tout entrepreneur qu’il soit, ne cherche pas à refourguer ses machines à tout le monde : pour lui, il faut équiper à l’échelle du quartier.

Le contraste avec le festival de hacking OHM, qui a eu lieu cet été, a été bien plus fort que ce que je ne pensais. Si l’on part du principe que ces deux événements sont représentatifs de la composition des deux communautés hacker et maker, chacune présente bien des particularités, en dépit des ponts évidents. J’avais quitté OHM comme on laisse une autre planète, mi-éberluée, mi-inquiète en me replongeant dans la « civilisation ».
Même si le milieu du hacking ne sent plus toujours très bon, comme en témoigne la polémique sur le sponsor Fox-IT, listé dans les Spyfiles, il reste bien plus subversif, à la marge. Et la discussion vive qui s’est emparée du camp dans Noisy Square, événement dans l’événement, sur cette polémique, en témoigne : ici on parle de politique, au sens premier du terme, on se pose des questions, quitte à faire voler en éclat pour la prochaine édition l’équipe. Alors qu’à Maker Faire, on ne polémique pas trop, tout est cool, tout le monde il est un maker et vous êtes great !!!!
Le débat vif sur le financement de Make par DARPA, l’agence de recherche du Pentagone, éclos l’année dernière, a tourné court. Il y a bien le hacker Mitch Altman, figure historique de l’open hardware, qui s’est retiré avec fracas de Make, sans susciter de grosse scission. Pour lui, cette alliance a corrompu l’esprit initial :
C’est à ce moment que cela a commencé à porter davantage sur l’argent et moins sur la communauté qui rendait Make et les Maker Faire si incroyables au début. Maintenant, il n’est question que de Radio Shack (une entreprise américaine qui vend de l’électronique, ndsb) et de Disney (sponsor de Maker Faire New York 2013, ndsb), et apparemment de l’argent de quiconque en donne, ainsi qu’un focus plus important sur la vente.
Le climat général de cette Maker Faire ne doit pas occulter qu’on y a aussi vu des projets open source superbes, portés par des gens qui voient plus loin que le bout d’une levée de fonds : Bionico, une prothèse qui coûte 100 euros, Libratoit, la maison de John Lejeune, un vieux de la vieille des bidouilleurs français, etc.
Mais que retiendront ces milliers de familles qui se sont frottées là pour la première fois à cet univers ? Que vont-elles faire et dans quel but ?
À lire aussi le billet d’Amaelle(sans ¨ sinon tu passes pas le contrôle à Beauvais), beaucoup plus nuancé que le mien et pédagogique aussi. Ne serait-ce que pour les projets de Bruce Sterling que les non-alignés s’appuient sur l’open source hardware pour maintenir leur souveraineté. Ce qui fait écho à la victoire que le pays avait remporté sur l’industrie du pétrole grâce au logiciel libre.
Lobby mâle-machine
Les Trophées de la sécurité privée font partie de ces événements où un microcosme se donne à voir sans complexe, à tu et à toi. Je me suis glissée lundi soir à leur huitième édition, qui avait lieu au Casino de Paris. Le milieu de la sécurité privée est très hétérogène, du petit vigile de supermarché payé au lance-pierre au directeur de sécurité d’un grand groupe. Ce soir, l’ambiance était plutôt haut-de-gamme.
Une exception : la musique qui rappelait les pires heures d’un mariage de cousin lointain : Le Freak, c’est chic, Barry White, BO de Pulp fiction, Rita Mitsouko, en musique d’annonce, soulignée par des jeux de spots. Le tout contrastant avec les costumes du noir au gris souris en passant par l’anthracite et le bleu marine pour les plus audacieux. Une « soirée unique » avec « une mise en scène spectaculaire », qui a rempli le parterre soit 1 000 personnes environ.
La soirée comptait dans ses sponsors et partenaires les poids lourds habituels du secteur : syndicats patronaux siégeant au collège du Cnaps, un tout nouvel organisme mixte chargé de réguler la profession : USP, SNES, GPMSE... ; directeurs de sûreté/sécurité : CDSE, ARSIS... ; des boîtes : Veolia, Siemens...
Présence du délégué interministériel à la sécurité privée
Au premier rang, aux côtés de Claude Tarlet, le président de l’USP, étaient assis des représentants de l’Etat : le préfet Jean-Louis Blanchou, délégué interministériel à la sécurité privée, et Jean-Yves Latournerie, directeur du Cnaps (mais pas son président Alain Bauer). Il m’a semblé aussi voir Elisabeth Sellos-Cartel, adjointe à la DISP en charge de la « vidéoprotection » (en théorie. Ou alors elle a des problèmes pour gérer les mails des journalistes).
Jean-Louis Blanchou n’est pas à la tête de la DISP par hasard : il a été directeur de la sûreté et du management des risques d’Aéroport de Paris, administrateur du CDSE, ce qui fait qu’il « connait tout le monde, et ça [lui] facilite la tâche ». Et accessoirement, il a été condamné à une peine de 1000 € d’amende pour mise en danger de la vie d’autrui en 2010, suite à une altercation sur une autoroute.
La « co-production de la sécurité » avance
Cette présence traduit l’avancée de la notion de « co-production de la sécurité » depuis qu’elle a été introduite en 95 par Pasqua dans la LOPS. En résumé, le risque est devenu multiforme, poreux, le développement des espaces privés accueillant du public en masse (centres commerciaux, stades, etc) a aussi engendré de la délinquance. Pour répondre à cette nouvelle donne, il faut la « sécurité globale », un concept qui a fait florès après les attentats du 11 septembre. Comme l’Etat ne peut satisfaire toutes les demandes des citoyens pour lutter contre l’insécurité/sentiment d’insécurité, il doit déléguer et plus encore gérer la délégation.
La loi fondatrice de 83 devrait être revue l’année prochaine, comme l’a rappelé AEF Sécurité globale (ex - AISG) en introduction - bilan de l’année écoulée. Cette agence de presse spécialisée fait partie du groupe AEF, qui est détenu par Raymond Soubie, l’ancien conseiller social de Nicolas Sarkozy. A la fin de la soirée, l’animateur de la soirée a demandé à Denis Fortier, le directeur de l’AEF, s’ils allaient faire « plein de communiqués demain ». Il a répondu en riant qu’ils feraient des dépêches « en toute indépendance, comme d’habitude ».
Sur la refonte de la loi de 1983, qui devrait arriver inch’allah au Parlement début 2014, Jean-Louis Blanchou a indiqué les points qui faisaient consensus : élargissement du champs des activités mais aussi coopération avec les forces de l’ordre. Claude Tarlet a clos le chapitre d’un « rien n’est figé », guère engageant.
Marché en hausse
On a aussi appris que le marché se portait mieux, avec un CA en hausse de 2,5% en 2012 pour la prévention-sécurité, selon un « confidentiel » tout frais de l’AEF, et que « tout ce qui a trait aux solutions technologiques marche bien ». Manuel Valls et ses forces de l’ordre 3.0 fantasmées dans le cadre des devoirs de vacances du gouvernement ne diront pas le contraire.
Les débuts du Cnaps ont également été évoqués, pour dire que la machine fonctionne bien dans l’ensemble, même si les délais de délivrance des cartes sont longs parfois. Ça marche même trop bien au goût de Guy Roulleau, président de Samsic Facility : « Lâchez un peu les grandes entreprises, on a déjà le fisc, la médecine du travail..., occupez-vous des petites entreprises », bref là où se concentre les problèmes notoires du secteur (travail au noir, entre autres). Il est vrai qu’en 2009, la SNCF n’a pas été pointée du doigt pour avoir fait travailler une entreprise dont certains salariés étaient sans-papiers.
Vient ensuite la présentation du jury, où l’on retrouve Dominique Legrand, le président de l’association nationale de la vidéoprotection (AN2V), un lobby de la vidéosurveillance très actif auprès des collectivités, Eric Delbecque, présenté comme « l’intellectuel » car il dirige le Département Sécurité Economique de l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ, ex IHESI), un think tank public qu’une partie de ce petit milieu a fréquenté comme auditeur, voire plus, Alain Juillet, le président du CDSE, membre du Cnaps en tant que « personnalité qualifiée », etc. Alain Juillet a regretté qu’il n’y ait pas assez de femmes - 2% ? 3% ce soir ? - : « On va y arriver peu à peu, elles font ce métier aussi bien que les hommes. »
Histoire de convaincre la gente féminine que le milieu est sympathique, Jo Querry fera une fine plaisanterie. Jo Querry est un ancien grand flic qui est devenu responsable de la sécurité du groupe Accor, et il a été accusé d’avoir comploté contre DSK : « Que les féministes me pardonnent, j’aurais choisi une autre personne que Nafissatou Diallo, je n’aurais pas pensé qu’elle plairait à DSK. » Rires gras comme un paquet de chips dans la salle.
La remise des trophées a commencé par le titre de « meilleure innovation d’un grand groupe, d’une PME ou d’une start-up ». La présentation de chaque candidat était faite par Richard Olszewski, conseiller délégué à Roubaix et Lille Métropole, qui avait semble-t-il lu le dictionnaire des citations avant de préparer son texte. Par exemple : « les ennuis, c’est comme le papier toilette, on tire une feuille, il en vient plusieurs. »

Le « robot mobile de surveillance » de la société Eos innovation, équipé d’une caméra.
Hypervision, panomorphisme, surveillance en continu
Ce premier prix a été l’occasion de disserter sur une des antiennes de la soirée, le couple homme-machine. L’avenir est aux solutions « globales et intégrées, mi-humain, mi-technologique », à la « surveillance en continu, souple et adaptable », qui participe à l’« hypervision », le début d’une « nouvelle ère ». Par exemple les caméras de Fujifilm font du « panomorphisme », en clair des images elliptiques. La société Vigie aviation a aussi été nommée, pour ses petits avions équipés de caméras qui filment en temps réel, et capable de passer sur certains territoires où les drones ne passent pas. Pour le moment, l’entreprise est plutôt orientée surveillance de la nature.
Dans cette optique, Siveillance™ Fusion de Siemens, « la solution conviviale pour améliorer et centraliser la sécurité de votre infrastructure en toute sérénité », une « technologie de pointe pour une sécurité globale », a été saluée comme « la passerelle vers le business de demain », .
Mais attention, « la technologie ne remplacera jamais l’homme, à qui il restera toujours l’analyse ». A se demander pourquoi on parle de vidéosurveillance intelligente. Peut-être parce qu’il faut « changer leur business model pour gagner encore plus d’argent » ?
Querelles de syndicats
Un clip de promotion de l’ANAPS a été diffusé ensuite. L’ANAPS est une alliance de syndicats patronaux lancés l’année dernière, entre autres poussée par le ministre de l’Intérieur qui voulait un interlocuteur unique. Une des images montre d’ailleurs Manuel Valls aux côtés de Claude Tarlet, se réjouissant de cette création. Claude Tarlet a pris la tête de l’ANAPS, ce qui n’a pas arrangé les relations avec le SNES, le grand rival, qui accuse l’ANAPS d’être un hydre bouffeur d’identité, une émanation de l’USP. Ce qui n’est pas faux puisque, comme le notait le blog 83-629 (à suivre si la sécurité privée vous intéresse), « sur 11 organisations, 4 sont issues directement de l’USP ! Donc l’ANAPS c’est pratiquement 40% des "organisations" adhérente issues de l’USP "pure" ! Les autres sont tellement spécifiques dans un pan de la sécurité privée, qu’elles n’ont aucune représentativité sur le sujet de la surveillance humaine, qui est le "moteur principal" du monde de la sécurité privée ! »
Le représentant du SNES a redit au micro qu’il garderait son autonomie. Ça n’empêchera pas l’ANAPS de faire ce pour quoi elle a été créée : « du lobbying, c’est indispensable, il faut être capable demain de peser au Parlement si des amendements ne vont pas dans le sens des entreprises. » Interrogé ce mardi au salon APS, Claude Tarlet m’a expliqué qu’il avait déjà « un cercle de parlementaires ».

Claude Tarlet, le président de l’USP, le principal syndicat patronal
On a entendu aussi beaucoup le mot « incivilités ». La Poste a par exemple été nommée dans la catégorie « meilleur projet d’une direction sécurité d’une entreprise, d’une ville ou d’une administration publique » pour son action contre ces « incivilités ». La sociologue Carole Gayet-Viaud explique très bien dans cette interview les origines de ce terme fourre-tout, qui, comme la vidéosurveillance, est décliné à droite comme à gauche. Elle relève au passage : « les institutions qui accueillent du public (La Poste, les mairies, Pôle emploi) ont une responsabilité. L’association d’usagers de la ligne 13 vous dira que la possibilité d’être civils commence par celle de ne pas se monter les uns sur les autres dans le métro. »
Les vols de câbles, « un des grands maux de notre société aujourd’hui »
Il a aussi été question des vols de câbles, « un des grands maux de notre société aujourd’hui », selon Richard Olszewski. Pas la faim, pas la maladie, pas le suicide.
A noter qu’il y avait un trophée « meilleure démarche sociétale et citoyenne » (sic), remis par Eric Delbecque. « Il y a des gens qui disent que je suis un garçon détestable ». Pour montrer qu’il a de l’humour, Eric Delbecque a cité Audiard : « Un intellectuel assis va moins loin qu’un con qui marche ». Et puis il a imaginé qu’Alain Juillet était Lino Ventura dans Les tontons flingueurs.
En conclusion, la sécurité de demain a été évoquée, avec des dynamiques membres du Club des Jeunes Cadres en Sûreté (CJCS) et Pierre-Antoine Mailfait, ancien commissaire, secrétaire général de l’USP, co-organisateur d’un colloque d’où sortira l’important Livre blanc de 2008 sur « la participation de la sécurité privée à la sécurité générale en Europe », préfacé par Nicolas Sarkozy.
Les drones sont revenus sur la table, qui « génère de l’emploi, a rappelé Denis Fortier, la législation est favorable, il existe un tissu de start-ups, c’est un marché gigantesque. Mais la France a dû acheter des drones américains ».
Un vrai espoir pour le redressement durable.
Le politique, le fardeau du white hacker

Ce billet est né des échanges sur la pelouse de OHM, une canette de bière à la main, avec Amaëlle Guiton et Pierre Alonso.
Laissera-t-on un jour en paix les hackers ? Il est fort probable que non, et plus encore après ce qui s’apparente à un tournant pour la communauté : le scandale des écoutes de la NSA. C’est ce qui ressort des échanges lors de Observe Hack Make (OHM), le grand rassemblement de hackers qui a eu lieu début août aux Pays-Bas, et en particulier à Noisy Square. Cet événement dans l’événement a été organisé suite à la polémique sur le principal sponsor de OHM, Fox-IT, une boite qui fait de l’interception de communication et qui était listée dans les Spyfiles de WikiLeaks. L’auteur y décrivait ce qu’il considère comme une schizophrénie de la scène hollandaise : d’un côté brandir les mêmes valeurs que leurs prédécesseurs « techno-anarchistes », de l’autre bosser pour des boîtes qui font l’inverse exact. Il concluait sur un appel :
« Alors s’il vous plait, efforcez-vous de savoir qui vous êtes vraiment et quel est votre camp. Reconsidérez ce qui se passe dans le monde autour de vous. Parlez du rôle que nous y jouons. Définissez votre identité. Et, à la fin, si vous voulez encore vous appeler un hacker, laissez le renard dehors. »
« Si vous êtes apolitique, vous aidez l’ennemi. »
Une antienne reprise lors du discours de clôture de Noisy Square, intitulé « Ethics and Power in the Long War ». L’hacktiviste Eleanor Saitta exprimait le point de vue d’une partie de la communauté :
« Pendant longtemps, ça a très bien marché, tu sais, je ne veux pas vraiment être politique, car j’aime juste triturer du code, c’est très amusant, et je n’ai pas vraiment de temps pour la politique car je passe treize heures par jour à regarder le code du shell et le socialisme prend trop de temps. C’était génial pendant un temps, mais on ne peut plus être apolitique.
Car si vous travaillez sur la sécurité, si vous faites du développement et que vous êtes apolitique, alors vous aidez la structure centralisée actuelle. Si vous travaillez dans la sécurité et que vous êtes apolitique, vous travaillez certainement pour une organisation qui existe en grande partie pour appuyer des entreprises et des structures de pouvoir existantes. [...] Si vous êtes apolitique, vous aidez l’ennemi. »
Voilà donc toute la communauté obligée de porter l’immense fardeau du white hacker : sauver notre démocratie « en déclin », pour reprendre l’expression d’un des intervenants du Great Spook Panel. Tous hacktivistes en somme.
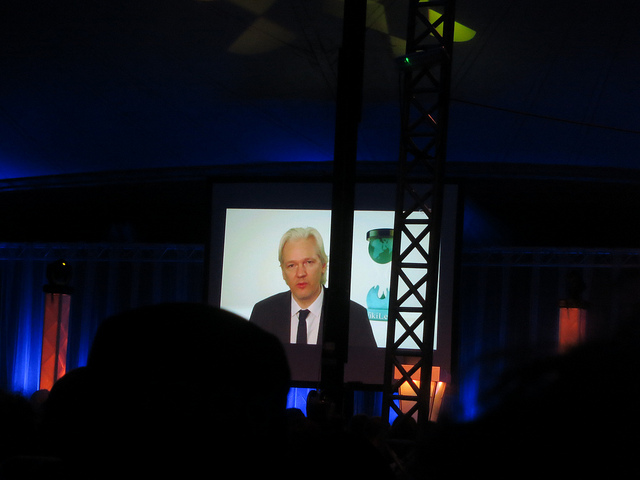
Conférence par Skype (!) de Julian Assange lors de OHM.
Engouement médiatique pour l’hacktivisme
A cette pression participent bien sûr les journalistes qui suivent avec attention et bienveillance la communauté. Je me souviens d’avoir eu le sentiment d’une immense bouffée d’oxygène politique, au sens noble de l’adjectif, en me plongeant dedans : ça bouillonne dans tous les sens, tous les domaines, bien au-delà de la sécurité informatique hardcore. Les possibles me semblaient de nouveau ouverts avec ces nouveaux magiciens.
L’actualité a fourni au milieu une formidable vitrine qui a contribué à faire évoluer son image. Même les JT ont parlé des actions de Telecomix en soutien aux révolutions arabes. La Quadrature du Net est devenue l’interlocuteur incontournable sur les libertés numériques, en particulier après la médiatisée victoire contre ACTA. On a vu ONG et activistes se rapprocher de cette communauté.
Le programme de OHM est frappant, qui laisse la part belle aux whistleblowers et son corollaire technique (sauf à passer par la bonne vieille boîte aux lettres), la sécurisation des échanges sur Internet. Et les médias ont accordé une attention certaine à ce phénomène.
Rien à foutre
Sauf qu’une partie des hackers en a sans doute rien à foutre, voire trouve ça plutôt chouette d’envoyer en taule Manning et Snowden en prison, comme le montre la réaction d’une partie des hackers à Black Hat lors de l’intervention du général Keith Alexander, le chef de la NSA : des applaudissements. Et oui, on peut être un hacker et un patriote de base. La légende Peiter “Mudge” Zatko n’a-t-elle pas rejoint DARPA pour empêcher d’autres WikiLeaks ? De ce point de vue, il est étonnant de voir des hackers tourner maintenant le dos au gouvernement américain avec des airs de vierge effarouchée.
On peut aussi être juste un(e) adepte des challenges techniques ravi(e) de bien gagner sa vie en s’éclatant et/ou bien un bon père/bonne mère de famille qui fait son taf sans se poser de question. Des gens ordinaires quoi, hormis leur appétence technique en dehors des sentiers battus, qui ne pensent pas du tout, contrairement à Annie Machon, qu’« on a tous un petit whistleblower en soi ».
Lors du débat « What’s the matter with the hackers these days ? », une participante a expliqué que son copain bossait chez Fox-IT et qu’ils n’avaient pas l’impression de mal agir. Et les voilà sommés de prendre position.
« Je me demande seulement si ce n’est pas prêcher des convaincus », s’interrogeait Patrice Riemens, un « dinosaure » de la scène hollandaise, comme il se décrit. « Il faut politiser les techniciens, m’expliquait Kheops de Telecomix, le risque c’est le cynisme et l’individualisme : on m’a retiré mon jouet, je prends un VPN et basta. ». Lui-même reconnait avoir eu une phase de doute après les grosses opérations du collectif dans les pays arabes, avant de reprendre le bâton de pèlerin, moins enthousiaste mais plus solide.
Eleanor Saitta n’a pas nié la difficulté de l’entreprise, ni les conséquences sur la communauté :
« Cette guerre a des coûts réels. Elle n’est pas gratuite, elle n’est pas facile. Elle induit des coûts à de nombreux niveaux. Elle a des coûts pour notre communauté. On parle de peut-être faire de Noisy Square le prochain OHM. De mener le prochain camp hollandais dans quatre ans. Si cela arrive cela scindera vraiment la scène hollandaise. »

Episode 1, Stallman, épisode 2 Noisy Square ?
L’intensité déjà bien réelle des débats, au point qu’un des organisateur d’OHM en a pleuré, semble révélatrice à la fois des enjeux mais aussi d’une certaine image que le milieu a de lui-même. Noisy square clamait « putting the resistance back in OHM », comme en référence à un âge d’or d’une conscience politique du hacking. De ce point de vue, la création du mouvement du logiciel libre en 1984 est peut-être ce qui se rapproche le plus du tournant à l’œuvre à l’heure actuelle : c’est en réaction à la fuite des hackers du laboratoire d’IA du MIT dans des boîtes lucratives de logiciel propriétaire que Stallman lance le mouvement. Mouvement qui résume le logiciel libre à « liberté, égalité, fraternité », et se place donc sur le terrain moral et non pas technique. Les deux étant bien entendus liés quand il s’agit de pouvoir trifouiller dans un logiciel pour voir si des backdoors ne se planquent pas.
Pourtant si on remonte l’histoire moderne du hacking, on constate que les premiers hackers du MIT n’étaient pas du tout politisés : peu leur importait que l’argent qui leur permettait de donner libre court à leur passion était celui des militaires. Il faudra attendre la guerre du Vietnam pour qu’une seconde génération de hackers, sur la côte californienne, teinte le terme d’une connotation politique, tendance libertarienne. C’est eux qui donneront naissance à l’ordinateur personnel à la fin des années 70 qui fut pensé comme un outil d’empowerment, à une époque où ordinateur était synonyme de machine de mort utilisée par l’armée.
L’éthique hacker qui se dessine alors est politique, imprégnée de l’idéologie de l’époque :
« L’information devrait être libre et gratuite.
Méfiez-vous de l’autorité. Encouragez la décentralisation. »
Objet sociologique flou
Le flou de l’objet sociologique « hacker » complexifie encore la question. Quittant la sphère de la sécurité informatique pure et dure, le terme a pénétré tous les champs, décliné à l’envi, jusqu’à la nausée. Élargissement légitime mais aussi affadissement parfois. Quel point commun entre un Aaron Swartz, un Mitch Altman ou bien un Jacob Appelbaum et quelqu’un qui va faire du Arduino le week-end ? Le phénomène induit une extension du périmètre des personnes concernées par le débat : c’est le revers de la médaille de se dire hacker à tout bout de champ, ou d’en voir partout.
Au fond, plus que les seuls hackers, c’est l’éthique des codeurs dans leur ensemble qui doit être examinée, mais les écoles qui les forment ne semblent guère s’en soucier pour le moment.
Peut-être verra-t-on à l’avenir apparaitre un logo « code éthique », comme pour le chocolat ou les vêtements ou une clause « usage non militaire » ?
Photos Flickr CC by nc nd Walt Jabsco, by sa mlcastle, by frederic.jacobs.
— -
À lire aussi :
Take me OHM d’Amaëlle Guiton qui a écrit un livre sur les hacktivistes très recommandable, garanti NSA-proof.
Et sans doutes Lines in the sand : which side are you on in the hacker class war, sur Phrack.
Ils ont hacker de parler aux médias
Ancilla Tilia a 28 ans, elle est sexy en diable et elle pourrait être leur copine. Annie Machon a 45 ans, elle est british en diable et elle pourrait (presque) être leur maman. La première est une ancienne playmate qui défend désormais les libertés numériques pour Bits of freedom (résistons à la tentation du jeu de mots de mauvais goût). La seconde est une ancienne du MI5, le service des renseignements intérieurs, qui a démissionné en 1996 pour dénoncer les dérives des espions de sa Majesté. Ces deux sacrées nénettes ont donné deux sessions de média training à des hackers dans le cadre de Observe Hack Make (OHM), un énorme rassemblement de hackers qui a eu lieu la semaine dernière aux Pays-Bas.
La scène était assez touchante, imaginez une trentaine de gars (+ trois filles) dans autant de mètres carrées, buvant les paroles de leurs prof d’un jour : « soignez votre apparence, c’est 95% de ce que les gens retiennent. » Faut-il pour autant renoncer à la barbe et au tee-shirt orné d’une blague obscure, à chacun de jauger, en fonction de son interlocuteur. Ou encore « le message, pensez au message », « donnez un point de vue : "les gens sont surveillés sur Internet, c’est intolérable" », « parlez comme à votre petit cousin », etc.
Quand le temps est venu de s’exercer, les mains tremblaient un peu, la voix, parfois, s’est faite hésitante. En face, Ancilla et Annie faisaient leurs remarques avec bienveillance, sans moquerie.
Went to media training w/ @ncilla and @AnnieMachon today at #ohm2013. Great fun, and thanks to both of you for the wonderful advice !! :)
— Sander Venema (@VenemaSander) August 3, 2013
Au-delà de la jolie image, ces sessions sont révélatrices d’une certaine prise de conscience : comme la technique a des conséquences profondes sur la santé de la démocraties, comme les révélations sur la surveillance des communications par la NSA l’ont exposé aux yeux du grand public, il est nécessaire d’avoir des interlocuteurs pédagogues pour expliquer les enjeux.

Annie Machon à OHM. Flickr by frederic.jacobs
Le Chaos Computer Club, maitre ès coups de comm’
Le Chaos Computer Club l’a compris depuis longtemps, qui a su s’imposer comme un interlocuteur légitime et écouté auprès des médias et des politiques depuis 30 ans. Ils sont même assez doués pour les opérations spectaculaires : conférence de presse pour annoncer le détournement de 134000 DM en exploitant une faille du Minitel allemand, démonstration en direct à la télévision d’une faille de sécurité d’un programme de Microsoft utilisé pour faire des paiements, vol et publication des empreintes digitales du ministre allemand de l’Intérieur Schaüble en plein débat sur la carte d’identité biométrique, etc.
Profitons-en pour démonter un cliché sur les hackers, un de plus : ils n’aimeraient pas trop les journaliste. En réalité, à partir du moment où l’on fait correctement son boulot, l’échange se passe très bien. Je m’attendais à un milieu fermé en commençant à travailler sur le sujet, c’est le contraire. Ils sont dans l’ensemble accessibles, à l’exception de quelques grosses figures du milieu, mais cela tient sans doute davantage à un manque de temps. Les journalistes doivent aussi payer les événements comme un visiteur « lambda », et c’est pas plus mal.
Ce sentiment général est faussé par le fait que ceux que l’on peut croiser dans des événements comme OHM ont envie de s’extérioriser, a fortiori les organisateurs et speakers.
Il a bien entendu quelques individus qui crachent sur les journalistes, par principe, considèrent que leur parler, c’est être récupéré, mais cette attitude existe dans d’autres communautés. Tant pis pour eux.
Il est en revanche exact qu’une partie refuse les photos. Comme plein de parents d’élèves, qui me semblent en comparaison infiniment plus pénibles. Couvrir la rentrée scolaire pour le canard local s’apparente à un petit challenge si une autorisation générale pour les photos n’a pas été mise en place par l’école. Ce qui n’empêche pas lesdits parents d’élèves d’exhiber les photos de leurs marmots sur Facebook, contrairement aux susnommées hackers.
OHM en vrac

Observe Hack Make (OHM) a rassemblé la semaine dernière environ 3 000 hackers, makers et sympathisants de la cause dans un immense camping posé au milieu d’un champs batave. Voici quelques impressions sur le vif. Pour des analyses plus poussées, c’est ici ou bien encore là.
1-Un événement foisonnant
On sort de OHM avec un sentiment mi-figue mi-raisin : c’est géniaaaaal/hannnn j’ai loupé trop de trucs/c’est le bordel dans ma tête, j’arrive pas à décanter.
Le programme était riche, trop peut-être. Permettre à tout le monde de faire une présentation, un atelier ou une performance est un choix respectable mais qui génère un sentiment de frustration. De plus, entre proposer quelque chose et avoir du public en face, il y a parfois une différence vu le nombre d’activités en parallèle.
Il serait peut-être préférable d’organiser plus d’événements moins denses. Cela éviterait des budgets énormes qui conduisent à accepter des sponsors douteux, comme ce fut le cas à OHM avec Fox-IT, une boite listée dans les Spyfiles.
2-Le fardeau du white hacker
La question des choix éthiques des hackers a été au cœur de Noisy Square, l’événement dans l’événement organisé suite justement à la polémique sur Fox-IT, avec pour slogan « Putting the resistance back in OHM ». Billet à venir après la phase de décantage.

3-Le hack général
J’ai compris les 3/4 des intitulés des conférences, c’est signe que le hack contamine tous les champs de la société, bien au-delà de la sécurité informatique. Le terme est-il en train de se diluer/d’être dénaturé/récupéré à force d’être décliné à toutes les sauces, ou est-ce au contraire bon signe ? Ou OSEF ?

4-Queer as folk
Il y avait parmi les 3 000 participants une proportion certaine de gens drôlement barrés, flirtant parfois avec la poésie. Cette folie douce qui baignait le camp ne sauvera pas le monde, mais elle fait du bien. Il est dommage qu’il n’y ait pas plus d’endroits où l’on puisse se trimbaler en slip ou en peignoir à fleurs sans qu’on vous scrute en songeant appeler les flics. Ici c’est même l’inverse : je me suis sentie limite déguisée avec ma robe à fleurs de sage jeune femme.
Le queer sexuel en particulier était bien présent. Je ne sais pas si c’est un effet des récents débats sur le sexisme chez les hackers, et/ou si la société hollandaise est plus tolérante. On pouvait croiser des mecs en jupe ou en justaucorps et un débat queer et féminisme a été improvisé à la tente de La Quadrature du Net par exemple.
Bref queer as folk, ce que résumaient avec humour les guidelines :
« OHM2013 is an event for every weirdo in our community. It is not acceptable to make others feel unwelcome because they are shy, silly, weird, socially awkward, British, nerd, gay, unicorn, extravagant, android, male, female, of ethnic minority, hipster, religious, vegetarian, autistic, alien from outer space, artistic, bohemian, hippy, misguided, heterosexual, badly dressed, photo-shopped, American, green, soft-packing or otherwise (non-)average. »

5-John Gilmore, tout simplement
John Gilmore, c’est un peu un ponte de l’informatique qui a pris sa retraite anticipée de Sun Microsystem pour faire ce qui lui chante, comme co-fonder l’EFF, un chèque à six zéros à la clé, se faire l’apôtre du cypherpunk à une époque où la privacy n’était pas un débat public, et qui maintenant prône la légalisation des drogues.
Une légende de la contre-culture californienne qui passe pourtant à côté de vous, invisible, pose sa tente, vous offre de la pastèque avec une infinie douceur et se fait faire les ongles par les petits gars de La Quadrature du Net. Et puis disparait comme il est venu, sans faire de bruit. On n’est pas obligé d’être d’accord avec sa ligne politique très libertarienne, mais il est impressionnant.

Photo by nc quinnums
6-Bach et Chopin go to hacking
Même si le concert de Kimiko Ishizaka était très logique, quand s’est élevé Bach puis Chopin de son piano à queue devant 400 hackers, 800 à la fin, dans un chapiteau planté au beau milieu d’un champ aux Pays-Bas, ben il y avait des frissons dans la salle.

Lamba Labs : la reconstruction en partage
 Atelier de poterie. Crédit Bilal Ghalib.
Atelier de poterie. Crédit Bilal Ghalib.
Chantier, reconstruire, la métaphore du bâtiment vient immédiatement à l’esprit pour évoquer le hackerspace de Beyrouth, Lamba Labs, créé en 2012 : « build up stuffs », l’expression revient sans cesse dans les propos des membres, comme un écho évident à cette ville aux mille grues, d’où les gratte-ciel flambant neufs surgissent de terre comme des champignons depuis la fin de la guerre civile qui a ravagé la cité pendant quinze ans. Mais la comparaison s’arrête là, trop facile, trop superficielle.
Cette nouvelle Beyrouth est en réalité à l’opposé des rêves de Lamba Labs, le symbole d’un capitalisme consumériste qui fit la fortune de Rafic Hariri, l’ancien Premier ministre assassiné en 2005. Après la guerre, en 1994, l’homme politique et homme d’affaires crée la société Solidere, chargée de la reconstruction de la ville. Le centre-ville affiche maintenant une succession de boutiques de luxe et des souks propres sur eux comme nos grands magasins. Tout pour déplaire à la petite troupe de Lamba Labs.
Du code à la poterie en passant par l’électronique et la bouffe
Car son objectif est d’inciter les Libanais à fabriquer, à créer eux-mêmes, dans une vision holistique du hacking qui va du code à la poterie en passant par l’électronique et la bouffe : hacker cette société qu’ils jugent passive, rien moins que ça, tel est le motto. Le chantier, oui, mais tout le monde doit jouer avec la grue.
Comme pour nombre de hackerspaces arabes, l’étincelle s’est présentée sous la forme sautillante de Bilal Ghalib. Cet Américain d’origine irakienne passe une partie de sa vie à arpenter le monde, et en particulier ses chers pays arabes, pour aider la création de hackerspaces, quand il n’est pas « catalyste » chez Autodesk, le concepteur de logiciel 3D.
Maya Kreidieh, co-fondatrice à la douceur faussement anémique, se souvient du déclic lorsqu’elle a rencontré Bilal Ghalib. Elle était avec Marc Farra, deux fois son gabarit, et le fluet et affable Bassam Jalgha, deux jeunes gens passés comme elle par la prestigieuse American University of Beirut :
Propreté suisse
« Explorer les technologies et toutes ces choses qui m’intéressent. » La dernière partie de la phrase de Maya est primordiale : loin de l’image d’un hackerspace testostéroné et sale, plein de bières et de lignes de commande sous Linux. Lamba Labs s’est installé dans des locaux de Karaj, là où Bilal avait donné son atelier, qui est en fait aussi propre et clair qu’un garage à bagnoles est crade et sombre.
Karaj a été créé par Ayah Bdeir, brillante Libanaise qui s’est installée à New York pour développer Little Bits, un projet à succès pour vulgariser l’électronique, sous Creative Commons. Ce lieu qui se voulait l’équivalent local du Media Lab du MIT, est en train de capoter mais il a permis à Lamba Labs de faire ses premiers pas dans un endroit accueillant : hauts murs clairs, dégradé de gris pour les dalles de marbre, jolies fenêtres en arcade, toilettes d’une propreté suisse. Il est situé à Mar Mikhael, un quartier qui a les faveurs des créatifs depuis quelques temps.
Sur les murs, des masques en poterie côtoient des pinces d’électronicien. Ou d’électronicienne. Et n’allez pas croire que la poterie est une doulce et féminine initiative : c’est la passion d’Hassane Slaibi, développeur de métier et « maître des jouets » (du matériel) de Lamba Labs, qui a organisé des ateliers pour les membres.
Eh oui, ici, parité et interdisciplinarité se nourrissent mutuellement. Pourquoi tant de filles ? On ne se pose même pas la question, on s’en fiche même, comme de la religion de son voisin. Une claque sur la joue de ce milieu réputé pour son machisme, et un petit exploit naturel pour eux, comme l’expliquent Maya, Sara Sibai, « community curator » à AltCity, un espace de coworking, et adepte de la poésie parlée, et Marc :

Logo des Build nights, consacrée au travail sur des projets.
Héritage de la guerre civile qui incite à consommer sans trop se poser de questions, culture industrielle historiquement faible, nos hackers divergent sur les causes mais se rejoignent sur le fond : il faut développer la culture hacker et maker, qui fait cruellement défaut aujourd’hui. « On commence en se changeant nous-même et en empowerant d’autres personnes, si on peut, à chaque fois qu’on peut », explique Hassane. « Je pense que cela va être difficile, poursuit son camarade Bassem Dghaidy, car cela implique que nous introduisons un changement de paradigme dans des domaines très différents, que nous soyons des hackers d’esprit, des hackers sociaux, des hackers culturels, éducation, techniques, etc. ». Un défi énorme mais le contexte est plutôt favorable, analysent Sara et Maya :
Ce qui fait dire à Maya que leur projet relève bien du politique :
« Nous ne sommes pas du tout politiques, comme la plupart des hackerspaces. Mais parfois je me dis que c’est complètement l’opposé, que nous sommes politiques à 100%, pas dans le sens habituel, on n’appartient pas à un parti politique, mais dans le sens qu’on donne du pouvoir aux gens (« empower »). Quand tu apprends aux gens à faire quelque chose d’aussi simple que leur premier circuit, qu’ils peuvent faire eux-mêmes, penser eux-mêmes, c’est déjà politique, . »
Robot serveur de bière et carte de la corruption
Malgré sa jeunesse, Lamba Labs a déjà de jolis projets à son actif ou en cours qui illustrent sa volonté. Au rayon fun, citons Emily, un robot de téléprésence ambulant chargé du service des bières. Bassam souhaite utiliser la technique pour fabriquer une ceinture pour malvoyants et aveugles qui les aiderait dans leurs déplacements.
Il y a aussi cette armoire à pharmacie qui vous prévient quand des médicaments dépassent la date de péremption.
La collaboration avec des artistes et designers s’est concrétisée par exemple sous la forme d’un tee-shirt bardé de leds, que Maya a fait avec une amie designer et activiste. « Il affiche des graphiques et des animations, des tweets en temps réel, détaille la jeune femme. Mon amie est designer mais elle voulait construire un projet dans l’électronique. Au Liban d’habitude soit tu es un artiste, soit tu es un ingénieur, il y a des limites très strictes, en particulier à la fac. C’est très mauvais pour l’innovation, si tu mets les gens dans des boites, tu ne peux pas vraiment innover. Au hackerspace, on casse ces limites. Elle a fait la soudure, les circuits, et elle est tellement meilleure que moi en soudure, c’est si étonnant de retirer ces limites et de voir les gens grandir d’eux-mêmes. »
Maya travaille aussi avec Marc sur une carte crowdsourcée pour documenter la corruption lors des prochaines élections législatives, prévues pour juin mais reportées en raison des tensions. Complétant les propos de Maya, Marc précise :
« Ce n’est pas politique, c’est de l’engagement civique. Le Liban est un pays très électrique politiquement et nous voulons juste faire prendre conscience des problèmes, de la meilleure façon possible pour un hacker, c’est-à-dire en promouvant l’open source à travers l’open data, c’est le cœur du projet.Dans la première partie du projet, ce sera juste de l’agrégation de contenus issus des médias sociaux, mais nous espérons rassembler plus de collaborateurs et mettre une plate-forme open data autour des élections. Tout ce sur quoi on travaille est open source, on peut donc l’utiliser dans d’autres pays. »
Start up prometteuse
On ne s’étonnera pas dans ce contexte effervescent que des membres de Lamba Labs aient une start up prometteuse en marche. Leur produit ? Un autotuneur pour guitare, qui a valu à son initiateur Bassam de dégoter une bourse de 300 000 dollars à Stars of science, une sorte de Star academy pour « inventeurs arabes », grassement financée par les Qataris.
Avec ses amis du hackerspace Bassem et Hassane, ils bossent dans un étroit bureau plus haut que large, encombré d’outils, d’électronique, d’ordinateurs plus ou moins récents et bien sûr d’instruments de musique à cordes. Et ils ne sont pas là que pour la déco : Bassam joue de l’aoud, un instrument arabe et accompagne parfois Hassane, qui pratique la flûte traversière.
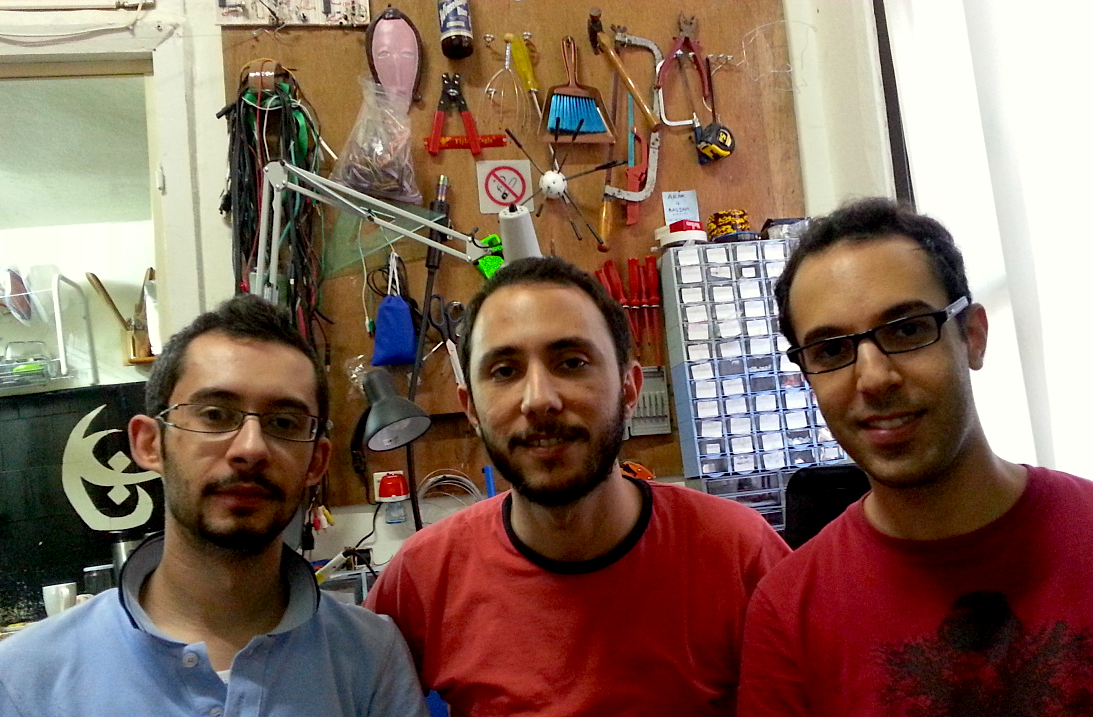
Bassem, Bassam et Hassane, trois hackers start-upers dans leur antre de Depot Beirut.
Baptisé Depot Beirut, leur local a tout de l’esthétique habituelle du hackerspace. Logique car pour le trio, leur produit relève du hacking. « Je pense que cela peut-être considéré comme un projet de hacker car il a émergé d’un problème, d’une nécessité, avance Bassam. J’éprouvais des difficultés au début pour tuner mon instrument, donc pourquoi ne pas créer un outil que personne n’a fait auparavant ? Si personne ne l’achète, je peux m’en servir pour moi-même. »
Le lancement est prévu pour janvier mais avant, ils viennent de partir pour trois mois en Chine, direction Seed Studio, le réputé accélérateur de start-up hardware d’Eric Pan. Faute d’en avoir un au Liban.
Pour autant le projet n’est pas open source : pragmatiques, nos jeunes entrepreneurs préfèrent d’abord assurer leurs arrières financières, qui passent pour le moment par du propriétaire. Mais ce point ne doit pas faire oublier ce que le projet doit à l’éthique hacker, estime Bassem :

Réunion préparatoire à la V2 de Lamba Labs prévue dans les mois qui viennent. Au centre, Marc Farra.
Déjà l’heure du reboot
Mais le plus gros projet, c’est le hackerspace lui-même, la matrice qui sèmera, espèrent-ils des graines. Et l’heure, déjà, est au retour sur soi-même pour mieux repartir, comme si de rien n’était des tensions qui, déjà, ont repris au Liban, menacé de contamination par la guerre en Syrie :
Le premier reboot forcé, c’est le changement de lieu : Lamba Labs a dû plier ses ordis, ses fers à souder et ses masques début juillet. Parmi les pistes de relogement envisagées figure l’aménagement d’un des bus abandonnés dans l’ancienne gare de Mar Mikhael. On leur fait confiance pour que le résultat soit aussi cosy que Karaj.
[Vidéo] Ma mère et les hackers
 « Alors tu vois Monique, avec un gobelet percé, j’ai fait un filtre à thé, c’est un hack. ». Skhaen expliquant le hacking à ma maman, métaphore, début du XXIe siècle.
« Alors tu vois Monique, avec un gobelet percé, j’ai fait un filtre à thé, c’est un hack. ». Skhaen expliquant le hacking à ma maman, métaphore, début du XXIe siècle.
Dimanche dernier, dans le cadre du festival Pas Sages en Seine à Paris, j’ai monté un atelier pour comprendre pourquoi les enjeux, en particulier politiques, du hacking échappe à ma maman. Ma maman en vrai a échangé avec quelques gentils hackers pédagogiques et l’indispensable Amaëlle Guiton, son micro de journaliste-animatrice toujours ouvert.
Derrière l’intitulé WTF, cette confrontation a permis, il me semble, de mesurer la distorsion entre le discours et les aspirations des hackers, ce qu’en disent les médias, et le ressenti du commun des mortels. Bref un sain exercice.

Entre ma mère et les hackers, il est clair que c’est encore un peu flou.
Photos Fabrice Dellier by sa
Le maker, le dêmiourgos et le poète

Comment traduire le mot maker en français ? La question revient régulièrement dans la communauté francophone des, ben justement des makers coupent certains qui préfèrent conserver le terme.
Je n’en suis pas très fan, non pas parce qu’il est anglais, mais car il me parait très lié à la culture américaine. Il renvoie à ce mythe du peuple américain qui s’est construit à la force de sa créativité, donnant naissance à une économie florissante. Regardez par exemple cette vieille publicité de Chevrolet citée par Dale Dougherty, le gourou de la communauté Make, lors de son TEDx sur les makers (à partir de la 5ème minute). Ce spot intitulé « American makers » montre deux enfants bâtissant un château de sable surmonté de la bannière étoilée, musique joyeuse et entrainante, avec en voix off : « parmi toutes ces choses qui font de nous des Américains, il y a le fait d’être des créateurs (makers donc en VO). Avec nos forces et nos intelligences et notre esprit, nous réunissons, nous formons et nous façonnons, des créateurs et des modeleurs et des bricoleurs ».
D’’autres proposent doer, ce qui n’est guère euphonique, et surtout, vient aussi de l’anglais.
Il y a également bidouilleur, mais la définition habituelle de bidouille est inappropriée pour qualifier l’ensemble des pratiques de nos bidouilleurs :
« Amélioration, ou réalisation, pérenne ou temporaire réalisée sans respecter les règles de l’art. » [Wiktionnary]
On entend parfois aussi fabricateur, qui est intéressant car il renvoie aussi à l’imagination, voire à l’acte divin, on dépasse la première acception très pragmatique :
« "Sans un dieu, fabricateur souverain, l’univers et l’homme n’existeraient pas : telle est la profession de foi sociale." [...] (Proudhon, Syst. contrad. écon.,t. 1, 1846, p. 6). »
« Personne qui crée, invente. Fabricateur de fables, d’hymnes. Synon. créateur. »
Mais il peut aussi être utilisé dans un sens péjoratif :
« [Le compl. désigne des objets destinés à faire illusion, à tromper] Fabricateur de fausse monnaie, de faux papiers. » [CNRTL]

La lecture de l’ouvrage de Richard Sennett, Ce que sait la main, m’a suggéré deux nouvelles traductions, tirées de l’étymologie grecque.
Le sociologue américain remonte l’histoire de l’artisanat jusqu’à l’Antiquité. Citant « l’une des toutes premières célébrations de l’artisan [...], un hymne homérique au maître-dieu des artisans Héphaïstos », il rappelle que
« plus qu’un technicien, l’artisan civilisateur a utilisé ses outils pour un bien collectif : la fin de l’errance d’une humanité faite de chasseurs-cueilleurs ou de guerriers sans racine. S’interrogeant sur l’hymne homérique à Héphaïstos, une historienne moderne observe que, le travail artisanal ayant "arraché les hommes à leur isolement, personnifié par les Cyclopes séjournant dans des grottes, métier et communauté étaient, pour les Grecs, indissociables" ».
« Bien collectif », « communauté », voilà qui renvoient singulièrement aux pratiques actuelles, avec la montée en puissance de l’open source et de l’open hardware, des biens communs, des échanges et de la mutualisation en réseau.
Ce qui nous mène à une première proposition de traduction, le dêmiourgos :
« Le mot qu’emploient les Hymnes pour désigner l’artisan est dêmiourgos, mot composé de dêmios, "public", et d’ergon, "ouvrage". »
Le dêmiourgos, souligne-t-il, désignait aussi bien les médecins que les potiers, sans distinction entre travail « manuel » et « intellectuel », une dichotomie malheureuse qui est venue ensuite.
Les artisans de Linux
Le lecteur ne s’étonnera pas de voir que Richard Sennett inclut après les contributeurs de Linux dans cette catégorie.
L’auteur détaille ensuite comment la figure de l’artisan perd de son aura et l’évolution sémantique :
« Aristote abandonne le mot ancien dêmiourgos, pour employer cheirotechnon, qui dire simplement "travailleur manuel". »
Cette évolution aura une conséquence, le « partage des compétences entre les sexes », entre celles mises en œuvre dans le foyer, et celles exercées à l’extérieur.
Cette disparition de l’idéal archaïque d’Héphaïstos chagrine Platon. Poursuivons l’étymologie :
« [Platon] fit remonter la compétence à la racine du mot "faire", poiein. Le mot poésie lui est apparenté, et, dans l’hymne, les poètes apparaissent eux aussi comme une autre espèce d’artisan. [...]
En son temps, toutefois, Platon observa que, si les "artisans sont tous des poiêtai, des fabricants, [...], on ne donne pas à ces gens le nom de poiêtai, de poètes, mais qu’ils portent d’autres noms."
Platon craignait que ces noms différents, et ces compétences différentes, n’empêchent ses contemporains de comprendre ce qu’ils partageaient. Au fil des cinq siècles qui séparent l’Hymne à Héphaïstos de son temps, quelque chose semblait s’être perdu. L’unité des temps archaïques entre compétence et communauté s’était affaiblie. Les compétences pratiques continuaient de porter la vie courante de la cité, mais, généralement, on ne les en honorait pas pour autant. »
Ce qui nous mène à la seconde proposition de traduction : poète.

Addedum
Voici une autre proposition de Guillaume Credoz, un architecte et designer installé à Beyrouth qui a lancé RapidManufacturing, un service d’impression 3D haut de gamme :
Métis
« Métis est la mère d’Athéna (qui naît toute armée et sage de la tête de Zeus, car Zeus a fini par avaler Métis après un long cache-cache), elle est la ruse alliée à la sagesse, une intelligence pratique.
"Métis désigne cette capacité de l’intelligence qui correspond, non pas à l’abstraction, mais à l’efficacité pratique, au domaine de l’action, à tous ces savoir-faire utiles, à l’habileté de l’artisan dans son métier, à son ’coup de main’, aux tours magiques, aux ruses de guerre, aux tromperies, esquives et débrouillardises en tout genre."
Métis participe au passage des savoir-faire aux artisans (notamment le feu), c’est une déesse mère du début des temps.
Il y a une petite Métis japonaise dans mon atelier, qui veille. »
Photos prises lors de l’Open Bidouille Camp 2 de Brest, en mai dernier.
Le petit prince des hackerspaces

C’est une ville de décor de cinéma aux portes du Sahara. On s’attendrait à voir surgir Khaleesi et son armée au détour d’une de ses bâtisses jaune pâle comme le sable qui l’entoure, grincer RD2D et C-3PO.
C’est une ville fantôme pour qui la traverse sans prendre le temps de parcourir ses rues quasi vides, où le vent fait plus de bruit que les hommes. La vie pourtant préfère se réfugier en intérieur ou le soir, à l’abri de la lumière éclatante qui fatigue les yeux des rares Occidentaux de passage.
Les maisons, carrées, ne dépassent pas trois étages, certaines en construction, comme pour mieux étaler ses 5 600 habitants, chats, coqs et chèvres, mieux étaler la vie, mieux la suspendre. Il y a de la place, pourquoi ne pas prendre ses aises ? Passant, laisse ton pas nerveux de citadin.
C’est une ville qui enflammerait une imagination asséchée comme les os de seiche qui jonchent sa longue plage, où le sable du désert se confond avec celui de la mer. La légende/le guide/ma mère raconte que Saint-Exupéry est devenu écrivain à Tarfaya, où son avion de l’aéropostale faisait ses escales entre Toulouse et Dakar. De la dune est né le Petit prince qui rêvait de fraternité.
« La connaissance n’a ni passeport ni carte d’identité »
Aujourd’hui, Saint-Exupéry pourrait faire une halte au Sahara Labs pour y réparer son coucou, il y trouverait une aide généreuse et d’autres rêves de partage dans ce premier hackerspace marocain, sorti de cette terre étrange cet hiver, par la volonté de El Wali El Alaoui, petit prince des hackerspaces pour qui « la connaissance n’a ni passeport ni carte d’identité. ».
Sahraoui ascétique au visage en lame de couteau, préférant les clopes au tajine, El Wali vivote en concevant de temps à autre des sites et en faisant le guide. L’argent ne le motive guère, non ce qui l’anime, c’est la volonté de développer les valeurs du hacking, débrouille et partage des connaissances, comme une seconde nature ici qui a conduit à créer Sahara Labs :
Avant, il a fallu réunir la communauté : « Nous avons organisé la première réunion voilà un an et demi, se souvient-il, nous étions un bâtiment en construction. Nous avons ensuite monté d’autres réunions préparatoires avec les gens de Tarfaya et ailleurs au Maroc, et communiqué. Nous sommes passés au statut actif le premier janvier et depuis nous travaillons beaucoup. »

Depuis, il y a eu un atelier par mois organisé avec la vingtaine de membres, qui vont d’une lycéenne au frère de El Wali. Des écoles ont même été mises dans la boucle une fois, et l’on a pu y voir aussi des habitants nés bien avant Internet. « Nous ne recherchons pas un niveau avancé dans un premier temps, précise El Wali, nous visons les débutants, nous avons donc montré comment l’électronique fonctionne, les contrôleurs, mais de façon ludique, comme des jeux. » Faute de lieu fixe, les événements sont tournants.
L’incontournable Bilal Ghalib est venu une semaine en février faire des ateliers. Cet Américain d’origine irakienne, « évangéliste » chez Autodesk, un éditeur américain de logiciels de CAO, a créé GEMSI, une association qui aide le développement des hacker/makerspaces dans les pays arabes. Depuis un an, on le voit, sautant d’un avion à un autre, visiter les hackerspace du Maroc à l’Irak.
« Il hacke la société »
Pour lui, El Wali El Alaoui fait plus que hacker de l’électronique ou des PC : « Il hacke la société. » L’homme a aussi monté Cap 10, une association de promotion de la ville, et organisé un TEDx, avec le soutien... de Cap 10 et du hackerspace. Entre le futur parc d’éoliennes, le plus grand d’Afrique, et le retour de la liaison avec les îles Canari, la petite ville devrait grossir, encore faut-il que cette croissance soit harmonieuse. « Il a une vision de ce que les choses pourraient être et il stimule les gens pour que cela arrive », juge Bilal Ghalib.
Non sans un certain succès, le TEDx a effectivement rempli la petite salle du musée de l’aéropostale, en présence du représentant du gouverneur de la province de Tarfaya. Il trouve le concept de hackerspace intéressant, tant que les activités restent légales.
Pour le rassurer, voici la jolie histoire de Mostapha, le script kiddie reconverti en white hat organisateur d’ateliers pour les mômes. Un storytelling impeccable raconté à l’hôtel principal de Tarfaya, haut lieu de sociabilité à base de diffusion de matches de foot et de parties de billard :
Arduino, Makey Makey, littleBits et autres imprimantes 3D, le contenu des ateliers pourrait être le même aux États-Unis ou en France, on y répète le même mantra open source, la même conviction que ces lieux sont nécessaires et viennent combler un vide. « C’est un espace pour donner à tout le monde, créer, innover des choses qui sont bonnes pour le monde et l’environnement, avance Hassan. C’est important pour les jeunes qui sont l’avenir de ce pays, un lieu pour exprimer leurs idées, leur expérience. » Mostapha renchérit : « Je connaissais des gens doués en informatique qui n’ont pas d’endroit pour partager leurs savoirs avec d’autres. ». « Dans le respect de l’esprit de notre culture », précise Med Salem, le frère de El Wali.
À ce titre, Sahara Labs fait aussi office de maison de quartier, un moyen de perpétrer le lien social dans une cité qui n’en manque déjà pas, à laquelle les habitants sont très attachés.
« Le hacking, ce n’est pas de la politique, c’est un mode de vie, ce sera peut-être la prochaine religion »
Chez El Wali El Alaoui, le discours se teinte d’une forte critique du capitalisme actuel, comme un écho à cette phrase de Saint-Exupéry, dont il rêve d’ailleurs de réhabiliter l’ancien garage abandonné pour le hackerspace :
« Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. »
Pour autant, pas de politique ici, nuance-t-il dans une pirouette : « le hacking, ce n’est pas de la politique, c’est un mode de vie, ce sera peut-être la prochaine religion. Nous ne croyons pas dans la politique, nous croyons aux humains. Nous voyons que les gens en France, à Tarfaya, à Mexico, etc, sont très proches, il n’y a pas de frontières, nous sommes tous les mêmes, on n’a pas besoin de politique. »
En attendant de créer une hypothétique boite dans l’open source hardware, une forme de capitalisme acceptable, El Wali El Alaoui continue de prêcher la bonne parole des hackerspaces. « Beaucoup de gens nous contactent pour faire partie de Sahara Labs, nous leur conseillons de faire le leur, pour être indépendant. »
À Casablanca, il a rencontré des étudiants de l’ESITH, une importante école d’ingénieurs, qui sont sur le point d’en fonder un ; de même à Kenitra, qui a inauguré le sien, au sein d’une entreprise d’informatique. Sahara Labs a également rejoint l’équipe de Protei à Casablanca, un projet de drone marin open source pour nettoyer les océans. La fabrication d’une bougie intelligente, alimentée à l’énergie solaire, trotte également dans la tête. Il faudrait bien aussi trouver comment utiliser ce fichu sable.
Et l’année prochaine,
« inch Allah, nous organiserons la première rencontre des hackerspaces arabes, ici à Tarfaya. »
Crédits photos : avec l’aimable autorisation de Ghizlane Echoudar « Kai Sou » et de Sahara Labs.
« Des parties entières du cyberespace d’une importance assez vitale sont laissées de côté »
« A 0% bullshit conference » : telle est l’ambition de No Such Con, une conférence de sécurité informatique qui se tient cette semaine à Paris, au très beau siège du PC place du colonel Fabien. À défaut de pouvoir vérifier la véracité de ce slogan, voici une petite interview de Cédric "Sid" Blancher, chercheur en sécurité informatique chez EADS depuis dix ans, qui fait partie de l’équipe organisatrice.
Les conférences de sécurité informatique se multiplient en France en ce moment, comment expliquez-vous cette effervescence ?
Je vois deux grandes raisons. D’une part, historiquement en France, il y a peu de conférences de sécurité informatique technique. La plus ancienne, le SSTIC, date de 2003, et elle est restée longtemps la seule mais elle n’est pas vraiment orientée sur la scène hacker et underground, son audience et ses talks sont davantage policés. Puis la Nuit du Hack est arrivée, qui s’est déclinée avec Hack in Paris, dans un événement un peu plus commercial on va dire. Hackito ergo sum est venu, puis GreHack et No Such Con maintenant.
Elles ont comblé les trous, avant pour assister à ce genre de conférence, il fallait aller aux États-Unis, en Asie ou en Allemagne. Beaucoup de personnes avaient envie de monter des conférences localement, plutôt que d’aller ici et là, comme il y a de la demande, et de faire venir les gens chez nous.
C’est l’autre raison : il y a une vraie demande. Le SSTIC a vendu ses places en une journée, nous aurons un peu plus de 300 personnes, Hackito ergo sum la semaine dernière a plutôt bien rempli sa salle.
Les programmes sont diversifiés, il n’y a pas de redite entre le programme de Hackito et celui de No Such Con.
Black hat, « 7000 kilomètres en avion pour trois jours de talks pourris… »
Rattrape-t-on le niveau des Américains ?
J’espère que non, les conférences américaines me laissent de marbre, je vais peut-être me contredire dans le futur mais j’ai décidé de ne plus aller à Black Hat, la dernière fois, c’était juste nul, honnêtement. Le problème, c’est que c’est une conférence énorme, avec huit séries de talks en même temps, je n’ai peut-être pas eu de chance, mais tous ceux que j’ai vus étaient pourris. 7000 kilomètres en avion pour trois jours de talks pourris…
J’ai le sentiment qu’en France, le contenu délivré est meilleur que ce que je peux voir aux États-Unis et ailleurs. Il y a, je pense, un vrai effet, dont parlait Andrea Barisani en keynote, de buzz, les gens viennent pour faire de la presse, et c’est de plus en plus ça.
Quels sont les sujets abordés au cours de ces trois jours, en terme « grand public » ?
Nous avons pas mal de talks autour des systèmes d’exploitation, les protections mises en place pour prévenir certains types de bug, sur du Windows, beaucoup sur Windows 8, évidemment [sa dernière version, sortie cet automne, ndlb], de l’Apple, de l’Unix. Il y aura un talk assez intéressant sur l’exploitation de navigateur, avec des images, sur la sécurité de la programmation, sur les plates-formes matériel, on va parler de BIOS, de TPM, cette petite chip qui fait un peu peur car elle permet de locker une machine pour ne booter qu’un seul système d’exploitation, on ne peut donc plus changer son OS.
Il y a aussi des talks sur du middleware de SAP, un squelette applicatif sur lequel on va greffer des modules qui communiquent avec la gestion des stocks, des assemblages, etc, puis tout remonte aux utilisateurs. Tout le monde utilise ce système dans l’industrie mais il coûte si cher que personne ne l’a vraiment regardé. Il y aura aussi un dernier talk assez fun sur des méthodes de programmation exotique.

Il y a eu une grosse polémique à propos d’un des sponsors de OHM, qui est listé dans les spyfiles. Quelles sont vos règles en la matière ?
Les sponsors n’ont pas le droit d’influer sur le contenu, donc pas d’intervention au titre du sponsoring, on peut accepter le talk d’un sponsor s’il est de bonne qualité mais il n’y a pas de talk automatique pour les sponsors, et ils n’ont pas de droit de regard sur le contenu, on refuse qu’ils nous interdisent de faire certaines interventions car elles vont les gêner.
Les sponsors sont intéressés par la population des participants, on ne leur donne pas le nom des gens qui viennent, on leur fournit des statistiques sur des secteurs d’activité, etc, quand les gens nous ont fourni l’information, lors de l’inscription, la seule information obligatoire, c’est nom, prénom et adresse email.
Il semble assez difficile d’être complètement éthique en matière de sponsor, Microsoft par exemple, qui fait partie de vos sponsors, est accusé d’enfreindre la confidentialité des données, avec Skype, par exemple, c’est assez délicat ?
C’est assez délicat, en même temps, je dirais, pour notre défense qu’au moment de signer le sponsoring, on était pas encore au courant, c’est vrai que c’est super délicat, il y a plein de problèmes comme celui-ci...
« Skype, c’est chaud, c’est super chaud, c’est un problème. »
La polémique sur Skype est ancienne...
Skype, c’est vieux, mais ce qui semble avéré, et qui traine depuis un petit moment, c’est qu’ils ont les moyens de surveiller ce qui se passe, par exemple tous les liens sur Skype, Microsoft récupère les informations manifestement. C’est chaud, c’est super chaud, c’est un problème.
Que comptez-vous faire ? Trouver d’autres moyens de financement ? Être plus sélectif ?
Il faut qu’on trouve des moyens de financement pour se permettre de choisir, après, c’est un peu compliqué. Pour prendre l’exemple de Microsoft, le problème ne s’est pas posé mais je sais que, dans le milieu des conférences de sécurité, on a réussi, avec le temps, à faire changer sa politique de sponsoring. À une époque, Microsoft avait des exigences sur le contenu des talks et des conférences.
De nombreux problèmes se posent à des niveaux différents, Microsoft est tellement présent... Skype, je n’avais pas regardé depuis 3-4 ans, ça ressort, on regarde ce qu’il y a dedans. Mais on peut avoir le même type de raisonnement avec RIM, ma position, c’est que j’aime bien que les gens aient démontré les choses, on dit beaucoup de choses à propos de Skype qui n’ont jamais été démontrées. Mais il est vrai que quand on regarde ça, c’est pas top.

Le terme « hacker » est employé à toutes les sauces, est-ce le signe qu’il s’affadit ou qu’il est dédiabolisé ?
Je suis assez mitigé, je trouve qu’on l’a surtout affadi, ça ne veut rien dire, on laisse la personne en face de nous en faire l’interprétation qu’elle veut. Comme on l’a surtout utilisé dans un sens négatif, pour désigner un pirate informatique, cette connotation reste très ancrée dans le langage, en particulier les Anglo-saxons. Il est utilisé à chaque fois qu’il y a un titre sur le piratage, comme le vol des 45 millions de dollars..
À contre-coeur, je n’utilise plus ce terme devant des gens dont je sais qu’ils peuvent mal l’interpréter, face aux profanes qui ne font pas partie du milieu. C’est dommage,
on essaye de dire que nous avons une compréhension différente du mot, mais je pense que la pente va être dure à remonter.
Quel terme utilisez-vous du coup ?
Cela va de bidouilleur à expert, j’essaye de trouver des palliatifs pour exprimer ce que l’on fait, cela passe souvent par des périphrases. Mais quand je veux faire passer un message, j’évite le terme pour éviter de déformer, de base, l’interprétation du message.
L’année dernière, le rapport de Jean-Marie Bockel sur la cyberdéfense évoquait directement l’utilité des hackers, des recrutements ont été annoncés dans ce sens, pensez-vous que la politique gouvernementale aille dans le bon sens ?
Je pense qu’il ne l’ont pas pris par le bon bout, en disant « on a besoin de profils de hacker », déjà c’est quoi un hacker ? Quand on annonce cela, que se passe-t-il ? Une personne va voir les RH et dit « il me faut des hackers. Les RH répondent : fais-moi une fiche de poste. »
Le dire, c’est bien, passer à l’implémentation, c’est autre chose. C’est pour cela que je n’aime pas trop la façon dont cela a été compris après le rapport Bockel car pour moi, une des particularités des gens qui se définissent comme des hackers, c’est qu’ils sont très attachés à leur indépendance, au fait de pouvoir faire ce dont ils ont envie. Je pense qu’il serait plus profitable de créer un contexte législatif, réglementaire, qui leur permettrait de s’exprimer, où on leur donnerait les moyens, sans les recruter. Aujourd’hui, on entend la rengaine « l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi) recrute, ils piquent les gens de tout le monde ». Ils recrutent des profils différents, avec une approche par la compétence. Ils ne disent pas « on recrute des hackers », mais « quelqu’un qui fait de reverse engineering », c’est une approche très pragmatique. Ils ont une campagne de recrutement assez volontaire et énergique qui marche.
« Mettre à profit cette part d’indépendance des hackers »
Mais le marché du travail est ce qu’il est et il n’y a pas assez d’emplois pour satisfaire tout le monde, ce sont des compétences pointues rares. Du coup on se retrouve avec des boites sans experts car ils sont tous partis là, de l’autre côté, on a un milieu complètement éclaté mais tous ces gens-là continuent à travailler sur leur temps libre sur des petits sujets. C’est justement mettre à profit cette part d’indépendance dans ce qu’ils font qui me semblerait intéressante à mettre en place.
De plus, le recrutement est basée sur les qualifications, les diplômes, l’expérience, etc, et toute une partie de cette population passe à côté de la raquette. J’ai vu des gens se faire jeter lors des entretiens alors que manifestement, c’était les meilleurs candidats.
C’est vrai qu’on manque de poste, mais ouvrez un peu les yeux aussi, les gens que vous voulez recruter ne sont pas sensibles au même discours que ceux que vous recrutiez avant, il faut aussi qu’ils puissent travailler à distance, il faut les intéresser, qu’il y ait du challenge derrière. Il y a un discours à apporter, et l’Anssi fait partie de ceux qui ont compris cela, pour que les gens signent en bas de la page, et même postulent tout court.
Si on poursuivre l’exemple de l’Anssi, elle a une mission de sécurisation des infrastructures gouvernementales et des OIV (opérateur d’importance vitale), qui va des infrastructures vitales, fourniture d’électricité, d’eau, de gaz, tout ce qui permet à la France de tourner rond, et de tout ce qui est vital en termes économiques, une société comme EADS, car sa part dans l’économie française est énorme.
Par contre le PC de madame Michu ne tombe pas dans le domaine de compétence de l’Anssi, qui n’en a donc rien à faire de sa sécurité. Pour autant, si je veux descendre une partie de l’infrastructure d’EDF, en déni de service, la première chose que je vais faire, c’est pirater le PC de madame Michu pour en faire un botnet et attaquer un opérateur d’importance vitale.
Il y a un peu une déconnexion avec la réalité, tous les PC connectés à Internet, qu’ils appartiennent à EDF, Carrefour, l’épicier du coin ou madame Michu, ont tous la même capacité de se nuire les uns les autres. On a trop segmenté, il y a des parties entières du paysage, le cyberespace, comme on dit, qui sont laissées de côté, alors qu’elles sont d’une importance assez vitale. Qui va tester le firewall personnel que personne n’utilise dans l’industrie mais que les particuliers achètent ?
L’année dernière, un projet de directive avait suscité la colère dans le milieu, car il prévoit de criminaliser davantage le hacking, où en est-on ? Êtes-vous toujours inquiet ?
Je ne sais pas ce que c’est devenu [lecture devant le Parlement en juillet, en théorie, ndlb], est-ce un souci, oui, après dans la pratique, ça ne change pas grand chose, ceux qui faisaient des choses continuent à les faire. Le problème, c’est que les gens contre lesquels cette législation est mise en place sont des gens qui la plupart du temps sont hors de portée des lois.
Image CC Flickr by nc nd glennmarshall et by nc dustball
Un TEDx au Sahara

Cette semaine, je me suis rendue à Tarfaya, une bourgade du sud marocain aux portes du Sahara qui a la particularité d’avoir le premier hackerspace du pays, Sahara Labs (il se peut aussi que Saint-Exupéry s’en soit inspiré pour Le Petit Prince, passons ce détail). El Wali El Alaoui, son fondateur, se démène beaucoup pour sa petite ville qu’il aime d’un sincère attachement. Avec des amis, ils ont créé l’association Cap10, qui, outre l’animation du hackerspace, a organisé le premier TEDx de la ville ce samedi. Autant faire deux pierres d’un coup et jumeler un reportage sur Sahara Labs avec un talk, sur les hackerspaces arabes bien sûr.
Je ne suis pas particulièrement fan de la tedxification du monde, ce côté "réduisons-brillamment-avec-humour-emotion-et-enthousiasme-le-monde-dans-un-discours-de-15-minutes", mais c’était l’occasion de mettre en avant l’intérêt potentiel des hackerspaces pour le Maroc en montrant ce qui est déjà en cours chez ses voisins.
Si le format était effectivement contraint, l’événement n’avait rien du bullshit propre sur lui qui se dégage des vidéos TEDx mises en ligne. Non, l’état d’esprit m’a rappelé nos fêtes annuelles de village, à part que le maire était ici remplacé par le représentant de la province de Tarfaya. C’était touchant de voir toute la petite équipe sur son 31, en habit traditionnel sahraoui, qui confère aux hommes une superbe allure simple et élégante. L’un deux est venu nous chercher à l’hôtel, lunettes noires et vieille Mercedes.
Ils s’étaient démenés pour aménager la salle unique du musée Saint-Exupéry en un camp sahraoui, tente, tapis, coffrets, poufs, coquillages habillés d’une peau décorée à la peinture. L’entrée était gratuite, ce qui n’est pas souvent le cas avec les TEDx. Un buffet a été servi à la pause, avec l’incontournable thé à la menthe, plus fort ici qu’au nord du pays.
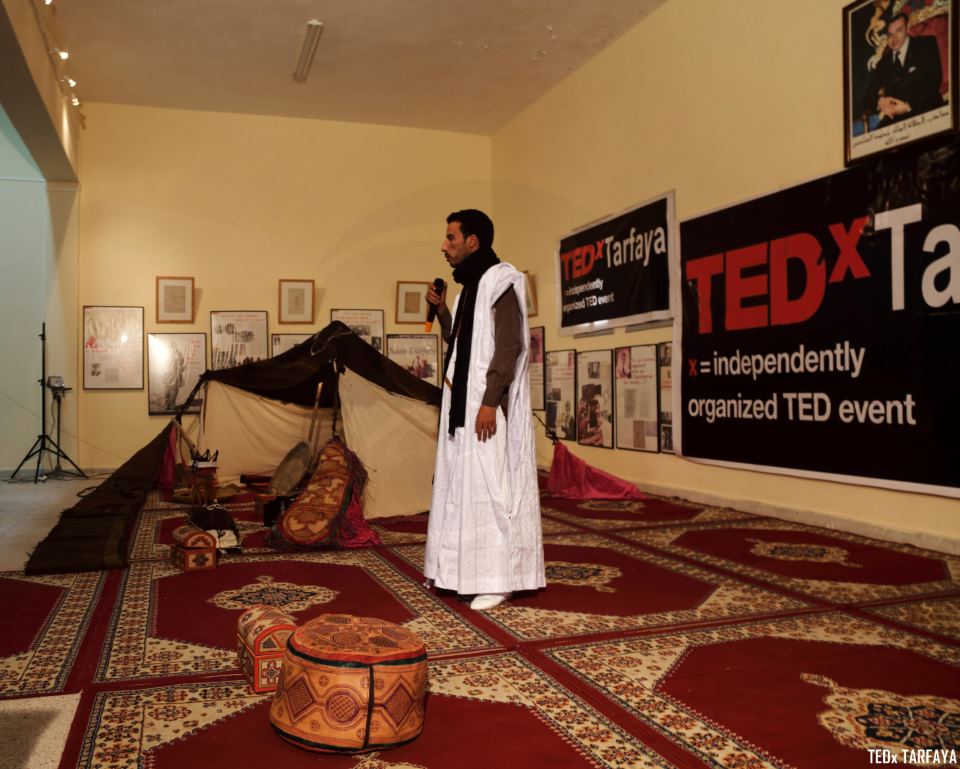
El Wali El Alaoui, fondateur de Sahara Labs et co-organisateur du TEDx.
Sur les six intervenants, pardon speakers, deux sont intervenus en arabe pour évoquer le potentiel de la ville et la nécessité de préserver son patrimoine : chanson, nature, etc. Du coup, j’ai applaudi par mimétisme, en mode OSS 117.
Saint-Exupéry était un passage obligé, et c’était pas plus mal : rabâché, Le Petit Prince a eu pour ma part un effet repoussoir, et la présentation m’a donné envie de le relire, à grand coup de citations implacables sur la fraternité et le dépassement de soi. Certaines ne sont pas sans lien avec l’éthique hacker d’ailleurs, Saint-Ex ne se serait pas déplu au Sahara Labs :
« Notre communauté n’était pas somme de nos intérêts, elle était somme de nos dons. »
De même son obsession à faire passer le courrier rappelle le datalove : data must flow !
Un ingénieur est venu présenter l’énorme projet de ferme éolienne, le plus grand d’Afrique, à Tarfaya même. Je ne suis pas sûre que GDF-Suez se soucie vraiment du développement harmonieux de la région, mais c’est toujours moins pire que les gaz de schiste qui pointent le bout de leur fracturation hydraulique. Du coup, on a discuté davantage avec des ingénieurs qu’avec des touristes à l’hôtel. Comme par exemple Juan [2], un Espagnol naguère à la tête d’une entreprise florissante dans les énergies renouvelables qui a tout perdu et espère faire de nouveau affaire au Maroc. Pour le moment, il travaille sur le chantier de la ferme éolienne. Il a divorcé et ne voit sa fille, restée en Espagne, que rarement. À l’hôtel, il traine son ennui et son espérance triste, avec dignité.

Casamar, accessible uniquement à marée basse.
La première nuit, il nous a gentiment emmenées avec Ghizlane Echoudar à quelques kilomètres de la ville, observer les étoiles. Ghizlane est chef de projet dans le merchandising, elle travaille en ce moment sur l’amélioration du petit commerce marocain - hygiène, présentation, etc-, et elle est passionnée de photographie (et aussi de pain au chocolat à la vache qui rit, si, si). Son Canon EOS 5D mark III, équipé d’un 24-105 et son trépied Manfrotto ont fait les 1 000 kilomètres avec elle depuis Casablanca.
Les deux jours précédents le TEDx, elle a arpenté la ville pour en saisir sa beauté tranquille, des clichés qu’elle a utilisés pour sa présentation. Elle a présenté son rêve de Tarfaya dans le futur : une ville reverdie, grâce à la protection du tarfa, cet arbre qui protège de l’ensablement mais qui a quasiment disparu ici, du kitesurf ou encore l’aménagement de Casamar, un fort accessible à marée basse, en un restaurant-galerie.

Développer Tarfaya, pourquoi pas. S’il est toujours possible de laisser trainer trois heures un lap top au bar de l’hôtel sans craindre le vol, si le pêcheur prend encore le temps de sortir de l’eau ses caisses de crabes et de langoustes pour vous montrer les impressionnantes bestioles, si des enfants dans la rue continuent de vous dire « bonjour, bienvenu au Maroc » dans un français approximatif, avant de repartir aussi vite qu’ils sont apparus, si vos hôtes vous retiennent encore par le bout du sac pressé pour un dernier repas, quitte à appeler la compagnie de bus pour jauger le retard de votre véhicule et à négocier avec le chauffeur une petite pause. Le dernier tajine était à la chèvre, dégusté avec les doigts et du pain, selon la coutume.
« La beauté, qui est beauté,
N’a ni de pourquoi,
Ni de faux semblants. » Barbara, Là-bas.
« Rien, rien, c’est bien mieux que tout. » Gainsbourg, Ces petits riens.
— -
Photos avec l’aimable autorisation de Ghizlane, aka Kai Sou.
Lire aussi ce billet de John Toutain, Et si le futur du Maroc s’écrivait à Tarfaya ? John vit au Maroc, où il est entre autres curateur du TEDxCasablanca, et il a aidé à ce titre l’organisation de TEDx Tarfaya.
Iron Man 3, Super Bidouille à la rescousse du monde
Des premières scènes jusqu’à la fin, Iron Man 3, sorti cette semaine en France, est traversé par la figure du bidouilleur ingénieux sous toutes ses formes : maker, tinkerer, hacker. Petite revue en captures d’écran cracra et souvenirs de dialogues.
La première séquence, un flash back en 1999, introduit le personnage du bio-hacker. Maya Hansen est une « botaniste » d’un genre un peu particulier puisque les plantes qu’elle tripote ont la capacité de se régénérer. Augmented ficcus de belle-maman. Une technique qu’avec son acolyte le docteur Aldrich Killian, elle va appliquer à des cobayes humains, des vétérans de guerre américains handicapés. Stark utilise le terme « hacker » pour décrire la technique de Maya Hansen.
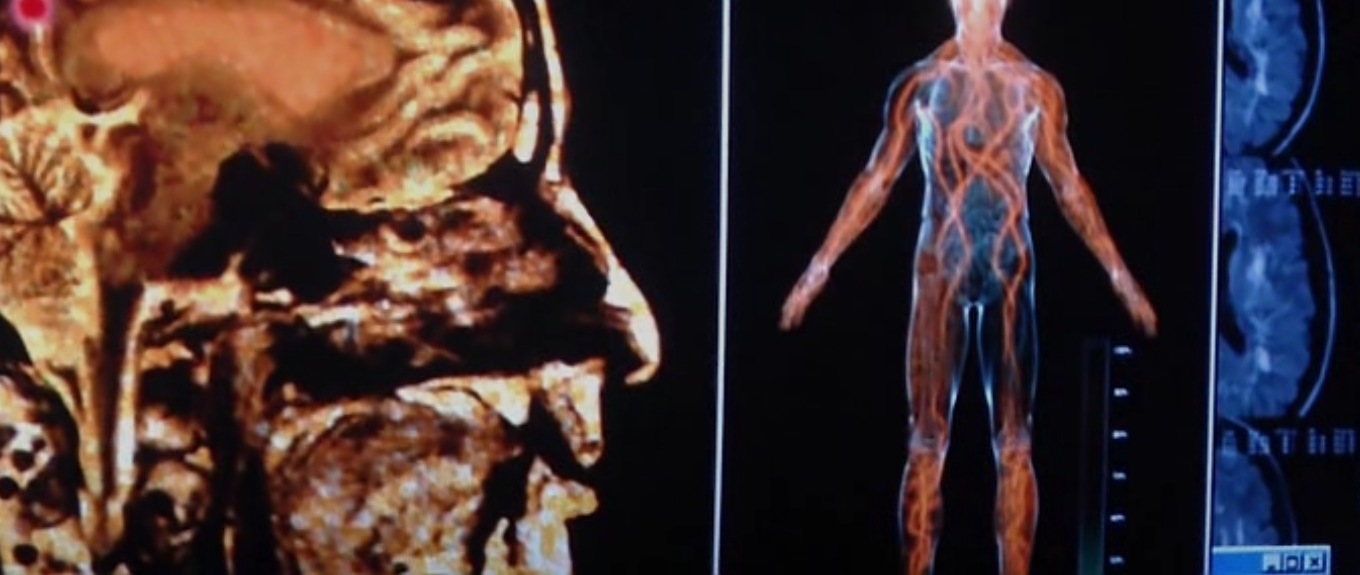

Stark est lui-même un homme augmenté, d’abord par la force des choses. Enlevé par des terroristes en Afghanistan, « il ne survit que grâce à un électro-aimant placé près de son cœur et alimenté par une batterie de voiture. » (merci Wikipedia). La contrainte devient passion et il passe des heures à améliorer son armure.
15 ans plus tard, on retrouve donc Stark, dans sa cave, où il bricole ses armures, équivalent high tech du garage/makerspace/hackerspace. Avec une différence notable : Stark est un solitaire, alors que le partage est au centre des valeurs des communautés de bidouilleurs.
Ses seuls compagnons sont des machines qu’il a conçues, un robot ménager qui passe le balai, et Jarvis, une intelligence artificielle.

Stark bricole, teste, et parfois se plante, conformément au « learning by failing » cher aux hackers, comme en témoigne son essai foiré pour « appeler » les éléments de son armure.



Mais contrairement aux hobbyistes du dimanche, Stark est un super-héros dont la mission est de sauver le monde/les États-Unis. La passion de la bidouille n’est pas la seule qui le tient éveillé des nuits durant, comme il l’explique à sa compagne Pepper. Il se décrit comme un « tinkerer » (bricoleur) angoissé. Au passage, Tinkerer est un autre héros de Marvel, mais pas gentil du tout (merci Wikipedia bis).
« But honey I can’t sleep. You go to bed and I come down here, I do what I know, I tinker. Threat is imminent and I have to protect the one thing I can’t live without. That’s you. » (à 0’33)
Plus loin, Stark rencontre son jeune alter-ego, Harley, qui le tient en joue armé d’un fusil à patates visiblement améliorée puisqu’il peut dégommer un objet à plusieurs mètres. La rencontre a lieu dans son antre de bricoleur, nettement plus modeste que la cave de Stark. Harley n’est pas sans rappeler un enfant bien réel, Joey Hudy, qui avait fait au président Obama une démonstration de son « Extreme Marshmallow Cannon ».

Non content de jouer avec le monde matériel, le hardware, Stark aime bien aussi cracker des mots de passe, comme lui rappelle son complice James Rhodes, aka Iron Patriot, ce qui oblige ce dernier à en changer.
On le voit ensuite pénétrer dans des dossiers de AIM, la société du vilain professeur Aldrich Killian. Dans l’éthique hacker, l’intention est un paramètre important pour qualifier les actes. De ce point de vue, Stark est un white hat, un « gentil » hacker, puisque son objectif est louable.
James Rhodes emploie le mot « hacker » pour qualifier le vol de son mot de passe, ce à quoi Stark lui répond qu’on emploie plus ce terme, si quelqu’un a une interprétation, je suis preneuse, à moins que ce ne soit qu’une pirouette.
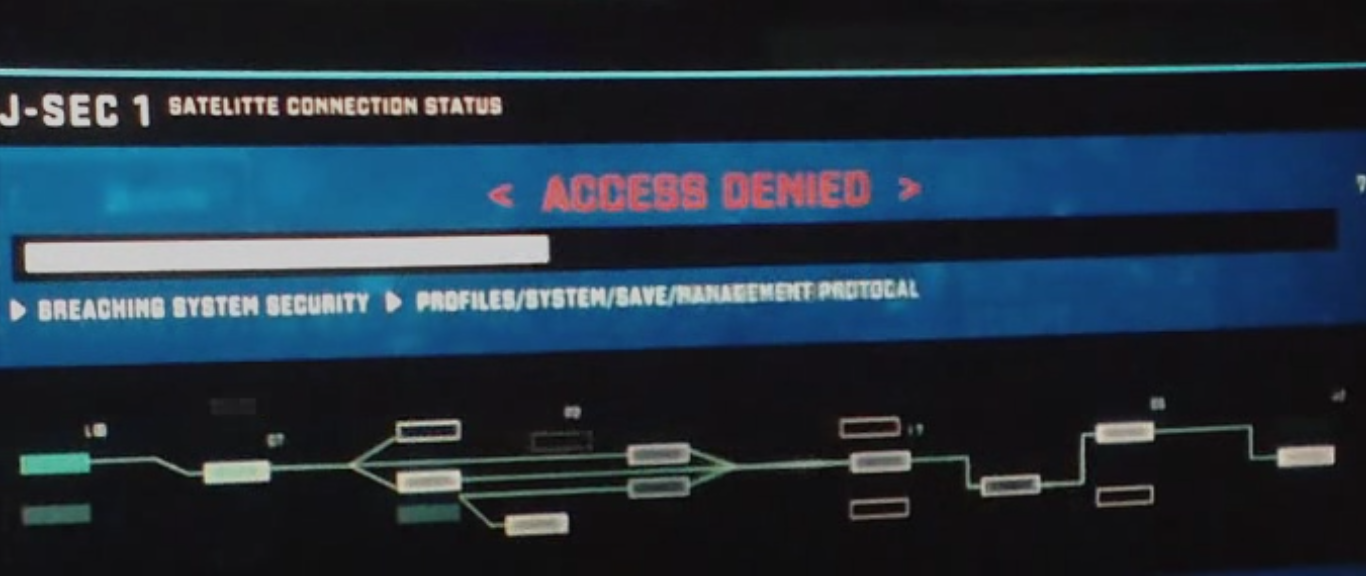
En proie à des crises d’angoisse, Stark trouve la guérison dans la bidouille low tech : Harvey lui dit de « construire » (« build ») s’il se sent mal (merci Bumblebee pour la précision). Direction le supermarché, où il embarque du matériel de jardinage qui lui permettra de se fabriquer une armada DIY : boule de Noël explosive, taser, gant électrifié, etc, le tout fourré dans un sac de sport, loin de son armure haut de gamme, et assez efficace pour partir à l’assaut de la maison du méchant, du moins dans un premier temps. Le final verra le retour non pas de l’armure mais d’une armée d’armures. Mais c’est bien son ingéniosité, sa créativité, son esprit de détournement, qui lui permette de rebondir. Les plans de cette séquence mettent à l’honneur les mains qui fabriquent :







Au sujet des armes DIY, et cette fois-ci bien réelles, il y a eu cet article sur les rebelles syriens, la controverse autour des armes imprimées, ou encore celui sur ces labs de guerre mobiles américains, équipés d’imprimantes 3D pour réparer le matériel au plus près du terrain, en Afghanistan.
À la fin, pour remercier Harley, Stark lui équipe son garage d’outils qui émerveille le gamin. Nul doute qu’il saura s’en servir pour continuer de créer :

Le film se clôt sur une réflexion sur le biohacking et l’homme augmenté : Stark se fait ôter son électro-aimant. De même, Pepper, augmentée contre son gré, l’implore pour redevenir normale : se régénérer ad vitam aeternam, non merci !
DIY calling
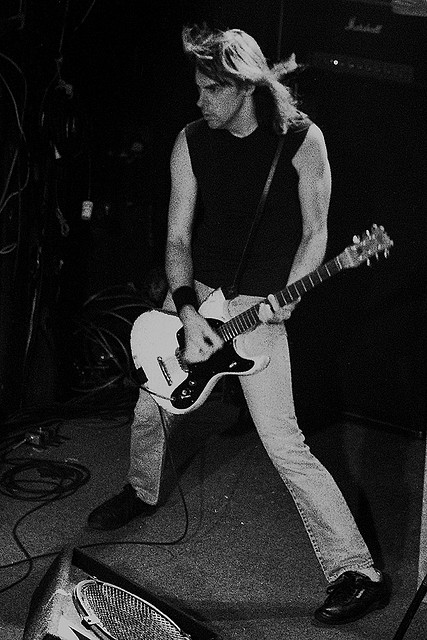
Joey Ramone, le chanteur du groupe Ramones.
Le mot DIY fait plutôt penser à des gus dans un garage avec un marteau plutôt qu’une guitare au poing. En quoi le punk relève-t-il du DIY ? Est-ce un aspect à la marge ou au contraire est-ce l’essence du punk ?
Il est vrai que les fiches Castorama participent elles aussi de la dynamique DIY. La scène punk est véritablement la première à célébrer à ce point le DIY. Le phénomène est lié à son histoire. Il s’exprime d’une part, par une volonté de participer à l’activité artistique et culturelle sur la base de l’idée que chacun peut le faire. Chacun peut monter un groupe, chacun peut éditer un fanzine, chacun peut organiser un concert, chacun peut monter un festival, chacun peut lancer une radio, etc. Un certain nombre d’exemples vont le démontrer et confirmer que c’est effectivement à la portée de chacun.
Pour la production de disques, les Buzzcocks vont faire la démonstration qu’il est possible d’autoproduire un disque, qu’il est possible de monter un label pour lui donner un statut professionnel, qu’il est possible de le distribuer sans réseau de distribution professionnel. Et pour finir d’obtenir un succès indépendamment (16 000 copies écoulés en moins de six mois) de toute structure professionnelle. En 1977, c’est totalement inédit.
Pareil pour les fanzines. Mark Perry va lancer Sniffin’Glue, premier fanzine punk britannique. De 50 exemplaires, il va atteindre 15 000 exemplaire en moins d’un an. Sur un mode bricolé, DIY, complètement non-professionnel. Ce qui est proprement incroyable. Et qui va convaincre d’autres jeunes gens à passer à l’action. Qu’être musicien et journaliste n’est pas réservé à une élite. Le DIY va dès lors se répandre comme une trainée de poudre.
Évidemment, il faut aussi mettre ce phénomène en relation avec la démocratisation des moyens de production. Le prix des instruments se démocratise, les photocopieurs de répandent dans l’espace professionnel, quantité de choses inimaginables jusqu’alors deviennent possibles. Les punks vont s’engouffrer dans la brèche avec une bonheur qui ne se dément pas jusqu’à nos jours. Si bien que le DIY est totalement consubstantiel du punk rock. Ou plus exactement de certaines franges punk rock. Celles pour lesquelles le DIY est un critère d’authenticité majeur.
Quel groupe/artiste vous semble le plus incarner cet esprit DIY ?
Crass et la majeure partie de la scène anarcho-punk (Poison Girls, Amebix, La Fraction et des milliers d’autres), les Desperates Bicycles, Tragedy et puis des gens comme IanMcKaye de Minor Threat, Fugazi et The Evens qui a confondé un label DIY, Dischord Rds.
Avant le punk, d’autres groupes ont-ils versé dans le DIY ? Vous évoquez le skiffle mais n’y a-t-il pas eu d’autres précédents ?
Oui bien sûr, les punks sont simplement les premiers à valoriser autant le DIY comme manière de faire, comme état d’esprit. Avant eux, il y a eu les hippies dans les années 60, le skiffle dans les années 50, le jazz et le blues dans la première moitié du siècle. La différence tient à ce que pour beaucoup d’artistes, le DIY est un pis aller. Pour les punks, une frange d’entre eux, c’est un mode de vie et il n’est pas imaginable de fonctionner en dehors de ce régime.
On ne retrouve pas cet aspect dans le rap, autre genre anti-système ?
Si bien sûr, certaines franges du rap fonctionnent exactement de la même manière. Mais c’est le cas de quantité de genres musicaux. On fait indépendamment de l’industrie musicale qui ne veut pas de nous et on s’en fiche. L’important c’est de faire des choses. C’est le processus qui compte. Et l’on ne rend des comptes à personne. C’est très sain !
La notion de rattrapage par le système revient souvent, vous évoquez la capacité du « nouvel esprit du capitalisme » à souffler aussi dans les cordes punk. Est-ce une fatalité ou certains ont-ils su y échapper ?
Effectivement, certains punks, même attachés au DIY peuvent rejoindre les multinationales à un moment de leur carrière. C’est toute la force du capitalisme que de parvenir à attirer à eux les rebelles et autres réfractaires. Car la rébellion fait vendre. C’est un argument commercial en soi. Que les multinationales tentent d’exploiter allègrement. Certains artistes peuvent se montrer sensibles aux arguments déployés par les multinationales. D’autres y résistent envers et contre tout.
Mais il ne s’agit jamais d’une fatalité. Ce sont des choix éthiques. Ils appartiennent à chacun. Certains sont très critiques à l’endroit des artistes qui décident de travailler avec une multinationale. Mais peut-on légitimement refuser à un artiste de vouloir vivre de son art ? Et que dire des artistes punk qui vendent leur musique à des agences de pub et réinvestissent l’argent ainsi gagné dans des collectifs comme Sea Sheperd, Greenpeace, Indymedia ?

Crise écologico-économique, montée en puissance des pratiques collaboratives grâce à Internet, le DIY est en plein essor actuellement, est-ce que l’écosystème actuel de la musique a un regain d’intérêt pour le DIY aussi ?
Évidemment. En période de crise, le monde économique cherche à faire des profits, mais aussi des économies, et accessoirement à s’inspirer de nouveaux modèles. L’industrie musicale observe donc avec intérêt cette dynamique DIY. Elle l’effraie à bien des égards, car si tous les artistes décidaient de se dispenser des services offerts par les industries culturelles, elles courraient à leur perte.
D’un autre point de vue, cette dynamique DIY offre de nouvelles ressources utiles aux industries culturelles dominantes. On voit comment elles exploitent les ressources du web 2.0 par exemple en mettant les dispositions des fans à leur service. Mais sur le fond, les industries culturelles restent très attractives. Et il faut être très fort pour y résister. Certains le sont, d’autres moins. Mais en définitive, ce qui compte, n’est ce pas de produire de la musique de qualité ?
Do It Yourself ! Autodétermination et culture punk, Fabien Hein, Paris : Le passager clandestin, 2012, 174 pages.
Image Flickr CC by nd Rik Goldman et by nc Cletus Awreetus
Vidéosurveillance : « on écrit l’arrêté qui sera en vigueur en 2020… »

L’objectif de l’AN2V est clair : l’association nationale de la vidéoprotection souhaite une révision de l’arrêté du 3 août 2007 « portant définition des normes techniques des systèmes de vidéosurveillance », afin de l’adapter aux évolutions en la matière. Elisabeth Sellos-Cartel, adjointe au Préfet délégué à la Sécurité Privée pour le développement de la vidéoprotection, a rappelé la vocation de cet arrêté, paru 12 ans après que la loi du 21 janvier 1995 a enfin encadré la vidéosurveillance : « à quoi ça sert d’autoriser des systèmes s’ils ne servent à rien ? »
L’AN2V a donc réuni ce jeudi ses adhérents - entreprises, utilisateurs privés et publics et institutions -, afin de constituer treize groupes de travail chargés d’élaborer un livre blanc pour septembre.
Une velléité douchée en ouverture par le ministère de l’Intérieur, par la bouche de Jean-Louis Blanchou, le préfet délégué interministériel à la sécurité privée. « L’arrêté reçoit peu de critiques fondamentales, a-t-il rappelé, nous n’en sommes qu’au stade de la réflexion sur la nécessité de le retoucher ». Il a souligné que « les besoins des utilisateurs priment, pas ceux des entreprises, la norme ne doit pas s’aligner sur ce qui ce fait de mieux techniquement ».
Quality not quantity
La précision n’est pas inutile, tant l’histoire de la vidéosurveillance s’apparente à une lucrative fuite en avant technologique. Le président de l’AN2V Dominique Legrand « fantasme » (sic) sur une sorte de Google search qui permettrait de chercher par exemple telle couleur dans des heures d’images, rappelant que les policiers en charge de l’affaire Merah ont dû fouiner en vain dans plusieurs teraoctets de données, pour un maigre résultat. S’il s’est défendu d’être « un marchand de caméras » en préambule, une hausse des exigences techniques devrait a priori faire le bonheur desdits marchands membres de l’association qui participent à ce livre blanc.
Le préfet a également redit que la position de l’Etat avait évolué avec l’arrivée de Manuel Valls. Après avoir « acclimaté les populations, les opérateurs, les élus, l’objectif a évolué ces derniers mois, on ne veut plus faire du chiffre, l’accent est mis sur l’apport aux agents de l’Etat sur le terrain, dissuasion, protection et élucidation. Les polémiques ont changé de paradigme : avant, les caméras étaient liberticides et inutiles, maintenant, les gens se demandent si ça ne coûte pas trop cher pour ce à quoi ça sert. Ne vaudrait-il pas mieux investir ailleurs ? Cet aspect doit être transversal à toutes les réflexions. » Un sondage BVA cité par le préfet indique en effet que 75% des Français sont désormais très favorables au développement de la vidéosurveillance dans l’espace public.
« Il existe un risque d’annulation de procédures »
Jean-Louis Blanchou a souligné l’importance de « fixer des critères de norme pour sécuriser le système et éviter des mauvais usages et des détournements car il existe un risque d’annulation de procédures qui fragiliserait la qualité de l’outil. »
Une intervention conclut par un dernier rappel : « Ce livre blanc doit rester un document AN2V, mais il ne sera pas estampillé “État”. l’État piochera éventuellement le cas venu dedans, en fonction de ses contingences et de son ressenti. »
« Notre objectif c’est que vous soyez "obligé" de modifier l’arrêté, a plaisanté en retour Dominique Legrand, que vous ayez envie de le faire. »
Le reste de la réunion a été consacré à la constitution des groupes de travail. Pour présenter un livre blanc crédible, les représentants des quatre « collèges » de l’AN2V ont été invités à contribuer. « Il n’y a que des représentants des centres de sécurité urbaine dans ce groupe », a taclé à un moment donné Elisabeth Sellos-Cartel. Finalement, les groupes finissent par s’étoffer, entre gros représentants, de Thalès à la ville de Lyon en passant par la SNCF, et d’autres plus modestes.
Stockage, interopérabilité, mobilité, relecture des enregistrements, le spectre large a suscité des réflexions dépassant sans doute ce que peut faire fixer l’arrêté : « l’objectif n’est pas de réécrire la loi de 1995 », précise Dominique Legrand. Gille Robine, du ministère de l’Intérieur, explique que « l’arrêté ne peut concerne que les caractéristiques techniques, on ne pourra pas imposer telle utilisation ».
« Il y a beaucoup de déception sur la vidéoverbalisation »
Au détour des échanges, on apprend qu’ « il y a beaucoup de déception sur la vidéoverbalisation : on n’a pas la plaque, alors même si elle est volée on peut la retrouver. Un élu qui a installé des caméras pour la vidéoverbalisation a expliqué lors d’une précédente réunion que ça ne marchait pas ». C’est pourtant une tendance montante, avec Paris qui vient de lancer après Nice ou bien encore Marseille.
La sécurité des systèmes d’information est « un problème qui nous prend au nez et de plus en plus », s’inquiète Dominique Legrand. L’ANSSI devrait apporter sa contribution sur ce groupe de travail.
La question des masques est aussi remise sur la table, ces caches numériques qui servent à protéger la vie privée. « Faut-il les adapter, les crypter ? », s’interroge Dominique Legrand. Il constitue parfois « une gêne dramatique dans les enquêtes. » À ce sujet, un représentant de la communauté urbaine de Strasbourg estime que les textes juridiques trop flous : « ça me donne beaucoup de travail le contrôle de la Cnil... »
Autre point qui titille, l’interdiction posée par le Conseil constitutionnel de filmer la voie publique avec des caméras privées. « Plein de caméras de commerce sont braquées vers l’extérieur, la loi n’est pas respectée. Des particuliers ont envie de mettre des caméras sur la route devant leur maison, ça pourrait servir pour le gars qui passe en moto noire (Mohammed Merah, ndlr). Si ça pouvait remonter en haut… »
Un bijoutier approuve mais cette question ne relève pas de l’arrêté. Elle finira en annexe, dans les autres sujets à traiter un jour.
Dominique Legrand invite aussi à ne pas se brider technologiquement : « on écrit l’arrêté qui sera en vigueur en 2020… » Une envolée prématurée pour le moment.
A (re)lire : Le lobby caché des caméras
Crédit photo Flickr by nc nd Mypouss
Les fab labs sur la feuille des autoroutes numériques du gouvernement
[Article publié sur OuiShare]
Ce matin, le Premier ministre a présenté la feuille de route de son gouvernement sur le numérique en 18 points. Le développements des fab labs, ces ateliers collaboratifs boostés au numérique, en fait partie. Il s’est même fendu d’une visite de l’un d’entre eux avec Fleur Pellerin, puisque l’annonce a été faite à l’antenne de la fac de Cergy à Gennevilliers, qui y a casé son Fac Lab.
“Oh quelles jolies pochettes !”, lance Fleur Pellerin à Josiane, la petite cinquantaine, reine du dé à coudre et maintenant de la découpe laser. Elle a conçu ces beaux rectangles de cuir vif en alliant techniques anciennes et modernes au sein du Fac Lab, le fab lab de l’université de Cergy installé dans son antenne de Gennevilliers. Juste avant, la ministre déléguée à l’Economie numérique regardait avec admiration un costume orné de boutons lumineux tout autant fait main.
Fleur Pellerin a donc tenu sa promesse lancée en décembre sur Twitter : ce jeudi matin, elle a visité un fab lab, un atelier de fabrication personnelle collaboratif qui démultiplie les possibilités de création en s’appuyant sur la collaboration en ligne et les machines-outils assistées par ordinateur.
Et non seulement la ministre a déambulé entre les fers à souder et la découpe vinyle mais elle l’a fait en compagnie du Premier ministre et de la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Car cette visite in situ a été calée dans la foulée d’un séminaire gouvernemental sur le numérique présidé par Jean-Marc Ayrault. Entre le très haut débit, l’open data et la formation des profs, les fab labs font partie de la feuille des autoroutes numériques dévoilée par le Premier ministre, dans la catégorie “Promouvoir nos valeurs dans la société et l’économie numériques”.
Rien de nouveau depuis le séminaire EPN organisé voilà deux semaines à Bercy qui avait dessiné l’évolution des missions des Espaces publics numériques, ces lieux de formation ouverts en 1997. Fleur Pellerin avait annoncé d’un débit de mitraillette monocorde qu’une partie des EPN deviendraient des fab labs. Un évolution logique de leur rôle, à l’heure où la majorité des Français savent désormais se servir d’Internet et disposent d’une connexion à la maison. D’autre part, l’avenir semble désormais à la fabrication (numérique) personnelle.
Valeurs et utilité sociétale
La bonne impression laissée par ce séminaire a été confirmée. Loin de les décrire comme des lieux magiques d’où sortira l’économie de demain à base de start-up innovantes, la présentation met en avant l’accent sur les valeurs et leur utilité sociétale potentielle :
“Maitriser les innovations numériques issues des nouveaux procédés de fabrication et permettre aux usagers de produire de nouveaux objets.
Permettre le détournement créatif des matériels et d’outils numériques existants et l’adaptation vers des usages innovants ;
Connaître les procédures de réparation des outils numériques (dont les outils électroménagers) pour répondre aux besoins des populations en difficulté.”
Le “détournement créatif”, pour ne pas prononcer l’effrayant terme “hacking”. Mais l’esprit est là. Le distingo avec les TechShop, ces espaces qui louent du temps de machine, a été bien retenu. En décembre, le cabinet avait organisé un séminaire “Développement des fab labs en France” réunissant le DG de cette chaine américaine à big business success qui cherche à s’installer en Europe, le Fac Lab, des gens des start-ups numérique françaises et de l’industrie.
Flou sur le financement des machines
Concrètement, “une phase d’expérimentation sera lancée en 2013 pour développer des services innovants dans certains EPN. Ces expérimentations concerneront les usages mobiles et la création de fab labs”. 2 000 emplois d’avenir renforceront les effectifs des EPN, avec la création du métier de “forgeur numérique” chargé d’aider à mettre en place les labs.
Voilà pour la théorie. Sur le terrain, une première question de taille se pose : qui paye les machines et leur entretien ? Aucune enveloppe particulière n’a été annoncée et les finances des collectivités locales sont en berne. Or un fab lab, c’est environ 20 000 euros, entre la découpe laser, l’imprimante 3D, les postes de soudure, l’outillage. Il faut aussi trouver des locaux adéquats, de taille suffisante et aux normes de sécurité adaptées. Par exemple, il faut prévoir un système de filtration des fumées pour la découpe laser, un évier pour la refroidir.
Un fab lab, c’est des machines mais c’est surtout une communauté qui s’anime. Déjà, il n’est pas certain que ces forgeurs numériques fraichement intégrés dans le réseau EPN soient la solution optimale : si les missions des fab labs évoluent, pourquoi pas aussi celles de leurs animateurs actuels ? De plus, il n’est pas garanti que ce soit des CDI et le profil de leur formation est davantage technique qu’humain. Il faudra aussi s’assurer que le maillage sera régulier, et non uniquement fonction des appétences des EPN pour les atomes.
L’autre dimension est éducative : les fab labs font partie de ces lieux qui permettent de pallier un défaut du système éducatif français, la survalorisation de l’intellectuel au détriment de la pratique. A quand une déclinaison français de FabLab@School ?
Enfin, ces fab labs devront s’articuler avec ceux qui ont poussé de façon spontané depuis quelques années, les pionniers Artilect et autres PiNG, et qui continueront de le faire. Sans compter les entreprises qui ont bien vu leur intérêt dans le concept : avant Ayrault et Pellerin, le Fac Lab a déjà reçu la visite de Leroy-Merlin.





